Après vous avoir dévoilé il y a quelques jours notre TOP 10 des films qui n’ont pas fait genre en 2023, on vous propose d’explorer, de découvrir, de revisiter, quinze séquences qui n’ont pas fait genre lors de l’année écoulée. Ces scènes partagent toutes un point commun : elles hantent pour longtemps. Certaines d’entre elles étant des “scènes de fin” nous précisons que des spoilers et autres divulgachis peuvent se loger dans ces textes.
Barbie de Greta Gerwig
Pied de nez
par Louise Camerlynck
 Rien ne va plus pour Barbie (Margot Robbie). Son paradis rose bonbon programmatique est bousculé par un bug dans la matrice duquel découle de nombreuses anomalies dont une majeure : ses pieds, naturellement courbés pour entrer parfaitement dans tout talon haut, sont devenus plats. Son équilibre plastique s’écroule, la Barbie Stéréotypée n’est plus. Elle se rend à la plage comme à son habitude, mais incapable de marcher, elle s’écroule. Si jusqu’ici les corps des Barbie et des Ken étaient déplacés par une main invisible – Barbie vole de son toit à sa voiture ; Ken (Ryan Gosling) est secoué dans les airs après avoir percuté une fausse vague – l’impact de son corps contre le sol est le premier mu par une force inhérente à elle-même. Premier pas de côté qui, soudain, fait d’elle un individu en dehors du système codifié de Barbieland. Comme Thomas Anderson dans Matrix (les sœurs Wachowski, 1999), Barbie prend conscience qu’elle devient l’anomalie quand Ken Basketteur (Kingsley Ben-Adir), écho d’un Agent Smith, pose sur elle un regard suspicieux, que le cadre, toujours stable, tremble et menace de s’effondrer lorsque la caméra est sur elle et que la musique se mue en une mélodie mystérieuse. Barbie s’installe avec peine sur un banc et ses amies la rejoignent. Les plans sont à nouveau stables et le tremblement est interne, dans son corps spasmodique, comme pour se débattre de ce système écrasant ou pour tenter de se dissimuler. Scène de coming-out moderne, Barbie leur annonce la nouvelle : « Je ne l’explique pas, mes pieds…mes talons touchent le sol. Je ne suis plus sur la pointe ». Elle leur montre un de ses pieds, et Barbie Docteur (Hari Nef) ouvre le bal des réactions en criant d’une voix profonde et rocailleuse « Des pieds plats ! » avant d’imiter un vomissement et les autres suivent, imitent la même action ou crient. Ken Basketteur rejoint le mouvement, ce qui provoque sa fin immédiate. Barbie Ecrivaine (Alexandra Shipp) soulève qu’elle est « défaillante », tandis que Barbie Physicienne (Emma Mackey) lui conseille d’aller consulter Barbie Bizarre. Leurs réactions grotesques face au pied de Barbie semblent créer une rupture de registre avec l’humour du film et peut dérouter. Pourtant, comme la scène d’intro détournant 2001, l’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, 1968) celle-ci parodie une scène d’Ace Ventura, détective chiens et chats de Tom Shadyac (1995). Scène de climax, Ace Ventura (Jim Carrey) lève le voile sur son enquête en révélant à la police l’identité du coupable. Il dénude la Lieutenante Einhorn (Sean Young) et affiche entre ses cuisses un pénis, signe qu’elle est en réalité l’homme qu’ils cherchaient, Finkle. Une révélation qui provoque pour la police des nausées tandis que les spectateurs et spectatrices d’aujourd’hui s’insurgent de cette instrumentalisation stéréotypée et violente des personnes trans’, qui dans l’histoire du cinéma nourrissent depuis longtemps un imaginaire criminel et déviant – Psychose (Hitchcock, 1960), Pulsions (De Palma, 1980), Massacre au camp d’été (Hiltzik, 1983), Le Silence des agneaux (Demme, 1991)… La portée féministe du film de Greta Gerwig a longtemps été – et le sera encore – débattue. Mais lorsqu’Hari Nef, actrice trans’, crie sa réplique en jouant de sa voix et en imitant le jeu de Jim Carrey, c’est la théoricienne Bell Hooks qui renvoie au patriarcat son regard, son gaze, c’est une filiation centenaire des violences transphobes au cinéma qui vole en éclats tandis que Barbie pioche ouvertement dans Matrix. Un monument de pop-culture réalisé par deux sœurs trans’, dont l’une d’elle, Lilly, affirme aujourd’hui l’interprétation de thèmes liés aux transidentités. D’ailleurs, dans la scène suivante, Barbie est invitée par Barbie Bizarre à choisir entre un talon haut et une sandale, substitut des pilules bleues et rouges que Morpheus propose à Neo. Dans une période où Hollywood tend progressivement vers le double-tranchant d’une inclusivité opportuniste, c’est avec une sympathie renouvelée que l’on constate que Gerwig, au détour d’une des nombreuses blagues anodines de sa comédie, affirme, au moins là-dessus, avoir fait le bon choix.
Rien ne va plus pour Barbie (Margot Robbie). Son paradis rose bonbon programmatique est bousculé par un bug dans la matrice duquel découle de nombreuses anomalies dont une majeure : ses pieds, naturellement courbés pour entrer parfaitement dans tout talon haut, sont devenus plats. Son équilibre plastique s’écroule, la Barbie Stéréotypée n’est plus. Elle se rend à la plage comme à son habitude, mais incapable de marcher, elle s’écroule. Si jusqu’ici les corps des Barbie et des Ken étaient déplacés par une main invisible – Barbie vole de son toit à sa voiture ; Ken (Ryan Gosling) est secoué dans les airs après avoir percuté une fausse vague – l’impact de son corps contre le sol est le premier mu par une force inhérente à elle-même. Premier pas de côté qui, soudain, fait d’elle un individu en dehors du système codifié de Barbieland. Comme Thomas Anderson dans Matrix (les sœurs Wachowski, 1999), Barbie prend conscience qu’elle devient l’anomalie quand Ken Basketteur (Kingsley Ben-Adir), écho d’un Agent Smith, pose sur elle un regard suspicieux, que le cadre, toujours stable, tremble et menace de s’effondrer lorsque la caméra est sur elle et que la musique se mue en une mélodie mystérieuse. Barbie s’installe avec peine sur un banc et ses amies la rejoignent. Les plans sont à nouveau stables et le tremblement est interne, dans son corps spasmodique, comme pour se débattre de ce système écrasant ou pour tenter de se dissimuler. Scène de coming-out moderne, Barbie leur annonce la nouvelle : « Je ne l’explique pas, mes pieds…mes talons touchent le sol. Je ne suis plus sur la pointe ». Elle leur montre un de ses pieds, et Barbie Docteur (Hari Nef) ouvre le bal des réactions en criant d’une voix profonde et rocailleuse « Des pieds plats ! » avant d’imiter un vomissement et les autres suivent, imitent la même action ou crient. Ken Basketteur rejoint le mouvement, ce qui provoque sa fin immédiate. Barbie Ecrivaine (Alexandra Shipp) soulève qu’elle est « défaillante », tandis que Barbie Physicienne (Emma Mackey) lui conseille d’aller consulter Barbie Bizarre. Leurs réactions grotesques face au pied de Barbie semblent créer une rupture de registre avec l’humour du film et peut dérouter. Pourtant, comme la scène d’intro détournant 2001, l’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, 1968) celle-ci parodie une scène d’Ace Ventura, détective chiens et chats de Tom Shadyac (1995). Scène de climax, Ace Ventura (Jim Carrey) lève le voile sur son enquête en révélant à la police l’identité du coupable. Il dénude la Lieutenante Einhorn (Sean Young) et affiche entre ses cuisses un pénis, signe qu’elle est en réalité l’homme qu’ils cherchaient, Finkle. Une révélation qui provoque pour la police des nausées tandis que les spectateurs et spectatrices d’aujourd’hui s’insurgent de cette instrumentalisation stéréotypée et violente des personnes trans’, qui dans l’histoire du cinéma nourrissent depuis longtemps un imaginaire criminel et déviant – Psychose (Hitchcock, 1960), Pulsions (De Palma, 1980), Massacre au camp d’été (Hiltzik, 1983), Le Silence des agneaux (Demme, 1991)… La portée féministe du film de Greta Gerwig a longtemps été – et le sera encore – débattue. Mais lorsqu’Hari Nef, actrice trans’, crie sa réplique en jouant de sa voix et en imitant le jeu de Jim Carrey, c’est la théoricienne Bell Hooks qui renvoie au patriarcat son regard, son gaze, c’est une filiation centenaire des violences transphobes au cinéma qui vole en éclats tandis que Barbie pioche ouvertement dans Matrix. Un monument de pop-culture réalisé par deux sœurs trans’, dont l’une d’elle, Lilly, affirme aujourd’hui l’interprétation de thèmes liés aux transidentités. D’ailleurs, dans la scène suivante, Barbie est invitée par Barbie Bizarre à choisir entre un talon haut et une sandale, substitut des pilules bleues et rouges que Morpheus propose à Neo. Dans une période où Hollywood tend progressivement vers le double-tranchant d’une inclusivité opportuniste, c’est avec une sympathie renouvelée que l’on constate que Gerwig, au détour d’une des nombreuses blagues anodines de sa comédie, affirme, au moins là-dessus, avoir fait le bon choix.
“Barbie” est disponible en Blu-Ray et DVD chez Warner Bros
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © Warner Bros / Mattel
.
.
.
The Fabelmans de Steven Spielberg
Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese
Le Juste Horizon
par Pierre-Jean Delvolvé
 Aborder les films de vieux cinéastes comme des oeuvres-testament est sans doute l’un des poncifs critiques les plus tenaces, et on pourrait croire qu’en choisissant d’analyser conjointement les conclusions des derniers Spielberg et Scorsese, nous y prêterions le flan. C’est pourtant, au contraire, le ludisme et la vitalité de ces magnifiques moments qui nous ont cueilli, à la fin d’ouvrages certes pas exempt de noirceur – surtout Killers of the Flower Moon, même si cela resterait à discuter. Une vitalité enfantine, joueuse qui parce qu’elle est chargée d’un regard à la sagesse nouvelle et poignante nous touche tout particulièrement. A la fin de The Fabelmans, Spielberg opère une très surprenante et émouvante brisée du quatrième mur. John Ford vient d’édicter au jeune Sammy sa règle sur l’horizon dans un plan : « quand il est en haut, c’est intéressant. Quand il est en bas, c’est intéressant. Quand il est au milieu, c’est chiant à mourir ». Le dernier plan qui suit correspond d’abord parfaitement à la virtuosité Spielberguienne qui s’exprime dans chaque photogramme de son dernier essai. La caméra voit de l’extérieur Sammy sortir du studio, s’attache sans coupe à ses mains, maintenant un corps transi d’émotions à une rambarde. L’échelle change soudain, avec cette fluidité qui caractérise le découpage Spielberguien, quand le garçon se déplace : en contre-plongée, Sammy contemple son rêve, celui du grand studio qui le surplombe. La caméra reste ensuite fixe pour le regarder lointainement sautiller joyeusement dans cet horizon spectaculaire. La sagesse est de regarder cette course de loin, sans doute avec une certaine retenue. Je l’écrivais au moment de la sortie, il me semble que, dans ce film, Spielberg se concentre avant tout à regarder une forme d’impasse fédératrice, du désir un peu vain d’un spectaculaire qui rassemblerait des pôles irréconciliables – y compris ses propres parents – et ce dernier plan, cette légère distance qui ne participe pas totalement de l’euphorie de son alter-ego vont dans ce sens. C’est surtout dans le tout dernier mouvement de caméra, à la fois très drôle et très émouvant, qu’on peut observer cette ludique sagesse. Ce léger et presque approximatif recadrage permet à Spielberg de dire, malicieusement, qu’il a retenu tardivement la leçon du vieux Ford. L’horizon est tout de même au-dessus dans le plan, promettant un avenir ensoleillé à Sammy Fabelman, mais on voit bien que sa démarche est inconsciente. Sammy, contrairement au cinéaste derrière la caméra, n’a sans doute pas retenu la leçon, et il faudra une vie de cinéaste, une œuvre complète en hors-champ de ce dernier chef-d’oeuvre et de ce dernier plan, pour que l’apprentissage soit complet. Que cette profondeur soit contenu dans un mouvement d’appareil – rarissime dans sa carrière qui a souvent privilégié les effets spectaculaires – aussi anodin, faussement mal-assuré, comme celui d’un home-movie, est peut-être ce qui nous y bouleverse le plus.
Aborder les films de vieux cinéastes comme des oeuvres-testament est sans doute l’un des poncifs critiques les plus tenaces, et on pourrait croire qu’en choisissant d’analyser conjointement les conclusions des derniers Spielberg et Scorsese, nous y prêterions le flan. C’est pourtant, au contraire, le ludisme et la vitalité de ces magnifiques moments qui nous ont cueilli, à la fin d’ouvrages certes pas exempt de noirceur – surtout Killers of the Flower Moon, même si cela resterait à discuter. Une vitalité enfantine, joueuse qui parce qu’elle est chargée d’un regard à la sagesse nouvelle et poignante nous touche tout particulièrement. A la fin de The Fabelmans, Spielberg opère une très surprenante et émouvante brisée du quatrième mur. John Ford vient d’édicter au jeune Sammy sa règle sur l’horizon dans un plan : « quand il est en haut, c’est intéressant. Quand il est en bas, c’est intéressant. Quand il est au milieu, c’est chiant à mourir ». Le dernier plan qui suit correspond d’abord parfaitement à la virtuosité Spielberguienne qui s’exprime dans chaque photogramme de son dernier essai. La caméra voit de l’extérieur Sammy sortir du studio, s’attache sans coupe à ses mains, maintenant un corps transi d’émotions à une rambarde. L’échelle change soudain, avec cette fluidité qui caractérise le découpage Spielberguien, quand le garçon se déplace : en contre-plongée, Sammy contemple son rêve, celui du grand studio qui le surplombe. La caméra reste ensuite fixe pour le regarder lointainement sautiller joyeusement dans cet horizon spectaculaire. La sagesse est de regarder cette course de loin, sans doute avec une certaine retenue. Je l’écrivais au moment de la sortie, il me semble que, dans ce film, Spielberg se concentre avant tout à regarder une forme d’impasse fédératrice, du désir un peu vain d’un spectaculaire qui rassemblerait des pôles irréconciliables – y compris ses propres parents – et ce dernier plan, cette légère distance qui ne participe pas totalement de l’euphorie de son alter-ego vont dans ce sens. C’est surtout dans le tout dernier mouvement de caméra, à la fois très drôle et très émouvant, qu’on peut observer cette ludique sagesse. Ce léger et presque approximatif recadrage permet à Spielberg de dire, malicieusement, qu’il a retenu tardivement la leçon du vieux Ford. L’horizon est tout de même au-dessus dans le plan, promettant un avenir ensoleillé à Sammy Fabelman, mais on voit bien que sa démarche est inconsciente. Sammy, contrairement au cinéaste derrière la caméra, n’a sans doute pas retenu la leçon, et il faudra une vie de cinéaste, une œuvre complète en hors-champ de ce dernier chef-d’oeuvre et de ce dernier plan, pour que l’apprentissage soit complet. Que cette profondeur soit contenu dans un mouvement d’appareil – rarissime dans sa carrière qui a souvent privilégié les effets spectaculaires – aussi anodin, faussement mal-assuré, comme celui d’un home-movie, est peut-être ce qui nous y bouleverse le plus.
Cet éloge des moyens les plus simples de la mise en scène, on le retrouve d’une autre manière dans Killers of the Flower Moon, aussi à la faveur d’une entrée en scène conclusive du metteur en scène lui-même, cette fois plus explicite. Alors que se résout la sordide affaire du massacre des Osages, résonnent soudain, surprise, des notes au spectaculaire daté. Celles de Vince Giordano et the Nighthawks. La surprise est décuplée quand on découvre qu’elles forment en fait l’introduction d’une émission radiophonique enregistrée en public, retraçant le destin des différents protagonistes après le procès. De cette magnifique séquence, peut-être la plus belle de l’année, on a surtout beaucoup glosé sur l’apparition – certes très émouvante – de Scorsese lui-même, jouant le dernier intervenant de l’émission. Sa voix tremblante d’émotion, ses mots cherchant à réparer le silence qui voila l’histoire de Molly Kyle : tout cela est évidemment bouleversant. Mais ce qui m’a semblé le plus surprenant se situe plutôt dans le reste de la séquence, ou plutôt dans son ensemble. Les plans qui se succèdent nous montrent des moyens d’expression d’un dénuement aux antipodes de la virtuosité Scorsesienne : des bruitages à l’ancienne, quelques instruments de musique, des accessoires dignes de jeux enfantins, des interprètes sur-expressifs, pas vraiment actor studio, une narration littérale. Comme Spielberg, Scorsese accède à une simplicité qui chez lui est encore plus surprenante, même si elle semble avoir investi son cinéma depuis Silence (2017). Spielberg a sans doute trouvé depuis plus longtemps cette évidence du classicisme, tandis que Scorsese a pu lasser à toujours chercher une virtuosité plus clinquante qui a fait les grandes heures de son cinéma. Killers of the Flower Moon est au contraire, peut-être, son premier grand film classique, et beaucoup sont passés à côté de cette dimension, voulant à tous prix voir une cathédrale monumentale à cause de sa durée et de son casting iconique. C’est une toute autre image qu’il faudrait à mon avis en retenir : celle d’un vieil homme, au soir de sa vie, debout sur une scène de théâtre, presque dans le plus simple appareil, à raconter les dernières histoires qui lui tiennent à cœur. Et qui semble, lui aussi, connaître désormais les secrets du juste horizon.
.
.
“The Fabelmans” est disponible en 4K UHD, Blu-Ray et DVD chez Universal Pictures
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © Universal Pictures
“Killers of the Flower Moon” sortira bientôt chez Paramount Pictures
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © Paramount Pictures
.
Beau is Afraid de Ari Aster
Street of Rage
par Kévin Robic
 Beau Is Afraid est une odyssée complexe et tordue où le personnage titre, interprété par un Joaquin Phoenix halluciné, doit se dépêtrer de moults situations pour rejoindre sa mère. Le film a beaucoup décontenancé pour le malaise qu’il met en images, et pour les différentes ruptures de tons et de rythmes qu’il propose sur sa durée de trois heures. Beaucoup louent cependant sa première partie, plus « classique » et lisible selon certains. Cela tombe bien, l’une des scènes les plus emblématiques du film prend place dans son premier acte, quand ce pauvre Beau doit aller chercher de l’eau chez l’épicier d’en face, en milieu du chaos ambiant. La séquence démarre dans le calme de la sortie d’ascenseur de Beau qui observe la rue et jauge son niveau d’agitation. Il s’avance et tourne le verrou de la porte de son immeuble. Il bloque la porte avec un annuaire et se lance dans son périple. Il bouscule un SDF, enjambe une agression en cours, se fait poursuivre par un homme qui l’insulte, esquive des gens à poil, puis rentre dans l’épicerie. Il prend une bouteille d’eau qu’il entame puis se dirige pour payer. Sa carte bleue ne passe pas et des gens commencent à rentrer dans son immeuble. Il cherche désespéramment des pièces pour payer tout en regardant les gens continuer à pénétrer le bâtiment. Il finit par s’en aller sans payer, mais les intrus retirent l’annuaire retenant la porte et Beau se retrouve enfermé dehors à observer son appartement aux mains d’individus pas franchement recommandables. Cette séquence, très courte, synthétise le chemin de croix que sera le reste du film pour Beau tout en illustrant par l’image le mal être qui est le sien : la peur et la paranoïa. La scène est bâtie comme un champ/contre-champ géant entre ce début où Beau est encore en sécurité à l’intérieur à observer la rue, et cette conclusion où il est réduit à observer son chez-lui être envahi par des intrus. L’image de Pawel Pogorzelski illustre tout à fait ce revirement en utilisant des valeurs de cadre qui se répondent en symétrie tandis que le montage de Lucian Johnston et la superbe musique de Bobby Krlic matérialisent l’urgence et la panique du personnage dans ce marasme urbain. Cet aller-retour entre son appartement et l’épicerie demeure une mini odyssée puisque selon Beau, s’il ne boit pas de cette eau après avoir pris son médicament, il risque la mort. L’enjeu est donc crucial pour le personnage, tandis que le spectateur prend un peu de hauteur et contemple juste un homme s’engouffré dans son désespoir, empêtré dans ses lubies. À ce stade, le film navigue entre malaise, comédie et horreur, et cette scène est bien le résumé de tout cela. La peur de Beau, son look et le chaos dehors peuvent prêter à rire, tandis que les gens entrant chez le héros et la façon dont cela se prépare et se termine peut représenter nos pires cauchemars, emprunts d’intrusion et de dépossession. Dans ce cauchemar nihiliste, tout à coup, la menace se fait plus concrète et Ari Aster met en scène, ici, le point de bascule de son personnage en même temps que la synthèse du voyage sans retour à venir. Sans en donner les clés de compréhension, le cinéaste propose un premier aperçu de ce que seront les dangers futurs qui guettent déjà Beau.
Beau Is Afraid est une odyssée complexe et tordue où le personnage titre, interprété par un Joaquin Phoenix halluciné, doit se dépêtrer de moults situations pour rejoindre sa mère. Le film a beaucoup décontenancé pour le malaise qu’il met en images, et pour les différentes ruptures de tons et de rythmes qu’il propose sur sa durée de trois heures. Beaucoup louent cependant sa première partie, plus « classique » et lisible selon certains. Cela tombe bien, l’une des scènes les plus emblématiques du film prend place dans son premier acte, quand ce pauvre Beau doit aller chercher de l’eau chez l’épicier d’en face, en milieu du chaos ambiant. La séquence démarre dans le calme de la sortie d’ascenseur de Beau qui observe la rue et jauge son niveau d’agitation. Il s’avance et tourne le verrou de la porte de son immeuble. Il bloque la porte avec un annuaire et se lance dans son périple. Il bouscule un SDF, enjambe une agression en cours, se fait poursuivre par un homme qui l’insulte, esquive des gens à poil, puis rentre dans l’épicerie. Il prend une bouteille d’eau qu’il entame puis se dirige pour payer. Sa carte bleue ne passe pas et des gens commencent à rentrer dans son immeuble. Il cherche désespéramment des pièces pour payer tout en regardant les gens continuer à pénétrer le bâtiment. Il finit par s’en aller sans payer, mais les intrus retirent l’annuaire retenant la porte et Beau se retrouve enfermé dehors à observer son appartement aux mains d’individus pas franchement recommandables. Cette séquence, très courte, synthétise le chemin de croix que sera le reste du film pour Beau tout en illustrant par l’image le mal être qui est le sien : la peur et la paranoïa. La scène est bâtie comme un champ/contre-champ géant entre ce début où Beau est encore en sécurité à l’intérieur à observer la rue, et cette conclusion où il est réduit à observer son chez-lui être envahi par des intrus. L’image de Pawel Pogorzelski illustre tout à fait ce revirement en utilisant des valeurs de cadre qui se répondent en symétrie tandis que le montage de Lucian Johnston et la superbe musique de Bobby Krlic matérialisent l’urgence et la panique du personnage dans ce marasme urbain. Cet aller-retour entre son appartement et l’épicerie demeure une mini odyssée puisque selon Beau, s’il ne boit pas de cette eau après avoir pris son médicament, il risque la mort. L’enjeu est donc crucial pour le personnage, tandis que le spectateur prend un peu de hauteur et contemple juste un homme s’engouffré dans son désespoir, empêtré dans ses lubies. À ce stade, le film navigue entre malaise, comédie et horreur, et cette scène est bien le résumé de tout cela. La peur de Beau, son look et le chaos dehors peuvent prêter à rire, tandis que les gens entrant chez le héros et la façon dont cela se prépare et se termine peut représenter nos pires cauchemars, emprunts d’intrusion et de dépossession. Dans ce cauchemar nihiliste, tout à coup, la menace se fait plus concrète et Ari Aster met en scène, ici, le point de bascule de son personnage en même temps que la synthèse du voyage sans retour à venir. Sans en donner les clés de compréhension, le cinéaste propose un premier aperçu de ce que seront les dangers futurs qui guettent déjà Beau.
“Beau is Afraid” est disponible en Blu-Ray
et DVD chez Originals Factory
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © A24 / Originals Factory
.
The Crown S06E04 – Onde de Choc de Peter Morgan
Elizabeth et ses fantômes
par Joris Laquittant
 On se souviendra de l’année 2023 comme celle où la série The Crown aura tiré sa révérence. Au terme d’une sixième et ultime saison scindée en deux parties, la Reine des séries referme ses enjeux narratifs sur une conclusion crépusculaire. Sur le papier, rien ne laissait présager que ce feuilleton hagiographique sur le règne de la Reine Elizabeth II puisse entrer dans le cadre de notre ligne éditoriale, quand bien même nous revendiquons de ne pas en figer les lignes et de s’intéresser a tout ce qui joue avec les lisières. Cette dernière saison aura à bien des égards titillé notre curiosité et certainement même révélé la véritable identité de cette série, bien souvent honorée pour son extrême tenue classique. Quand Peter Morgan entame son entreprise en 2016 en promettant de couvrir la quasi-totalité du règne de la Reine, on sait déjà que viendra le moment où fatalement le spectre de Diana Spencer et de sa mort accidentelle viendrait hanter le récit. La série aura repoussé cette échéance jusqu’au bout, profitant d’un règne aux milles histoires passionnantes pour décortiquer une institution et les personnages qui la représentent, mais aussi plus de soixante ans d’histoire britannique. Finalement, les quatre premiers épisodes de la première partie de cette saison finale s’arrêtent sur ce fameux été 1997 durant lequel la princesse de Galles perdit la vie. La séquence qui nous intéresse ici est l’une des plus fortes de cette saison si sombre : après l’accident mortel du pont de l’Alma, tout le Royaume-Uni converge vers Buckingham Palace pour pleurer sa princesse adorée. Terrée dans son palais doré, meurtris et mutique, la Reine a la sagesse de ne pas faire immédiatement émoi populaire de son deuil. D’abord parce que son rôle le lui interdit mais aussi parce qu’elle souhaite s’assurer d’être présente pour sa famille, à commencer pour ses petits-fils qui viennent de perdre brutalement leur mère. Dehors, peuples et médias du monde entier s’impatientent et commencent à considérer le manque de réaction de la monarque comme une marque de mépris et de froideur. Seule devant sa télévision, Elizabeth prend le pouls de la tristesse incommensurable qui réunit son peuple. Mille pensées et doutes la traverse, quelle voie/voix doit elle écouter, celle du peuple ou de l’institution, celle de la modernité ou des traditions, celle du monde extérieur ou de son microcosme de palais ? Ce fut par ailleurs l’une des constantes de la série que de se saisir de la psychologie constamment chahutée de la Reine et des choix décisifs ou anodins qu’elle a dû prendre tout au long de sa vie pour protéger la couronne. Dès la première saison, The Crown a toujours mis l’accent sur la malédiction des couronnés et de leurs entourages, destinés a s’abandonner tout entier à leur fonction représentative. Ce qui n’est pas apparu d’emblée mais qui sonne désormais comme une évidence c’est que cette malédiction s’est exprimée six saisons durant dans les nombreux fantômes qui les peuplaient. Alors qu’elle est face à ses doutes, Elizabeth voit justement un autre fantôme venir la hanter, celui de Diana Spencer elle-même qui apparaît sur le divan. Perdue dans le flou d’un arrière plan dominé par le visage fermé et terrifié de la Reine (sublime Imelda Staunton, trop sous estimée) elle appose sa main sur celles nouées et tendues d’une Elizabeth prostrée comme une enfant apeurée. Un frisson lui parcourt l’échine et les larmes lui naissent aux yeux. La Reine apparaît alors dans sa fragilité la plus totale. A ses côtés, une Diana rayonnante et apaisée ne vient pas la tourmenter mais la conseiller, l’aider à prendre la bonne décision avant de disparaître et de laisser Elizabeth seule, face à son destin et sa décision. Cet écart fantastique a largement été commenté et reproché aux scénaristes. Pourtant plus que jamais, Peter Morgan et son équipe semblent assumer la nature la plus profonde de leur série. Bien sûr, ce dialogue – comme à peu près tous les autres savoureusement écrits et interprétés dans les six saisons – relève de la fiction, d’un imaginaire fantasmé. En assumant ici ce pas de côté vers la fiction la plus totale Morgan évite l’écueil d’une reconstitution journalistique qui aurait pu contraindre ces derniers épisodes dont les événements relatés sont si proches de nous. L’horizon qu’il nous offre prolonge la plongée psychologique de l’entreprise jusqu’à ses retranchements. Le derniers tiers multiplie les scènes spectrales à mesure que la Reine et son entourage se laisse submerger par le plus évident de tous : celui de sa propre mort. L’épisode final réussit l’exploit de traiter de cette disparition récente de la façon la plus métaphorique et fantastique qui soit. Planifiant son enterrement monumental à l’avance, Elizabeth ne se contente pas de laisser les fantômes la hanter, elle les convoque, consent à les contrôler. Lors d’un dernier plan aux accents fantastico-mystiques elle tire sa révérence avant l’heure, comme une Reine, et la reine des séries avec elle. The Crown est morte. God save The Crown.
On se souviendra de l’année 2023 comme celle où la série The Crown aura tiré sa révérence. Au terme d’une sixième et ultime saison scindée en deux parties, la Reine des séries referme ses enjeux narratifs sur une conclusion crépusculaire. Sur le papier, rien ne laissait présager que ce feuilleton hagiographique sur le règne de la Reine Elizabeth II puisse entrer dans le cadre de notre ligne éditoriale, quand bien même nous revendiquons de ne pas en figer les lignes et de s’intéresser a tout ce qui joue avec les lisières. Cette dernière saison aura à bien des égards titillé notre curiosité et certainement même révélé la véritable identité de cette série, bien souvent honorée pour son extrême tenue classique. Quand Peter Morgan entame son entreprise en 2016 en promettant de couvrir la quasi-totalité du règne de la Reine, on sait déjà que viendra le moment où fatalement le spectre de Diana Spencer et de sa mort accidentelle viendrait hanter le récit. La série aura repoussé cette échéance jusqu’au bout, profitant d’un règne aux milles histoires passionnantes pour décortiquer une institution et les personnages qui la représentent, mais aussi plus de soixante ans d’histoire britannique. Finalement, les quatre premiers épisodes de la première partie de cette saison finale s’arrêtent sur ce fameux été 1997 durant lequel la princesse de Galles perdit la vie. La séquence qui nous intéresse ici est l’une des plus fortes de cette saison si sombre : après l’accident mortel du pont de l’Alma, tout le Royaume-Uni converge vers Buckingham Palace pour pleurer sa princesse adorée. Terrée dans son palais doré, meurtris et mutique, la Reine a la sagesse de ne pas faire immédiatement émoi populaire de son deuil. D’abord parce que son rôle le lui interdit mais aussi parce qu’elle souhaite s’assurer d’être présente pour sa famille, à commencer pour ses petits-fils qui viennent de perdre brutalement leur mère. Dehors, peuples et médias du monde entier s’impatientent et commencent à considérer le manque de réaction de la monarque comme une marque de mépris et de froideur. Seule devant sa télévision, Elizabeth prend le pouls de la tristesse incommensurable qui réunit son peuple. Mille pensées et doutes la traverse, quelle voie/voix doit elle écouter, celle du peuple ou de l’institution, celle de la modernité ou des traditions, celle du monde extérieur ou de son microcosme de palais ? Ce fut par ailleurs l’une des constantes de la série que de se saisir de la psychologie constamment chahutée de la Reine et des choix décisifs ou anodins qu’elle a dû prendre tout au long de sa vie pour protéger la couronne. Dès la première saison, The Crown a toujours mis l’accent sur la malédiction des couronnés et de leurs entourages, destinés a s’abandonner tout entier à leur fonction représentative. Ce qui n’est pas apparu d’emblée mais qui sonne désormais comme une évidence c’est que cette malédiction s’est exprimée six saisons durant dans les nombreux fantômes qui les peuplaient. Alors qu’elle est face à ses doutes, Elizabeth voit justement un autre fantôme venir la hanter, celui de Diana Spencer elle-même qui apparaît sur le divan. Perdue dans le flou d’un arrière plan dominé par le visage fermé et terrifié de la Reine (sublime Imelda Staunton, trop sous estimée) elle appose sa main sur celles nouées et tendues d’une Elizabeth prostrée comme une enfant apeurée. Un frisson lui parcourt l’échine et les larmes lui naissent aux yeux. La Reine apparaît alors dans sa fragilité la plus totale. A ses côtés, une Diana rayonnante et apaisée ne vient pas la tourmenter mais la conseiller, l’aider à prendre la bonne décision avant de disparaître et de laisser Elizabeth seule, face à son destin et sa décision. Cet écart fantastique a largement été commenté et reproché aux scénaristes. Pourtant plus que jamais, Peter Morgan et son équipe semblent assumer la nature la plus profonde de leur série. Bien sûr, ce dialogue – comme à peu près tous les autres savoureusement écrits et interprétés dans les six saisons – relève de la fiction, d’un imaginaire fantasmé. En assumant ici ce pas de côté vers la fiction la plus totale Morgan évite l’écueil d’une reconstitution journalistique qui aurait pu contraindre ces derniers épisodes dont les événements relatés sont si proches de nous. L’horizon qu’il nous offre prolonge la plongée psychologique de l’entreprise jusqu’à ses retranchements. Le derniers tiers multiplie les scènes spectrales à mesure que la Reine et son entourage se laisse submerger par le plus évident de tous : celui de sa propre mort. L’épisode final réussit l’exploit de traiter de cette disparition récente de la façon la plus métaphorique et fantastique qui soit. Planifiant son enterrement monumental à l’avance, Elizabeth ne se contente pas de laisser les fantômes la hanter, elle les convoque, consent à les contrôler. Lors d’un dernier plan aux accents fantastico-mystiques elle tire sa révérence avant l’heure, comme une Reine, et la reine des séries avec elle. The Crown est morte. God save The Crown.
.
“The Crown – Saison 6” est disponible sur Netflix
Crédit Photo © Netflix
The Killer de David Fincher
Course-Poursuite contre le vide
par Pierre-Jean Delvolvé
 Au terme d’une très impressionnante première scène – une mission sniper par fenêtres interposées – qui tourne mal, le tueur de David Fincher doit changer de plan. Dès le début, toute sa logorrhée en OFF est contredite, et ce sera plus d’une fois le cas. Disons même que c’est cette tension entre ses mantras doctement édictés et ses actions qui sera essentielle au récit, plus que tout conflit dramaturgique habituel. Cet homme froid et méticuleux nous promettait que rien ne pourrait jamais lui échapper : il a raté sa mission. Nous disait que rien ne le ferait sortir de son calme sans empathie : il s’en va le souffle court, respirant mal au rythme des sirènes de police qui le harcèlent. Qu’il ne s’en tenait jamais qu’à son plan : le voilà en fuite incertaine sur un scooter électrique volé à la hâte. Mais contre quoi exactement ? Des voitures de police passent par là, mais elle ne sont pas bien inquiétantes. La moto de Fassbender trace dans le vide, dans des rues parisiennes désolées, ce qu’accentuent les notes mélancoliques – et sublimes – de Trent Raznor et Atticus Ross. Beaucoup sont revenus sur la première scène de The Killer, considérée comme la meilleure. Sur la méticulosité exposée par le tueur évoquant pour beaucoup (mais pas vraiment, à mon sens) celle du cinéaste, la référence Hitchcockienne à Fenêtre sur Cour (1954), les retouches numériques saisissantes, ou encore l’apparition saugrenue des Smiths. Moins nombreux sont ceux qui ont écrit sur cette fuite incroyable qui lui fait suite, et qui pourtant concentre toutes les beautés paradoxales de ce nouvel essai mal-aimable. Comme le reste du film, il s’agit d’une scène sans réel danger, réduite à sa pure action, sa mécanique mortifère. Le personnage panique bien : il jette déjà toutes les preuves de son meurtre – son téléphone, son sac, pas moins de quatre éléments jetés dans quatre lieux différents en un temps record – comme il n’aura de cesse de jeter tout ce qu’il touche. Sa respiration inquiète obnubile la bande-son. Pourtant, la tension nous est comme interdite, tant elle est contredite par le ronron déprimant du scooter électrique et par la tristesse de la musique. Surtout, tout cela semble se dérouler dans une sorte de vide hypnotique, un terrain d’action sans motif. La moto trace à pure perte. Le paysage est touristique mais éteint, comme uniquement éclairés par les voitures de police à sa poursuite, mais qui semblent éviter savamment, dans une chorégraphie étourdissante, notre meurtrier. par C’est comme l’anti-thèse de la poursuite parisienne de Mission Impossible : Fallout (Christopher McQuarrie, 2018) : la géographie de la ville dans la scène est extrêmement cohérente, mais elle s’exécute dans un refus de la tension, concentrée sur son « héros » fonçant dans le vide. Les lumières et présences qui se reflètent dans son casque sont comme les spectres d’un monde vidé d’émotion et de rapport humain. Ne reste plus qu’un flux continu de gestes creux, qui filmé par Fincher n’est pas sans une espèce de poésie, à la fois vaine et cruelle. A la manière du titre paradoxale du magnifique thème musical déjà évoqué. Ses nappes entêtantes évoquent une mélancolie assez émouvante pourtant étrangère au personnage (du moins superficiellement et dans son discours, mais la forme plurielle du film ne cessera de compliquer ce constat). On y entend aussi des synthétiseurs formant presque comme des voix d’outre tombe. Mais ce qui surprend le plus dans ce thème se trouve ailleurs, dans son contenant plutôt que son contenu, ce qui va bien à cette œuvre emplie de placements de produits mortifères. Le lieu de son paradoxe est dans son titre affreusement trivial, à priori tout ce qu’il y a de moins mélancolique : « Fuck. ». Soit, le premier mot prononcé en direct par Fassbender, juste après son tir manqué. « Fuck » c’est aussi le célèbre dernier mot d’Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, l’un des maîtres de Fincher, autre grand film d’un monde progressivement vidé de sentiment. Ce « fuck » répondait à la question de Tom Cruise : « que nous reste-t-il à faire ? ». Il semblerait que dans la vanité de notre monde, Fincher se soit arrêté à cette question, et à la réponse de son inconfortable personnage : « faire », et c’est à peu près tout. Beau et étrange pari que de vouloir donner forme à cette question et cette réponse sordides, dans les codes doctement respectés du film de genre.
Au terme d’une très impressionnante première scène – une mission sniper par fenêtres interposées – qui tourne mal, le tueur de David Fincher doit changer de plan. Dès le début, toute sa logorrhée en OFF est contredite, et ce sera plus d’une fois le cas. Disons même que c’est cette tension entre ses mantras doctement édictés et ses actions qui sera essentielle au récit, plus que tout conflit dramaturgique habituel. Cet homme froid et méticuleux nous promettait que rien ne pourrait jamais lui échapper : il a raté sa mission. Nous disait que rien ne le ferait sortir de son calme sans empathie : il s’en va le souffle court, respirant mal au rythme des sirènes de police qui le harcèlent. Qu’il ne s’en tenait jamais qu’à son plan : le voilà en fuite incertaine sur un scooter électrique volé à la hâte. Mais contre quoi exactement ? Des voitures de police passent par là, mais elle ne sont pas bien inquiétantes. La moto de Fassbender trace dans le vide, dans des rues parisiennes désolées, ce qu’accentuent les notes mélancoliques – et sublimes – de Trent Raznor et Atticus Ross. Beaucoup sont revenus sur la première scène de The Killer, considérée comme la meilleure. Sur la méticulosité exposée par le tueur évoquant pour beaucoup (mais pas vraiment, à mon sens) celle du cinéaste, la référence Hitchcockienne à Fenêtre sur Cour (1954), les retouches numériques saisissantes, ou encore l’apparition saugrenue des Smiths. Moins nombreux sont ceux qui ont écrit sur cette fuite incroyable qui lui fait suite, et qui pourtant concentre toutes les beautés paradoxales de ce nouvel essai mal-aimable. Comme le reste du film, il s’agit d’une scène sans réel danger, réduite à sa pure action, sa mécanique mortifère. Le personnage panique bien : il jette déjà toutes les preuves de son meurtre – son téléphone, son sac, pas moins de quatre éléments jetés dans quatre lieux différents en un temps record – comme il n’aura de cesse de jeter tout ce qu’il touche. Sa respiration inquiète obnubile la bande-son. Pourtant, la tension nous est comme interdite, tant elle est contredite par le ronron déprimant du scooter électrique et par la tristesse de la musique. Surtout, tout cela semble se dérouler dans une sorte de vide hypnotique, un terrain d’action sans motif. La moto trace à pure perte. Le paysage est touristique mais éteint, comme uniquement éclairés par les voitures de police à sa poursuite, mais qui semblent éviter savamment, dans une chorégraphie étourdissante, notre meurtrier. par C’est comme l’anti-thèse de la poursuite parisienne de Mission Impossible : Fallout (Christopher McQuarrie, 2018) : la géographie de la ville dans la scène est extrêmement cohérente, mais elle s’exécute dans un refus de la tension, concentrée sur son « héros » fonçant dans le vide. Les lumières et présences qui se reflètent dans son casque sont comme les spectres d’un monde vidé d’émotion et de rapport humain. Ne reste plus qu’un flux continu de gestes creux, qui filmé par Fincher n’est pas sans une espèce de poésie, à la fois vaine et cruelle. A la manière du titre paradoxale du magnifique thème musical déjà évoqué. Ses nappes entêtantes évoquent une mélancolie assez émouvante pourtant étrangère au personnage (du moins superficiellement et dans son discours, mais la forme plurielle du film ne cessera de compliquer ce constat). On y entend aussi des synthétiseurs formant presque comme des voix d’outre tombe. Mais ce qui surprend le plus dans ce thème se trouve ailleurs, dans son contenant plutôt que son contenu, ce qui va bien à cette œuvre emplie de placements de produits mortifères. Le lieu de son paradoxe est dans son titre affreusement trivial, à priori tout ce qu’il y a de moins mélancolique : « Fuck. ». Soit, le premier mot prononcé en direct par Fassbender, juste après son tir manqué. « Fuck » c’est aussi le célèbre dernier mot d’Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, l’un des maîtres de Fincher, autre grand film d’un monde progressivement vidé de sentiment. Ce « fuck » répondait à la question de Tom Cruise : « que nous reste-t-il à faire ? ». Il semblerait que dans la vanité de notre monde, Fincher se soit arrêté à cette question, et à la réponse de son inconfortable personnage : « faire », et c’est à peu près tout. Beau et étrange pari que de vouloir donner forme à cette question et cette réponse sordides, dans les codes doctement respectés du film de genre.
“The Killer”est disponible sur Netflix
Crédit Photo © Netflix
La Main de Danny et Michael Philippou
Le Pied
par Pierre-Jean Delvolvé
 Paradoxe, peut-être : c’est souvent dans les films d’horreur les plus mainstream que se logent les visions les plus subversives et dérangeantes sur les pulsions et autres terreurs adolescentes. Il me faut peut-être d’abord vous avouer que c’est un esprit quelque peu traumatisé à l’adolescence, justement par la BFF sordide et cannibale de Jennifer’s Body (Karyn Kusama, 2009) qui vous parle. Mais on fait souvent l’expérience de cette conjonction inattendue entre les attendues d’un spectaculaire horrifique standardisé, et les fantasmes, angoisses, entre autres éléments qui saturent les inconscients de ces êtres en mutation que sont les adolescents. D’évidence, le marché de ce type de spectacle sait se servir de ces images pour toucher plus directement son public cible. On pourrait arguer en quelque sorte l’inverse, et voir aussi qu’il y a dans ce type d’horreur quelque chose de particulièrement judicieux pour figurer les instincts tordus qui parcourent l’adolescence, leur servir de catharsis. Cette année, c’est clairement La Main, Talk to Me en version originale, succès surprise de cet été, qui nous en aura fait revivre une fois de plus l’expérience. Il l’a fait, forcément, par son concept évoquant clairement les diverses addictions de la jeunesse contemporaine, mais surtout par une série de séquences marquantes, parcourant un ouvrage inégal bien que terriblement stimulant, et parfois franchement effrayant. Dans la scène choisie, après avoir fait une expérience un peu trop longue avec la fameuse Main permettant de traverser la conscience d’un mort, Mia est comme hantée, et cherche à se rassurer. Elle obtient de son ex petit ami, et désormais copain de sa propre meilleure amie, qu’il vienne dormir avec elle pour la surveiller, ne pas la laisser seule avec ses angoisses. La scène nous embarque donc dans un cliché du teen movie. Deux jeunes transgressent un interdit, tout en s’assurant qu’ils ne déraperont pas. La jalousie potentielle est décuplée par le fait que la meilleure amie de Mia est à ce moment-là traumatisée par l’accident de son petit frère qui vient de se blesser grièvement suite lors d’une même utilisation dangereuse de la Main. Les deux ex se couchent dans des positions inversées, comme pour éviter toute ambiguïté. C’est une image d’Épinal : le visage de Mia est face aux jambes nues de son ancien partenaire, dans un plan à la subtile et sentimentale symétrie. Elle se rapproche tout doucement, tout en évitant le contact, dans un mélange d’érotisme très léger et de tendresse enfantine. Ce cliché adolescent se confirme par une vision là encore extrêmement idéalisée : ils sont maintenant dans une pièce gorgée de soleil, prêts à s’embrasser. Cette image romantique est soudain brisée, dans la même lumière, par un souvenir qui hante la jeune femme, celui de la mort de sa mère à la suite d’une prise excessive de calmants, enfermée dans une salle de bain. Le père sort le cadavre de la pièce, regarde sa fille. L’horreur du traumatisme vient assombrir le rêve. Les visions de La Main fonctionnent souvent ainsi, le morbide vient brutalement se confronter aux fantasmes adolescents. C’est d’ailleurs ainsi que fonctionne aussi la première séquence, très réussie : on assiste à une fête rêvée pour des adolescents, gorgée de monde, de musique et d’alcool, quand un garçon sort d’une pièce où il était enfermé depuis plusieurs minutes pour commettre un meurtre atroce, suivi de son suicide. Le procédé revient souvent, avec systématiquement un espoir qu’on se réveille d’un cauchemar. Dans la scène qui nous intéresse plus précisément, Mia se réveille suite au regard de son père. Là encore, on pourrait la croire sauvée avant qu’une sinistre apparition, au fond de la pièce, dans une pénombre angoissante, semble acter le fait que l’horreur est bel et bien là, au présent, et pas uniquement dans la psyché tourmentée de l’héroïne. La présence monstrueuse s’approche lentement, dans une démarche saugrenue, pour lécher et progressivement engloutir le pied du garçon qui dort à ses côtés, ce pied devant lequel elle s’endormait presque rêveuse. Mia ne s’approche pas de la scène, ne cherche qu’à le réveiller en hurlant. Or quand il se réveille, l’image est plus saisissante que jamais, alors qu’elle n’est le fait d’aucun monstre réel : c’est en fait Mia elle-même qui tient le pied en bouche. Ce net retour à la réalité laisse place à de derniers échanges de regard assez bouleversants, et finalement très proches, une fois encore, d’un cliché du teen movie. Dans les yeux de son ex, on ne voit que le dégoût face à celle qui aurait franchi un interdit, comme si ce geste trahissait une psychose alarmante mais aussi ses sentiments tourmentés pour lui. La dynamique de la séquence est remarquable en ce sens qu’elle parvient à parfaitement retranscrire ce que peut être la logique d’un rêve ou d’un cauchemar. Elle fait feu de tous bois, se nourrissant des éléments les plus disparates, les plus concrets comme les plus fantasmés, et donnant le sentiment qu’elle n’a pas de fin. Mia en fait la douloureuse expérience dans un film entièrement soumis à cette logique, ce qui lui donne une certaine informité mais aussi d’inoubliables et terrifiantes apparitions telle que celle d’une jeune femme hantée dévorant le pied de son amant endormi. Une fois encore, l’horreur aura sali l’image d’un fantasme adolescent. A moins que les deux ne soient intrinsèquement liés.
Paradoxe, peut-être : c’est souvent dans les films d’horreur les plus mainstream que se logent les visions les plus subversives et dérangeantes sur les pulsions et autres terreurs adolescentes. Il me faut peut-être d’abord vous avouer que c’est un esprit quelque peu traumatisé à l’adolescence, justement par la BFF sordide et cannibale de Jennifer’s Body (Karyn Kusama, 2009) qui vous parle. Mais on fait souvent l’expérience de cette conjonction inattendue entre les attendues d’un spectaculaire horrifique standardisé, et les fantasmes, angoisses, entre autres éléments qui saturent les inconscients de ces êtres en mutation que sont les adolescents. D’évidence, le marché de ce type de spectacle sait se servir de ces images pour toucher plus directement son public cible. On pourrait arguer en quelque sorte l’inverse, et voir aussi qu’il y a dans ce type d’horreur quelque chose de particulièrement judicieux pour figurer les instincts tordus qui parcourent l’adolescence, leur servir de catharsis. Cette année, c’est clairement La Main, Talk to Me en version originale, succès surprise de cet été, qui nous en aura fait revivre une fois de plus l’expérience. Il l’a fait, forcément, par son concept évoquant clairement les diverses addictions de la jeunesse contemporaine, mais surtout par une série de séquences marquantes, parcourant un ouvrage inégal bien que terriblement stimulant, et parfois franchement effrayant. Dans la scène choisie, après avoir fait une expérience un peu trop longue avec la fameuse Main permettant de traverser la conscience d’un mort, Mia est comme hantée, et cherche à se rassurer. Elle obtient de son ex petit ami, et désormais copain de sa propre meilleure amie, qu’il vienne dormir avec elle pour la surveiller, ne pas la laisser seule avec ses angoisses. La scène nous embarque donc dans un cliché du teen movie. Deux jeunes transgressent un interdit, tout en s’assurant qu’ils ne déraperont pas. La jalousie potentielle est décuplée par le fait que la meilleure amie de Mia est à ce moment-là traumatisée par l’accident de son petit frère qui vient de se blesser grièvement suite lors d’une même utilisation dangereuse de la Main. Les deux ex se couchent dans des positions inversées, comme pour éviter toute ambiguïté. C’est une image d’Épinal : le visage de Mia est face aux jambes nues de son ancien partenaire, dans un plan à la subtile et sentimentale symétrie. Elle se rapproche tout doucement, tout en évitant le contact, dans un mélange d’érotisme très léger et de tendresse enfantine. Ce cliché adolescent se confirme par une vision là encore extrêmement idéalisée : ils sont maintenant dans une pièce gorgée de soleil, prêts à s’embrasser. Cette image romantique est soudain brisée, dans la même lumière, par un souvenir qui hante la jeune femme, celui de la mort de sa mère à la suite d’une prise excessive de calmants, enfermée dans une salle de bain. Le père sort le cadavre de la pièce, regarde sa fille. L’horreur du traumatisme vient assombrir le rêve. Les visions de La Main fonctionnent souvent ainsi, le morbide vient brutalement se confronter aux fantasmes adolescents. C’est d’ailleurs ainsi que fonctionne aussi la première séquence, très réussie : on assiste à une fête rêvée pour des adolescents, gorgée de monde, de musique et d’alcool, quand un garçon sort d’une pièce où il était enfermé depuis plusieurs minutes pour commettre un meurtre atroce, suivi de son suicide. Le procédé revient souvent, avec systématiquement un espoir qu’on se réveille d’un cauchemar. Dans la scène qui nous intéresse plus précisément, Mia se réveille suite au regard de son père. Là encore, on pourrait la croire sauvée avant qu’une sinistre apparition, au fond de la pièce, dans une pénombre angoissante, semble acter le fait que l’horreur est bel et bien là, au présent, et pas uniquement dans la psyché tourmentée de l’héroïne. La présence monstrueuse s’approche lentement, dans une démarche saugrenue, pour lécher et progressivement engloutir le pied du garçon qui dort à ses côtés, ce pied devant lequel elle s’endormait presque rêveuse. Mia ne s’approche pas de la scène, ne cherche qu’à le réveiller en hurlant. Or quand il se réveille, l’image est plus saisissante que jamais, alors qu’elle n’est le fait d’aucun monstre réel : c’est en fait Mia elle-même qui tient le pied en bouche. Ce net retour à la réalité laisse place à de derniers échanges de regard assez bouleversants, et finalement très proches, une fois encore, d’un cliché du teen movie. Dans les yeux de son ex, on ne voit que le dégoût face à celle qui aurait franchi un interdit, comme si ce geste trahissait une psychose alarmante mais aussi ses sentiments tourmentés pour lui. La dynamique de la séquence est remarquable en ce sens qu’elle parvient à parfaitement retranscrire ce que peut être la logique d’un rêve ou d’un cauchemar. Elle fait feu de tous bois, se nourrissant des éléments les plus disparates, les plus concrets comme les plus fantasmés, et donnant le sentiment qu’elle n’a pas de fin. Mia en fait la douloureuse expérience dans un film entièrement soumis à cette logique, ce qui lui donne une certaine informité mais aussi d’inoubliables et terrifiantes apparitions telle que celle d’une jeune femme hantée dévorant le pied de son amant endormi. Une fois encore, l’horreur aura sali l’image d’un fantasme adolescent. A moins que les deux ne soient intrinsèquement liés.
.
“La Main” est disponible en Blu-Ray et DVD chez M6 Video
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © Capelight Pictures
Mad God de Phil Tippett
Maudits
par Elie Katz
 C’était l’événement underground cinématographique de l’année. La sortie du prophète de sa caverne, le scientifique fou présentant sa création après des décennies de travail. Avant même sa sortie, on pouvait considérer Mad God comme une aberration de cinéma. Trente années pour faire une heure et vingt minutes de stop-motion gore, ça allait à l’encontre de tout ce qu’on pouvait imaginer en termes de production. Les fans les plus assidus du génie des effets visuels qu’est Phil Tippett pouvaient en arriver à croire qu’il s’agirait de l’un de ces projets architecturaux déments jamais terminés comme la Sagrada Familia de Gaudi ou le Palais des Soviets de Boris Iofane. Des doigts d’honneur bâtis et dressés contre toute raison, toute rentabilité, tout désir de plaire ou de satisfaire. La liberté de l’Homme dans toute sa prouesse productive et son horreur égoïste, la soif insatiable de l’artiste-constructeur d’atteindre l’incommensurable, son inévitable échec à y parvenir et les restes sublimes de sa tentative. Voilà plus ou moins ce à quoi on pouvait s’attendre en allant voir Mad God. Et Tippett n’a pas déçu. Il est d’ailleurs sûrement le premier conscient de son ouvrage-outrage, comme le prouve cette magistrale ouverture : l’engloutissement d’une tour de Babel. Immédiatement, cette première image du film nous saisit. Toute la puissance du monumentalisme biblique et la beauté horrifique qui nous attend sont résumés en une image, celle d’une tour de brique en colimaçon couvrant un soleil sanguine, instantanément appuyée par un orchestre hautement dramatique. Tout de suite, le souci du détail nous attrape : petit oiseau passant au loin, minuscules torches flamboyantes sous lesquelles d’encore plus minuscules êtres gravissent l’édifice, astre brûlant aux bords floutés par la chaleur… En une image, un pêché originel d’Humanité, Tippett nous confirme l’ampleur de son projet, de son talent et pose les bases de sa vision transgressive. Le plan ne s’arrête pourtant pas là. Une figure sombre et filamenteuse se dresse lentement en haut de cette tour sous les acclamations ou les cris de terreurs de la foule au pied de l’édifice, peu à peu révélée par un travelling arrière. Est-ce l’incarnation d’un jugement divin ou le fruit humain de cette architecture occulte ? Tout ce que l’on sait, c’est qu’à peine la figure apparue, des nuages d’encre coulent du ciel, illuminés par les éclairs qu’ils projettent, éclairs qui détruisent la tour. Tout ça en stop-motion, rappelons-le. Oui, oui, c’est impossible. Et pourtant. Voilà que les nuages engloutissent la tour, l’Humanité et le plan tout entier. Noir. Le jugement divin de la faute d’orgueil, un excès délirant puni par un néant absolu. Boum : écran-titre, encore plus rouge et plus titanesque que le plan précédent. Pari tenu, à peine une minute après le début du film. Bravo, tu peux y aller mollo maintenant, Phil. Spoiler : il n’y est pas du tout allé mollo.
C’était l’événement underground cinématographique de l’année. La sortie du prophète de sa caverne, le scientifique fou présentant sa création après des décennies de travail. Avant même sa sortie, on pouvait considérer Mad God comme une aberration de cinéma. Trente années pour faire une heure et vingt minutes de stop-motion gore, ça allait à l’encontre de tout ce qu’on pouvait imaginer en termes de production. Les fans les plus assidus du génie des effets visuels qu’est Phil Tippett pouvaient en arriver à croire qu’il s’agirait de l’un de ces projets architecturaux déments jamais terminés comme la Sagrada Familia de Gaudi ou le Palais des Soviets de Boris Iofane. Des doigts d’honneur bâtis et dressés contre toute raison, toute rentabilité, tout désir de plaire ou de satisfaire. La liberté de l’Homme dans toute sa prouesse productive et son horreur égoïste, la soif insatiable de l’artiste-constructeur d’atteindre l’incommensurable, son inévitable échec à y parvenir et les restes sublimes de sa tentative. Voilà plus ou moins ce à quoi on pouvait s’attendre en allant voir Mad God. Et Tippett n’a pas déçu. Il est d’ailleurs sûrement le premier conscient de son ouvrage-outrage, comme le prouve cette magistrale ouverture : l’engloutissement d’une tour de Babel. Immédiatement, cette première image du film nous saisit. Toute la puissance du monumentalisme biblique et la beauté horrifique qui nous attend sont résumés en une image, celle d’une tour de brique en colimaçon couvrant un soleil sanguine, instantanément appuyée par un orchestre hautement dramatique. Tout de suite, le souci du détail nous attrape : petit oiseau passant au loin, minuscules torches flamboyantes sous lesquelles d’encore plus minuscules êtres gravissent l’édifice, astre brûlant aux bords floutés par la chaleur… En une image, un pêché originel d’Humanité, Tippett nous confirme l’ampleur de son projet, de son talent et pose les bases de sa vision transgressive. Le plan ne s’arrête pourtant pas là. Une figure sombre et filamenteuse se dresse lentement en haut de cette tour sous les acclamations ou les cris de terreurs de la foule au pied de l’édifice, peu à peu révélée par un travelling arrière. Est-ce l’incarnation d’un jugement divin ou le fruit humain de cette architecture occulte ? Tout ce que l’on sait, c’est qu’à peine la figure apparue, des nuages d’encre coulent du ciel, illuminés par les éclairs qu’ils projettent, éclairs qui détruisent la tour. Tout ça en stop-motion, rappelons-le. Oui, oui, c’est impossible. Et pourtant. Voilà que les nuages engloutissent la tour, l’Humanité et le plan tout entier. Noir. Le jugement divin de la faute d’orgueil, un excès délirant puni par un néant absolu. Boum : écran-titre, encore plus rouge et plus titanesque que le plan précédent. Pari tenu, à peine une minute après le début du film. Bravo, tu peux y aller mollo maintenant, Phil. Spoiler : il n’y est pas du tout allé mollo.
.
“Mad God” est disponible en Blu-Ray et DVD chez Carlotta Films
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © Carlotta Films / Phil Tippett
.
John Wick : Chapitre 4 de Chad Stahelski
Top Shot’Em Up Massacre
par Elie Katz
 Comme dans un jeu vidéo. La qualité d’une réalisation repose beaucoup dans sa capacité à nous faire ressentir quelque chose de précis par l’image. Un souvenir, une émotion, une ambiance. Quelque chose de subtil qui vous atteint à retardement, ou, comme ici, quelque chose d’évident qui vous subjugue d’exactitude. Le contexte déjà. Un John Wick, c’est physique. Mouvements rapides de personnes ou de caméras, musique entraînante, montage incisif, impacts à couper le souffle… Après une heure de ces extraordinaires séquences de cascades plus originales les unes que les autres, John Wick ayant déjà tué trois quarts de l’organisation qui le poursuit et probablement la moitié de la population de Paris, on est en droit de s’attendre à une pause. Mais non. C’est alors que nos défenses sont déjà réduites à néant que Chad Stalheski, Chad parmi les Chad, nous frappe avec ce plan-séquence époustouflant. John Wick pénètre un vieil immeuble parisien montmartrois à l’abandon, poursuivi par une bande d’assassins aux fusils à projectiles enflammés. On pense juste à un nouveau champ de bataille, à une simple étape de plus pour arriver à son objectif, le parvis du Sacré Coeur. Et soudain, la caméra s’élève. Plan large qui passe progressivement en vue zénithale. Points d’accès, zones de repli, parcours possibles, dangers approchants… Tout l’espace de l’étage devient clair, comme dans un jeu vidéo. Il ne manque plus que la barre de vie et le compteur de munitions dans les coins de l’écran. Et pas n’importe quel jeu, la franchise honorant toujours jusqu’au bout ses références : Hong Kong Massacre de Vreski (2019), un Hotline Miami-like (Dennaton Games, 2012). Des jeux, eux-mêmes inspirés de classiques d’action, où un personnage-joueur doit éliminer vagues après vagues de maffieux russes ou chinois dans des appartements resserrés. Stalheski parvient donc à pleinement saisir la sensation d’adrénaline montante et de stress permanent du jeu vidéo, couplant la perfection de ce cadre lent suivant son instoppable héros, toujours central, à une impeccable chorégraphie, ridiculement violente et imaginative. À cette prouesse, le roi de l’action ajoute une maîtrise remarquable de la lumière et du décor, comme s’il avait été game designer toute sa vie. Quelques points chauds et lumières extérieures suffisent à nous présenter cet appartement luxueux en ruines, jonchés d’obstacles, de projectiles et de poussière virvoletant à chaque chute, tir et explosions. On ne pourrait pas perdre une miette de ce ballet de mouvement, même si on le voulait. Pour couronner le tout, dans une ultime bravade au réalisme bien digne de la franchise, Stalheski pousse l’hommage en reproduisant ces trajectoires de tir de pétoire propre aux jeux dont il s’inspire. Des tirs incandescents, soudains et éclatant, éclairant le décor, l’écran et la salle comme un spectacle de feux d’artifices. Les mâchoires des sbires ne sont pas les seules à s’être fait éclater ce jour-là.
Comme dans un jeu vidéo. La qualité d’une réalisation repose beaucoup dans sa capacité à nous faire ressentir quelque chose de précis par l’image. Un souvenir, une émotion, une ambiance. Quelque chose de subtil qui vous atteint à retardement, ou, comme ici, quelque chose d’évident qui vous subjugue d’exactitude. Le contexte déjà. Un John Wick, c’est physique. Mouvements rapides de personnes ou de caméras, musique entraînante, montage incisif, impacts à couper le souffle… Après une heure de ces extraordinaires séquences de cascades plus originales les unes que les autres, John Wick ayant déjà tué trois quarts de l’organisation qui le poursuit et probablement la moitié de la population de Paris, on est en droit de s’attendre à une pause. Mais non. C’est alors que nos défenses sont déjà réduites à néant que Chad Stalheski, Chad parmi les Chad, nous frappe avec ce plan-séquence époustouflant. John Wick pénètre un vieil immeuble parisien montmartrois à l’abandon, poursuivi par une bande d’assassins aux fusils à projectiles enflammés. On pense juste à un nouveau champ de bataille, à une simple étape de plus pour arriver à son objectif, le parvis du Sacré Coeur. Et soudain, la caméra s’élève. Plan large qui passe progressivement en vue zénithale. Points d’accès, zones de repli, parcours possibles, dangers approchants… Tout l’espace de l’étage devient clair, comme dans un jeu vidéo. Il ne manque plus que la barre de vie et le compteur de munitions dans les coins de l’écran. Et pas n’importe quel jeu, la franchise honorant toujours jusqu’au bout ses références : Hong Kong Massacre de Vreski (2019), un Hotline Miami-like (Dennaton Games, 2012). Des jeux, eux-mêmes inspirés de classiques d’action, où un personnage-joueur doit éliminer vagues après vagues de maffieux russes ou chinois dans des appartements resserrés. Stalheski parvient donc à pleinement saisir la sensation d’adrénaline montante et de stress permanent du jeu vidéo, couplant la perfection de ce cadre lent suivant son instoppable héros, toujours central, à une impeccable chorégraphie, ridiculement violente et imaginative. À cette prouesse, le roi de l’action ajoute une maîtrise remarquable de la lumière et du décor, comme s’il avait été game designer toute sa vie. Quelques points chauds et lumières extérieures suffisent à nous présenter cet appartement luxueux en ruines, jonchés d’obstacles, de projectiles et de poussière virvoletant à chaque chute, tir et explosions. On ne pourrait pas perdre une miette de ce ballet de mouvement, même si on le voulait. Pour couronner le tout, dans une ultime bravade au réalisme bien digne de la franchise, Stalheski pousse l’hommage en reproduisant ces trajectoires de tir de pétoire propre aux jeux dont il s’inspire. Des tirs incandescents, soudains et éclatant, éclairant le décor, l’écran et la salle comme un spectacle de feux d’artifices. Les mâchoires des sbires ne sont pas les seules à s’être fait éclater ce jour-là.
.
.
.
.
“John Wick : Chapitre 4” est disponible
en 4K UHD, Blu-Ray et DVD chez Metropolitan Film Export
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © Metropolitan
.
.
Pearl de Ti West
Une perle dans un écrin
par Joris Laquittant
 L’an dernier, bien après tout le monde, la France découvrait en salles le phénomène X (Ti West, 2022) qui fit beaucoup parler et à juste titre, tant il parvenait à reconnecter admirablement avec un cinéma d’horreur « à l’ancienne » – bien aidé par ses atours seventies, rendant hommage à un cinéma érotique et horrifique d’exploitation comme on en faisait plus. Incarnant un double rôle, celui d’une jeune star de porno amateur et d’une vieille fermière frustrée sexuellement, Mia Goth imprégnait la rétine, s’imposant comme l’une des actrices sur qui il fallait nécessairement garder l’œil à l’avenir. Cette année, le prequel de X intitulé Pearl (Ti West, 2023) nous est parvenu directement en vidéo, une anomalie puisqu’il semble unanimement salué comme plus dense et maîtrisé que son prédécesseur. Deuxième volet d’un prometteur triptyque, il entend raconter l’origine du personnage de cette vieille fermière, Pearl donc, et son parcours chaotique de serial-killeuse. Fait non anodin, ce deuxième volet est co-scénarisé par son actrice. Même s’il est difficile de prétendre connaître ou deviner les coulisses de l’écriture du scénario, il semble assez clair que celui-ci est tout entier pensé comme un écrin pour la jeune comédienne, tant il lui offre une matière exceptionnelle pour une interprétation habitée, aussi subtile que débordante. La séquence qui nous intéresse ici est certainement la plus significative. Monologue en plan séquence de huit minutes, cette scène se déroule dans le dernier tiers du long-métrage alors qu’une amie de Pearl vient lui rendre visite chez elle. Ce que ne sait pas (encore) cette amie, c’est que la maison est jonchée de cadavres et que Pearl s’est livrée à un véritable massacre les jours passés, s’embourbant dans une entreprise de lâcher prise et d’hors contrôle démentiel. Face à son amie elle se livre alors à cœur et esprit ouverts, comme au confesse d’une église, larmes à l’œil et rage au creux de la gorge, témoignant de son incompréhension du monde et de la façon dont celui-ci la juge et la voit, notamment les hommes. La frontalité de la mise en scène est un écrin d’orfèvrerie pour la jeune comédienne qui soutient sur ses épaules le poids entier de cette séquence, sans artifice aucun, nue face au texte, livrée en pâture aux regards des spectateurs comme sur une scène de théâtre. Mia Goth maîtrise de bout en bout ce monologue (qu’elle s’est peut-être elle même écrit) faisant montre d’une puissance d’incarnation qui pourrait tomber dans la démonstration voire la bande-démo de comédienne. Mais c’est parce que l’on est chargés de tout le passif émotionnel du film que cette longueur et cette radicalité, de même que cette épiphanie émotionnelle souvent débordante, nous touchent et nous embarquent. Car derrière ces larmes, ce menton qui vibre, ces lèvres qui tremblent, Goth nous offre plus qu’une performance : elle donne accès comme rarement à l’intime d’un personnage, aussi riche qu’insaisissable. Car si Pearl dissèque, une heure trente durant, la psychologie de Pearl, celle-ci nous semble toujours quelque peu insaisissable, tout juste un outil d’analyse, comme souvent quand on essaie de comprendre l’incompréhensible. L’humanité candide qui émane de ce long monologue confessionnel nous touche tant parce qu’il parvient à nous faire comprendre le monstre, voire à se reconnaître en lui. C’est une prouesse rare, de même, que de parvenir à maintenir en haleine et à l’écoute huit minutes durant le spectateur, aimanté au visage d’une comédienne. Ceux qui savent m’accuseront sûrement de chauvinisme, mais de mémoire récente on a pas ressenti pareil vertige face à un monologue depuis celui d’Ana Neborak dans De l’or pour les chiens (Anna Cazenave Cambet, 2020) donc le texte partage par ailleurs beaucoup de similitudes avec celui qui est ici déclamé. Si ces séquences peuvent parfois sembler donner carte blanche à leurs interprètes au point de soupçonner le ou la cinéaste de s’effacer derrière la performance d’acteur – pourquoi pas d’être eux-mêmes spectateurs de leurs séquences – elles sont au contraire le témoignage d’une radicalité et d’un courage de ces derniers à oser faire reposer des moments si charnière du récit sur pareille prise de risque. Pour parvenir à cet accomplissement, il ne faut pas seulement une comédienne en état de grâce, il faut aussi un ou une cinéaste qui a borné suffisamment le terrain en amont pour permettre cet instant suspendu, le rendre possible et acceptable. Le cas présent, ce long monologue de huit minutes consacre et confirme, bien sûr, Mia Goth comme l’une des plus grandes révélations de ces dernières années, mais marque aussi un virage bénéfique dans la carrière de Ti West qui, d’habile faiseur à ses débuts, s’affirme de plus en plus comme un cinéaste au point de vue et à la mise en scène dont la singularité et la maîtrise sont en tel déploiement qu’on ne saurait que se réjouir du devenir de sa filmographie.
L’an dernier, bien après tout le monde, la France découvrait en salles le phénomène X (Ti West, 2022) qui fit beaucoup parler et à juste titre, tant il parvenait à reconnecter admirablement avec un cinéma d’horreur « à l’ancienne » – bien aidé par ses atours seventies, rendant hommage à un cinéma érotique et horrifique d’exploitation comme on en faisait plus. Incarnant un double rôle, celui d’une jeune star de porno amateur et d’une vieille fermière frustrée sexuellement, Mia Goth imprégnait la rétine, s’imposant comme l’une des actrices sur qui il fallait nécessairement garder l’œil à l’avenir. Cette année, le prequel de X intitulé Pearl (Ti West, 2023) nous est parvenu directement en vidéo, une anomalie puisqu’il semble unanimement salué comme plus dense et maîtrisé que son prédécesseur. Deuxième volet d’un prometteur triptyque, il entend raconter l’origine du personnage de cette vieille fermière, Pearl donc, et son parcours chaotique de serial-killeuse. Fait non anodin, ce deuxième volet est co-scénarisé par son actrice. Même s’il est difficile de prétendre connaître ou deviner les coulisses de l’écriture du scénario, il semble assez clair que celui-ci est tout entier pensé comme un écrin pour la jeune comédienne, tant il lui offre une matière exceptionnelle pour une interprétation habitée, aussi subtile que débordante. La séquence qui nous intéresse ici est certainement la plus significative. Monologue en plan séquence de huit minutes, cette scène se déroule dans le dernier tiers du long-métrage alors qu’une amie de Pearl vient lui rendre visite chez elle. Ce que ne sait pas (encore) cette amie, c’est que la maison est jonchée de cadavres et que Pearl s’est livrée à un véritable massacre les jours passés, s’embourbant dans une entreprise de lâcher prise et d’hors contrôle démentiel. Face à son amie elle se livre alors à cœur et esprit ouverts, comme au confesse d’une église, larmes à l’œil et rage au creux de la gorge, témoignant de son incompréhension du monde et de la façon dont celui-ci la juge et la voit, notamment les hommes. La frontalité de la mise en scène est un écrin d’orfèvrerie pour la jeune comédienne qui soutient sur ses épaules le poids entier de cette séquence, sans artifice aucun, nue face au texte, livrée en pâture aux regards des spectateurs comme sur une scène de théâtre. Mia Goth maîtrise de bout en bout ce monologue (qu’elle s’est peut-être elle même écrit) faisant montre d’une puissance d’incarnation qui pourrait tomber dans la démonstration voire la bande-démo de comédienne. Mais c’est parce que l’on est chargés de tout le passif émotionnel du film que cette longueur et cette radicalité, de même que cette épiphanie émotionnelle souvent débordante, nous touchent et nous embarquent. Car derrière ces larmes, ce menton qui vibre, ces lèvres qui tremblent, Goth nous offre plus qu’une performance : elle donne accès comme rarement à l’intime d’un personnage, aussi riche qu’insaisissable. Car si Pearl dissèque, une heure trente durant, la psychologie de Pearl, celle-ci nous semble toujours quelque peu insaisissable, tout juste un outil d’analyse, comme souvent quand on essaie de comprendre l’incompréhensible. L’humanité candide qui émane de ce long monologue confessionnel nous touche tant parce qu’il parvient à nous faire comprendre le monstre, voire à se reconnaître en lui. C’est une prouesse rare, de même, que de parvenir à maintenir en haleine et à l’écoute huit minutes durant le spectateur, aimanté au visage d’une comédienne. Ceux qui savent m’accuseront sûrement de chauvinisme, mais de mémoire récente on a pas ressenti pareil vertige face à un monologue depuis celui d’Ana Neborak dans De l’or pour les chiens (Anna Cazenave Cambet, 2020) donc le texte partage par ailleurs beaucoup de similitudes avec celui qui est ici déclamé. Si ces séquences peuvent parfois sembler donner carte blanche à leurs interprètes au point de soupçonner le ou la cinéaste de s’effacer derrière la performance d’acteur – pourquoi pas d’être eux-mêmes spectateurs de leurs séquences – elles sont au contraire le témoignage d’une radicalité et d’un courage de ces derniers à oser faire reposer des moments si charnière du récit sur pareille prise de risque. Pour parvenir à cet accomplissement, il ne faut pas seulement une comédienne en état de grâce, il faut aussi un ou une cinéaste qui a borné suffisamment le terrain en amont pour permettre cet instant suspendu, le rendre possible et acceptable. Le cas présent, ce long monologue de huit minutes consacre et confirme, bien sûr, Mia Goth comme l’une des plus grandes révélations de ces dernières années, mais marque aussi un virage bénéfique dans la carrière de Ti West qui, d’habile faiseur à ses débuts, s’affirme de plus en plus comme un cinéaste au point de vue et à la mise en scène dont la singularité et la maîtrise sont en tel déploiement qu’on ne saurait que se réjouir du devenir de sa filmographie.
“Pearl” est disponible
en Blu-Ray et DVD chez Universal Pictures
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © A24 / Universal Pictures
Spider-Man : Across the spider-verse
de Kemp Powers, Joaquim Dos Santos & Justin K. Thompson
Un méchant qui ne fait pas Tâche
par Kevin Robic
 Difficile de choisir une séquence en particulier dans un film aussi foisonnant que Spider-Man : Across the Spider-Verse, pourtant l’une aura retenu toute l’attention de l’auteur de ses lignes pour plusieurs raisons. D’abord pour ce qu’elle est, et nous allons y revenir en détails, mais aussi pour ce qu’elle souligne comme fossé entre cette bonne adaptation de Marvel par Sony et le néant du tout-venant que nous propose le MCU de chez Disney. Il s’agit de la séquence où après avoir visité les possibilités du multiverse, Miles Morales retrouve son ennemi La Tâche, à l’exact milieu du film. Dans cette scène, La Tâche explique tout simplement à Spider-Man qu’il va tout lui prendre, comme le héros, par dommage collatéral, lui a tout pris. De la simplicité d’une telle situation – un méchant expliquant au gentil son plan – Kemp Powers, Joaquim Dos Santos et Justin K. Thompson, les réalisateurs, tirent un pur moment de cinéma où tout participe au frisson. La mise en scène, en premier lieu, qui dans sa folie visuelle offre des cadres et des images invraisemblables, est de toute beauté. L’animation oscillant entre traditionnel quand on entrevoit les origines du méchant, et une forme hybride 2D/3D, on baigne dans une atmosphère quasiment horrifique. Elle est sublimée par la musique inquiétante de Daniel Pemberton, qui à la faveur d’un temps mort, impose un moment d’épouvante à la fois pour Miles Morales, mais aussi pour le spectateur qui ressent une véritable inquiétude. Enfin, le doublage de La Tâche, qu’il s’agisse de la version originale ou française, de Jason Schwartzman ou de Jean-Christophe Dollé, offre une vraie texture et une réelle intensité au personnage jusque-là quelque peu ridiculisé. Et c’est là que la séquence impressionne tant elle sert par surprise un antagoniste d’exception. Elle prend alors l’exact contrepied de ce que fait Marvel avec son Cinematic Universe fait de promesses quant aux bad guys proposés et d’autant de déceptions face à leurs traitements. Pour un Thanos qui s’en est plutôt bien tiré après des années de teasing, combien de vilains sont tombés sous les balles du cocktail humour lourdingue/écriture paresseuse/fin bâclée ? Loki, Crossbones, Le Mandarin, Ego, Crâne Rouge, etc. Des promesses terminant en pétards mouillés. Alors que dans Across the Spider-Verse, La Tâche a une trajectoire totalement inversée. Le personnage est d’abord moqué pour la faiblesse et l’incongruité de ses pouvoirs pour finalement, à la faveur de cette séquence génialement mise en images, devenir une menace tangible et inattendue. C’est bien simple, à la vision de cette scène, votre serviteur a eu les poils de bras qui se sont dressés et la sensation qu’enfin, nous allions avoir le droit à un méchant d’exception, promis à un affrontement dantesque dans le prochain Beyond the Spider-Verse. Le catalogue de méchants est particulièrement fourni en ce qui concerne Spider-Man ; et jusqu’à l’indigestion No Way Home, le cinéma s’est toujours servi des plus connus pour les mettre sur la route du tisseur. En prenant un bad guy parfaitement inconnu du grand public, les réalisateurs prouvent que le MCU a tout faux. Et La Tâche ayant le pouvoir de voyager d’univers en univers, il est permis de penser que ce soit potentiellement un pied de nez à la saga du Multiverse que Disney est en train de rater dans les grandes largeurs, à l’heure où nous écrivons cet article. Si une scène peut synthétiser à la fois la puissance de Spider-Man : Across the Spider-Verse et le tour de force qu’il représente face au reste de la production super héroïque, c’est bien celle-ci. Un pur shoot de cinéma concentré dans une seule scène, comme les studios en produisent trop peu où tous les ingrédients – musique, visuel et interprétation – se mêlent dans un tourbillon que seul le générique de fin du film saura interrompre. On y repense des heures, des semaines, des mois après. Gageons que cette courte séquence d’à peine trente secondes nous hantera encore des années, quand l’âge d’or des super-héros au cinéma sera révolu…
Difficile de choisir une séquence en particulier dans un film aussi foisonnant que Spider-Man : Across the Spider-Verse, pourtant l’une aura retenu toute l’attention de l’auteur de ses lignes pour plusieurs raisons. D’abord pour ce qu’elle est, et nous allons y revenir en détails, mais aussi pour ce qu’elle souligne comme fossé entre cette bonne adaptation de Marvel par Sony et le néant du tout-venant que nous propose le MCU de chez Disney. Il s’agit de la séquence où après avoir visité les possibilités du multiverse, Miles Morales retrouve son ennemi La Tâche, à l’exact milieu du film. Dans cette scène, La Tâche explique tout simplement à Spider-Man qu’il va tout lui prendre, comme le héros, par dommage collatéral, lui a tout pris. De la simplicité d’une telle situation – un méchant expliquant au gentil son plan – Kemp Powers, Joaquim Dos Santos et Justin K. Thompson, les réalisateurs, tirent un pur moment de cinéma où tout participe au frisson. La mise en scène, en premier lieu, qui dans sa folie visuelle offre des cadres et des images invraisemblables, est de toute beauté. L’animation oscillant entre traditionnel quand on entrevoit les origines du méchant, et une forme hybride 2D/3D, on baigne dans une atmosphère quasiment horrifique. Elle est sublimée par la musique inquiétante de Daniel Pemberton, qui à la faveur d’un temps mort, impose un moment d’épouvante à la fois pour Miles Morales, mais aussi pour le spectateur qui ressent une véritable inquiétude. Enfin, le doublage de La Tâche, qu’il s’agisse de la version originale ou française, de Jason Schwartzman ou de Jean-Christophe Dollé, offre une vraie texture et une réelle intensité au personnage jusque-là quelque peu ridiculisé. Et c’est là que la séquence impressionne tant elle sert par surprise un antagoniste d’exception. Elle prend alors l’exact contrepied de ce que fait Marvel avec son Cinematic Universe fait de promesses quant aux bad guys proposés et d’autant de déceptions face à leurs traitements. Pour un Thanos qui s’en est plutôt bien tiré après des années de teasing, combien de vilains sont tombés sous les balles du cocktail humour lourdingue/écriture paresseuse/fin bâclée ? Loki, Crossbones, Le Mandarin, Ego, Crâne Rouge, etc. Des promesses terminant en pétards mouillés. Alors que dans Across the Spider-Verse, La Tâche a une trajectoire totalement inversée. Le personnage est d’abord moqué pour la faiblesse et l’incongruité de ses pouvoirs pour finalement, à la faveur de cette séquence génialement mise en images, devenir une menace tangible et inattendue. C’est bien simple, à la vision de cette scène, votre serviteur a eu les poils de bras qui se sont dressés et la sensation qu’enfin, nous allions avoir le droit à un méchant d’exception, promis à un affrontement dantesque dans le prochain Beyond the Spider-Verse. Le catalogue de méchants est particulièrement fourni en ce qui concerne Spider-Man ; et jusqu’à l’indigestion No Way Home, le cinéma s’est toujours servi des plus connus pour les mettre sur la route du tisseur. En prenant un bad guy parfaitement inconnu du grand public, les réalisateurs prouvent que le MCU a tout faux. Et La Tâche ayant le pouvoir de voyager d’univers en univers, il est permis de penser que ce soit potentiellement un pied de nez à la saga du Multiverse que Disney est en train de rater dans les grandes largeurs, à l’heure où nous écrivons cet article. Si une scène peut synthétiser à la fois la puissance de Spider-Man : Across the Spider-Verse et le tour de force qu’il représente face au reste de la production super héroïque, c’est bien celle-ci. Un pur shoot de cinéma concentré dans une seule scène, comme les studios en produisent trop peu où tous les ingrédients – musique, visuel et interprétation – se mêlent dans un tourbillon que seul le générique de fin du film saura interrompre. On y repense des heures, des semaines, des mois après. Gageons que cette courte séquence d’à peine trente secondes nous hantera encore des années, quand l’âge d’or des super-héros au cinéma sera révolu…
“Spider-Man : Across the Spiderverse”
est disponible en location et achat VOD
Crédit Photo © Sony Pictures Animation
.
Donjons & Dragons de Jonathan Goldstein & John F. Dailey
Réveiller les morts
par Clément Levassort
 Edgin (Chris Pine) et son équipe de voleurs sont à la recherche du heaume de disjonction, un artefact magique, disparu il y a bien longtemps durant la bataille des Evermoors. Le seul moyen d’en retrouver la trace ? Ressusciter les soldats morts au combat à l’aide d’un sort, et leur demander gentiment où se trouve l’artefact magique ! Mais attention, le sortilège n’est que temporaire. Passées cinq questions, les revenants plongeront à nouveau dans un sommeil éternel. Durant cette séquence, située aux deux tiers du film, les scénaristes et réalisateurs Dayler et Goldsteine détournent une péripétie intermédiaire aux enjeux purement narratifs en un pur moment de comédie. Lors du premier interrogatoire, la communication avec le soldat mort-vivant est d’emblée parasitée par les règles confuses du sortilège qui occasionnent quiproquos et incompréhension. L’humour absurde façon Monty Python Sacrée Graal (Terry Giliam et Terry Jones, 1975) désamorce au passage l’atmosphère horrifique posée dès les premiers plans, d’autant que les soldats se révèlent être de parfaits gentlemen ! Une mécanique de répétition/variation s’installe avec l’interrogatoire d’un deuxième revenant qui active cette fois un récit en flash-back. La bataille des Evermoors prend alors vie sous nos yeux grâce à un habile fondu enchaîné qui nous jette dans la fureur des combats. Le récit du soldat en voix off accompagne les images avec emphase, mais à peine le voit-on récupérer le précieux heaume qu’un cavalier surgit de nulle part le tranche en deux, abrégeant brutalement son récit. Le gag sera répété plusieurs fois avec quelques variations mais toujours la même intention : quelles que soient les modalités formelles, la progression narrative sera volontairement freinée pour multiplier l’effet comique. Plus étonnant, là où l’on pourrait craindre une mise à distance du spectateur, la déconstruction méta de la narration donne au contraire de la consistance aux péripéties. Et puis la séquence est enrichie par d’autres procédés comiques. Les mises à mort des soldats reprennent les codes du burlesque avec un filmage en plans longs qui spatialise l’action et fait surgir le gag de la profondeur de champ (le chevalier qui découpe le soldat) ou du hors champ (la flèche en pleine tête). Le heaume passe de main en main dans une sorte de course de relais, mêlant action et comédie jusqu’à l’indistinction et dégonfle au passage la gravité du genre épique. Durant près de sept minutes de haute intensité, la séquence nous aura fait passer par tous les genres et modalités comiques avec grâce à un montage d’une fluidité déconcertante qui épouse le rythme de l’écriture et use de tous les outils formels à disposition : plans de coupes rapides sur les coups de pelles pour passer d’un interrogatoire à un autre, ellipse et effets de transition multiples qui nous font naviguer sans effort dans l’espace et le temps. Pas de doute, Donjons & dragons : l’honneur des voleurs est bien la comédie de l’année !
Edgin (Chris Pine) et son équipe de voleurs sont à la recherche du heaume de disjonction, un artefact magique, disparu il y a bien longtemps durant la bataille des Evermoors. Le seul moyen d’en retrouver la trace ? Ressusciter les soldats morts au combat à l’aide d’un sort, et leur demander gentiment où se trouve l’artefact magique ! Mais attention, le sortilège n’est que temporaire. Passées cinq questions, les revenants plongeront à nouveau dans un sommeil éternel. Durant cette séquence, située aux deux tiers du film, les scénaristes et réalisateurs Dayler et Goldsteine détournent une péripétie intermédiaire aux enjeux purement narratifs en un pur moment de comédie. Lors du premier interrogatoire, la communication avec le soldat mort-vivant est d’emblée parasitée par les règles confuses du sortilège qui occasionnent quiproquos et incompréhension. L’humour absurde façon Monty Python Sacrée Graal (Terry Giliam et Terry Jones, 1975) désamorce au passage l’atmosphère horrifique posée dès les premiers plans, d’autant que les soldats se révèlent être de parfaits gentlemen ! Une mécanique de répétition/variation s’installe avec l’interrogatoire d’un deuxième revenant qui active cette fois un récit en flash-back. La bataille des Evermoors prend alors vie sous nos yeux grâce à un habile fondu enchaîné qui nous jette dans la fureur des combats. Le récit du soldat en voix off accompagne les images avec emphase, mais à peine le voit-on récupérer le précieux heaume qu’un cavalier surgit de nulle part le tranche en deux, abrégeant brutalement son récit. Le gag sera répété plusieurs fois avec quelques variations mais toujours la même intention : quelles que soient les modalités formelles, la progression narrative sera volontairement freinée pour multiplier l’effet comique. Plus étonnant, là où l’on pourrait craindre une mise à distance du spectateur, la déconstruction méta de la narration donne au contraire de la consistance aux péripéties. Et puis la séquence est enrichie par d’autres procédés comiques. Les mises à mort des soldats reprennent les codes du burlesque avec un filmage en plans longs qui spatialise l’action et fait surgir le gag de la profondeur de champ (le chevalier qui découpe le soldat) ou du hors champ (la flèche en pleine tête). Le heaume passe de main en main dans une sorte de course de relais, mêlant action et comédie jusqu’à l’indistinction et dégonfle au passage la gravité du genre épique. Durant près de sept minutes de haute intensité, la séquence nous aura fait passer par tous les genres et modalités comiques avec grâce à un montage d’une fluidité déconcertante qui épouse le rythme de l’écriture et use de tous les outils formels à disposition : plans de coupes rapides sur les coups de pelles pour passer d’un interrogatoire à un autre, ellipse et effets de transition multiples qui nous font naviguer sans effort dans l’espace et le temps. Pas de doute, Donjons & dragons : l’honneur des voleurs est bien la comédie de l’année !
.
“Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs”
est disponible en Blu-Ray et DVD chez Paramount
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © Paramount Pictures
..
.
Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold
Chirurgie pas esthétique
par Kevin Robic
 Tous les volets de la saga Indiana Jones ont soigné leur introduction. Amazonienne, jamesbondienne, fordienne ou décriée à cause d’un frigidaire, chaque ouverture de ces films est un pur moment de cinéma, et une occasion d’introduire le personnage titre de manière originale. C’est dire si ce Cadran de la destinée avait fort à faire pour ne serait-ce qu’égaler l’intro du quatrième épisode de 2008. Dès les premiers coups de manivelle, la rumeur d’un voyage dans le temps ou d’un flashback enflait comme un ballon sur internet, et les premiers outils promotionnels allaient le confirmer : oui Harrison Ford allait être rajeuni numériquement pour ce cinquième film. Et c’est bien dans la séquence introductive que ce de-aging a lieu, comme pour raccrocher les wagons, suite au départ de Spielberg, aux racines de la franchise. La scène en elle-même n’est pas un morceau de bravoure ni une grande entrée en matière, mais elle est intéressante à plusieurs points de vue. Pour l’exploit – ou le non exploit, c’est selon – de faire revenir un Harrison Ford cinquantenaire à l’écran en 2023. Mais surtout, pour la mise en perspective avec l’autre grande scène de flashback de La Dernière croisade, où River Phoenix incarnait un jeune Indy. Dans cette séquence devenue mythique, nous avions le droit à un condensé de ce qui allait faire de Henry Jones Jr. le Indiana Jones que l’on connait, à la faveur d’une succession de péripéties racontant en filigrane ce qui allait attendre notre héros au cours de ce troisième film. En 1989, les effets visuels étaient “pratiques” et la scène en était tout à fait organique. En 2023, les effets visuels sont depuis trente ans majoritairement numériques et c’est tout une page de l’Histoire du Cinéma qui se tourne. Déjà en 2008, l’apport des CGI posait problème et question sur l’anachronisme d’un tel personnage dans un déferlement de pixels. Aujourd’hui, Harrison Ford est octogénaire et la seule façon qu’aura trouvé Disney pour faire revivre la magie est bel et bien d’user des artifices les plus grossiers. La séquence commençait déjà mal ; le logo de la Paramount ne se fondant plus à un élément de la scène comme d’habitude. Ici, pas de jeux d’ombres et de lumières auxquels Spielberg nous avait habitué, révélant Indiana progressivement, Mangold préfère nous jeter l’exploit technologique au visage en faisant du plan où Ford est découvert, le plus long des vingt premières minutes. Le mystère est parti, la performance des animateurs prévaut. Et de l’animation, c’est bien cela à quoi nous assistons tant les visages de tous les personnages semblent désincarnés et lissés pour coller au rajeunissement du héros. Ainsi l’officier nazi qui interroge Indy semble lui aussi être rajeuni alors que pas du tout ! Même le pauvre Mads Mikkelsen est affublé d’un maquillage numérique très suspect. La séquence enchaine avec un Indiana Jones suspendu au bout d’une corde dont il arrive forcément à se tirer dans un déluge, là encore, d’explosions en CGI. S’en suit une course poursuite en voiture puis en side-car, clin d’œil à La Dernière croisade, où le héros arrive à rejoindre un train où se trouve son ami et le futur MacGuffin du film, en rapport avec le temps – les leaks n’avaient décidément pas menti ! La doublure numérique d’Indiana court sur le toit du train et c’est sur ce plan, l’un des plus moches du film à cause de la gestuelle totalement artificielle du personnage, que le réalisateur a décidé de faire retentir pour la première fois le thème musical emblématique. Après quelques situations plus ou moins drôles, Jones retrouve ses apparats et un plan assez long, encore, nous montre notre héros tel qu’on l’aime, chapeau vissé sur la tête, veste de cuir et lasso à la ceinture. Mais là encore, quelque chose cloche, l’artifice est trop visible. La scène se conclut par un affrontement entre le futur vilain du long-métrage et Indiana Jones. Cette scène, dans sa construction, sa conclusion et sa raison d’être rappelle vraiment l’introduction du troisième film. Mais en trente-cinq ans, ce côté organique qui faisait encore le charme des productions de l’époque a laissé place à un déluge d’effets visuels qui nous interroge sur la nature même de Disney. Le studio est-il devenu Frankenstein en assemblant et en réanimant des morceaux épars de nos souvenirs de cinéma parmi les plus beaux ? Fallait-il plus de plans truqués que dans l’ensemble des trois premiers films pour faire revivre la magie ? Y sont-ils seulement parvenu ? Comme pour la postlogie Star Wars, les efforts de Disney semblent nous pousser à réévaluer ce que l’on estimait être des ratages de Tonton George dans les années 2000. Le coup du frigo, ce n’était peut-être pas si mal, non ?
Tous les volets de la saga Indiana Jones ont soigné leur introduction. Amazonienne, jamesbondienne, fordienne ou décriée à cause d’un frigidaire, chaque ouverture de ces films est un pur moment de cinéma, et une occasion d’introduire le personnage titre de manière originale. C’est dire si ce Cadran de la destinée avait fort à faire pour ne serait-ce qu’égaler l’intro du quatrième épisode de 2008. Dès les premiers coups de manivelle, la rumeur d’un voyage dans le temps ou d’un flashback enflait comme un ballon sur internet, et les premiers outils promotionnels allaient le confirmer : oui Harrison Ford allait être rajeuni numériquement pour ce cinquième film. Et c’est bien dans la séquence introductive que ce de-aging a lieu, comme pour raccrocher les wagons, suite au départ de Spielberg, aux racines de la franchise. La scène en elle-même n’est pas un morceau de bravoure ni une grande entrée en matière, mais elle est intéressante à plusieurs points de vue. Pour l’exploit – ou le non exploit, c’est selon – de faire revenir un Harrison Ford cinquantenaire à l’écran en 2023. Mais surtout, pour la mise en perspective avec l’autre grande scène de flashback de La Dernière croisade, où River Phoenix incarnait un jeune Indy. Dans cette séquence devenue mythique, nous avions le droit à un condensé de ce qui allait faire de Henry Jones Jr. le Indiana Jones que l’on connait, à la faveur d’une succession de péripéties racontant en filigrane ce qui allait attendre notre héros au cours de ce troisième film. En 1989, les effets visuels étaient “pratiques” et la scène en était tout à fait organique. En 2023, les effets visuels sont depuis trente ans majoritairement numériques et c’est tout une page de l’Histoire du Cinéma qui se tourne. Déjà en 2008, l’apport des CGI posait problème et question sur l’anachronisme d’un tel personnage dans un déferlement de pixels. Aujourd’hui, Harrison Ford est octogénaire et la seule façon qu’aura trouvé Disney pour faire revivre la magie est bel et bien d’user des artifices les plus grossiers. La séquence commençait déjà mal ; le logo de la Paramount ne se fondant plus à un élément de la scène comme d’habitude. Ici, pas de jeux d’ombres et de lumières auxquels Spielberg nous avait habitué, révélant Indiana progressivement, Mangold préfère nous jeter l’exploit technologique au visage en faisant du plan où Ford est découvert, le plus long des vingt premières minutes. Le mystère est parti, la performance des animateurs prévaut. Et de l’animation, c’est bien cela à quoi nous assistons tant les visages de tous les personnages semblent désincarnés et lissés pour coller au rajeunissement du héros. Ainsi l’officier nazi qui interroge Indy semble lui aussi être rajeuni alors que pas du tout ! Même le pauvre Mads Mikkelsen est affublé d’un maquillage numérique très suspect. La séquence enchaine avec un Indiana Jones suspendu au bout d’une corde dont il arrive forcément à se tirer dans un déluge, là encore, d’explosions en CGI. S’en suit une course poursuite en voiture puis en side-car, clin d’œil à La Dernière croisade, où le héros arrive à rejoindre un train où se trouve son ami et le futur MacGuffin du film, en rapport avec le temps – les leaks n’avaient décidément pas menti ! La doublure numérique d’Indiana court sur le toit du train et c’est sur ce plan, l’un des plus moches du film à cause de la gestuelle totalement artificielle du personnage, que le réalisateur a décidé de faire retentir pour la première fois le thème musical emblématique. Après quelques situations plus ou moins drôles, Jones retrouve ses apparats et un plan assez long, encore, nous montre notre héros tel qu’on l’aime, chapeau vissé sur la tête, veste de cuir et lasso à la ceinture. Mais là encore, quelque chose cloche, l’artifice est trop visible. La scène se conclut par un affrontement entre le futur vilain du long-métrage et Indiana Jones. Cette scène, dans sa construction, sa conclusion et sa raison d’être rappelle vraiment l’introduction du troisième film. Mais en trente-cinq ans, ce côté organique qui faisait encore le charme des productions de l’époque a laissé place à un déluge d’effets visuels qui nous interroge sur la nature même de Disney. Le studio est-il devenu Frankenstein en assemblant et en réanimant des morceaux épars de nos souvenirs de cinéma parmi les plus beaux ? Fallait-il plus de plans truqués que dans l’ensemble des trois premiers films pour faire revivre la magie ? Y sont-ils seulement parvenu ? Comme pour la postlogie Star Wars, les efforts de Disney semblent nous pousser à réévaluer ce que l’on estimait être des ratages de Tonton George dans les années 2000. Le coup du frigo, ce n’était peut-être pas si mal, non ?
“Indiana Jones et le cadran de la destinée”
est disponible en Blu-Ray et DVD chez Walt Disney Company
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © LucasFilm/ The Walt Disney Company
.
The Bear S02E06 – Fishes de Christopher Storer
Noël chez les Berzatto
par Andie
 En cette nuit de Noël, tout le clan Berzatto est attablé pour célébrer la traditionnelle Fête des Sept Poissons (Seven Fishes). Tout au long de l’épisode, fidèle au chaos propre à la famille – et à la série – la caméra nous balade de pièce en pièce, de conversation en conversation, enchaînant les gros plans tour à tour sur les visages des invités qui parlent tous.tes plus fort les un.es que les autres. Vient également s’ajouter au fond sonore le bruit du minuteur qui sonne à toute berzingue dans la cuisine, signalant les nombreuses étapes de la préparation du repas. Tout cela n’est qu’un long prélude à une monstrueuse crise d’angoisse en préparation. La tension monte d’un cran lorsque Mikey – le frère maudit que l’on apprend un peu plus à connaître dans cette seconde saison – lance sa fourchette sur l’oncle Lee (Bob Odenkirk en guest) qui menace de venir le remettre à sa place et lui répète qu’il n’est qu’un moins-que-rien. Comme un nid de frelons que l’on aurait secoué dans tous les sens, Mikey est au bord de l’implosion. C’est à cet instant que la matriarche, Donna ou Deedee pour les intimes (performance magistrale de Jamie Lee Curtis), vient enfin rejoindre tout le monde à table et le calme se réinstalle… Provisoirement. En effet, après avoir passé la journée entière en cuisine à se décarcasser pour préparer sept plats différents de fruits de mer et à boire du vin, Donna est, elle aussi, une vraie bombe à retardement. À peine le bénédicité est-il dit qu’elle se met à pleurer. Ce ne sont pas des larmes de joie, mais bien l’expression d’un complexe du martyr ou d’un trouble de la personnalité narcissique qui la caractérise. On a bien pris le temps de construire le portrait de cette figure maternelle étouffante tout au long de l’épisode : toute la famille s’empresse alors de la remercier pour ce repas et l’arrose de compliments. Peut-être cette soirée va-t-elle bien se passer après tout… C’était sans compter sur l’intervention de Natalie – aussi appelée Sugar, la sœur de Carmy et Mikey – qui ne peut s’empêcher de demander à sa mère si elle va bien. Des gros plans sur les visages crispés des membres de la famille nous indiquent qu’il s’agit d’une grosse erreur… Cette question d’apparence anodine fait immédiatement sortir Donna de ses gonds, qui se met alors à insulter tout le monde. La tension remonte à nouveau d’un cran. La caméra fait le tour des visages circonspects des invité.es, qui fuient son regard comme des enfants en train de se faire gronder. Une assiette vient se fracasser sur le sol. On bascule dans le drame. Donna sort de la pièce. Un silence s’installe l’espace de quelques secondes. Les visages sont figés. Quelques murmures se font entendre. L’oncle Lee tente de temporiser. Mikey choisit de profiter de cet instant pour proférer sa vengeance et lui lance une nouvelle fourchette dessus. Une bagarre éclate. La table est renversée, les cris fusent de toute part, l’assemblée se transforme en ménagerie. Alors que la tension semblait être à son comble, Donna vient mettre un point d’orgue à cette symphonie familiale dissonante en venant encastrer sa voiture dans le mur du salon. Le chaos est alors total. Sous les cris de Mikey, accompagnés d’un bruit strident, la caméra se concentre sur le visage inexpressif de Carmy qui fixe la fourchette de la discorde plantée dans les cannoli, avant de zoomer lentement sur l’expression de pure angoisse de Natalie. Cette séquence, qui nous replonge dans le passé de Carmy, avant tous les événements présentés dans le reste de la série, permet de nous éclairer sur de nombreux aspects de sa personnalité, notamment son rapport à la famille. Elle permet aussi aux créateurs de la série de s’essayer à l’exercice du drame familial, avec un certain brio.
En cette nuit de Noël, tout le clan Berzatto est attablé pour célébrer la traditionnelle Fête des Sept Poissons (Seven Fishes). Tout au long de l’épisode, fidèle au chaos propre à la famille – et à la série – la caméra nous balade de pièce en pièce, de conversation en conversation, enchaînant les gros plans tour à tour sur les visages des invités qui parlent tous.tes plus fort les un.es que les autres. Vient également s’ajouter au fond sonore le bruit du minuteur qui sonne à toute berzingue dans la cuisine, signalant les nombreuses étapes de la préparation du repas. Tout cela n’est qu’un long prélude à une monstrueuse crise d’angoisse en préparation. La tension monte d’un cran lorsque Mikey – le frère maudit que l’on apprend un peu plus à connaître dans cette seconde saison – lance sa fourchette sur l’oncle Lee (Bob Odenkirk en guest) qui menace de venir le remettre à sa place et lui répète qu’il n’est qu’un moins-que-rien. Comme un nid de frelons que l’on aurait secoué dans tous les sens, Mikey est au bord de l’implosion. C’est à cet instant que la matriarche, Donna ou Deedee pour les intimes (performance magistrale de Jamie Lee Curtis), vient enfin rejoindre tout le monde à table et le calme se réinstalle… Provisoirement. En effet, après avoir passé la journée entière en cuisine à se décarcasser pour préparer sept plats différents de fruits de mer et à boire du vin, Donna est, elle aussi, une vraie bombe à retardement. À peine le bénédicité est-il dit qu’elle se met à pleurer. Ce ne sont pas des larmes de joie, mais bien l’expression d’un complexe du martyr ou d’un trouble de la personnalité narcissique qui la caractérise. On a bien pris le temps de construire le portrait de cette figure maternelle étouffante tout au long de l’épisode : toute la famille s’empresse alors de la remercier pour ce repas et l’arrose de compliments. Peut-être cette soirée va-t-elle bien se passer après tout… C’était sans compter sur l’intervention de Natalie – aussi appelée Sugar, la sœur de Carmy et Mikey – qui ne peut s’empêcher de demander à sa mère si elle va bien. Des gros plans sur les visages crispés des membres de la famille nous indiquent qu’il s’agit d’une grosse erreur… Cette question d’apparence anodine fait immédiatement sortir Donna de ses gonds, qui se met alors à insulter tout le monde. La tension remonte à nouveau d’un cran. La caméra fait le tour des visages circonspects des invité.es, qui fuient son regard comme des enfants en train de se faire gronder. Une assiette vient se fracasser sur le sol. On bascule dans le drame. Donna sort de la pièce. Un silence s’installe l’espace de quelques secondes. Les visages sont figés. Quelques murmures se font entendre. L’oncle Lee tente de temporiser. Mikey choisit de profiter de cet instant pour proférer sa vengeance et lui lance une nouvelle fourchette dessus. Une bagarre éclate. La table est renversée, les cris fusent de toute part, l’assemblée se transforme en ménagerie. Alors que la tension semblait être à son comble, Donna vient mettre un point d’orgue à cette symphonie familiale dissonante en venant encastrer sa voiture dans le mur du salon. Le chaos est alors total. Sous les cris de Mikey, accompagnés d’un bruit strident, la caméra se concentre sur le visage inexpressif de Carmy qui fixe la fourchette de la discorde plantée dans les cannoli, avant de zoomer lentement sur l’expression de pure angoisse de Natalie. Cette séquence, qui nous replonge dans le passé de Carmy, avant tous les événements présentés dans le reste de la série, permet de nous éclairer sur de nombreux aspects de sa personnalité, notamment son rapport à la famille. Elle permet aussi aux créateurs de la série de s’essayer à l’exercice du drame familial, avec un certain brio.
.
.
.
“The Bear – Saison 2” est disponible sur Disney+
Crédit Photo © Star+ / Disney
.
.
.
De Humani Corporis Fabrica
de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel
Prostate Dantesque
par Calvin Roy
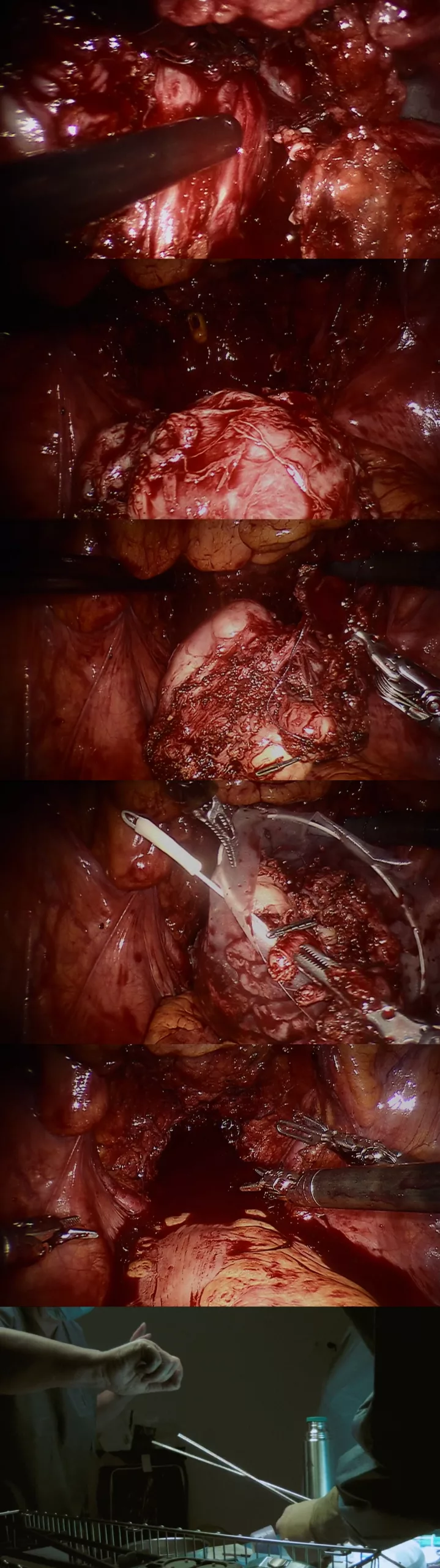 Parce que certains documentaires sont sans pareil, disruptifs, hors normes, ou bien parce qu’ils jouent des codes, ils ne font vraiment pas genre au même titre que les fictions. De Humani Corporis Fabrica (Lucien Castaing-Taylor & Verena Paravel, 2022) est l’un d’eux, un spectacle mémorable jalonné de séquences aussi fascinantes que cauchemardesques. Les cinéastes immergent les spectateurs au cœur des hôpitaux parisiens, ainsi qu’au cœur de leurs patients. Ils auscultent les entrailles du corps humain au sens fort du verbe, révélant les paysages étranges et les textures quasi surnaturelles tapies en chacun de nous. Parmi toutes ces étrangetés, la séquence de l’extraction de la prostate est particulièrement dantesque. Le dispositif est simple : en plan séquence, une caméra médicale immergée dans un corps humain ausculte l’opération, commentée en off par les personnes présentes au bloc. “C’est bizarre comme vision”, commente l’un d’eux – un euphémisme. L’image est cauchemardesque : de toute part, les instruments des chirurgiens tranchent, découpent, pincent et écartèlent tissus et muqueuses pour se frayer un chemin dans une cavité décharnée et ruisselante de sang. “Je suis paumé” avoue un chirurgien avec calme, “ça commence à devenir un peu abstrait”. En effet, impossible pour le spectateur d’identifier cette vision infernale. Peut-être une planète étrange ? Un tableau de Jackson Pollock en 3D ? Ou bien la porte vers le dernier cercle de l’Enfer ? Ce n’est qu’après de longues secondes que les médecins identifient la chose, “elle est massive cette prostate”. Par un dispositif simple, les cinéastes mettent en lumière le chaos du corps humain, révélant des formes, des textures et des couleurs rarement vues par le commun des mortels, des images macabres – et parfois d’une beauté renversante – à en faire pâlir H.R. Giger. Tout au long de la séquence, les cinéastes jouent des effets de bascule. Le chaos des viscères contraste grandement avec la rigueur des commentaires et la dextérité des chirurgiens. Non sans peine, ils extirpent la prostate et la glissent dans un sac médical. Est ensuite révélé l’envers du décor – une autre vision extraterrestre. Le spectateur découvre les instruments chirurgicaux, l’assistance robotisée et les protections stériles. Le décalage est brutal entre la chaleur quasi palpable des entrailles rouges vives, et la froideur clinique du bloc opératoire, noyé dans une lueur bleutée. Les cinéastes nous rappellent ainsi combien nos corps sont fragiles, rien de plus qu’un amoncellement primitif de chair, d’os et de fluides. Retour dans les entrailles, où les chirurgiens s’affairent à suturer les plaies sanglantes. Lorsque l’un d’eux fait tomber un instrument au sol, en hors-champ, le chirurgien en chef perd son calme, “Putain, fais chier !” hurle-t-il à son équipe. Les cinéastes montrent ainsi l’absurdité du milieu hospitalier dans lequel nos vies sont entre les mains d’individus écrasés par la pression au sein d’un système vulnérable et sous tension. “Il faut faire vite ! On est mal, on est très très mal” peste le chirurgien. La pandémie a récemment mis en lumière les difficultés du monde hospitalier aux yeux du grand public, mais De Humani Corporis Fabrica examine cette réalité comme jamais auparavant. En immersion totale, sans artifices ni narration, la mise en scène de l’hôpital est digne d’un film d’horreur : plans sanguinolents, tension palpable et suspense latent, tout y est. Mais heureusement, tout rentre dans l’ordre. L’équipe parvient à suturer les blessures du patient, avec une précision et une rapidité déconcertantes. Finalement, peut-être y a-t-il encore de l’espoir ? En tout cas, on souhaite un prompt rétablissement au malade.
Parce que certains documentaires sont sans pareil, disruptifs, hors normes, ou bien parce qu’ils jouent des codes, ils ne font vraiment pas genre au même titre que les fictions. De Humani Corporis Fabrica (Lucien Castaing-Taylor & Verena Paravel, 2022) est l’un d’eux, un spectacle mémorable jalonné de séquences aussi fascinantes que cauchemardesques. Les cinéastes immergent les spectateurs au cœur des hôpitaux parisiens, ainsi qu’au cœur de leurs patients. Ils auscultent les entrailles du corps humain au sens fort du verbe, révélant les paysages étranges et les textures quasi surnaturelles tapies en chacun de nous. Parmi toutes ces étrangetés, la séquence de l’extraction de la prostate est particulièrement dantesque. Le dispositif est simple : en plan séquence, une caméra médicale immergée dans un corps humain ausculte l’opération, commentée en off par les personnes présentes au bloc. “C’est bizarre comme vision”, commente l’un d’eux – un euphémisme. L’image est cauchemardesque : de toute part, les instruments des chirurgiens tranchent, découpent, pincent et écartèlent tissus et muqueuses pour se frayer un chemin dans une cavité décharnée et ruisselante de sang. “Je suis paumé” avoue un chirurgien avec calme, “ça commence à devenir un peu abstrait”. En effet, impossible pour le spectateur d’identifier cette vision infernale. Peut-être une planète étrange ? Un tableau de Jackson Pollock en 3D ? Ou bien la porte vers le dernier cercle de l’Enfer ? Ce n’est qu’après de longues secondes que les médecins identifient la chose, “elle est massive cette prostate”. Par un dispositif simple, les cinéastes mettent en lumière le chaos du corps humain, révélant des formes, des textures et des couleurs rarement vues par le commun des mortels, des images macabres – et parfois d’une beauté renversante – à en faire pâlir H.R. Giger. Tout au long de la séquence, les cinéastes jouent des effets de bascule. Le chaos des viscères contraste grandement avec la rigueur des commentaires et la dextérité des chirurgiens. Non sans peine, ils extirpent la prostate et la glissent dans un sac médical. Est ensuite révélé l’envers du décor – une autre vision extraterrestre. Le spectateur découvre les instruments chirurgicaux, l’assistance robotisée et les protections stériles. Le décalage est brutal entre la chaleur quasi palpable des entrailles rouges vives, et la froideur clinique du bloc opératoire, noyé dans une lueur bleutée. Les cinéastes nous rappellent ainsi combien nos corps sont fragiles, rien de plus qu’un amoncellement primitif de chair, d’os et de fluides. Retour dans les entrailles, où les chirurgiens s’affairent à suturer les plaies sanglantes. Lorsque l’un d’eux fait tomber un instrument au sol, en hors-champ, le chirurgien en chef perd son calme, “Putain, fais chier !” hurle-t-il à son équipe. Les cinéastes montrent ainsi l’absurdité du milieu hospitalier dans lequel nos vies sont entre les mains d’individus écrasés par la pression au sein d’un système vulnérable et sous tension. “Il faut faire vite ! On est mal, on est très très mal” peste le chirurgien. La pandémie a récemment mis en lumière les difficultés du monde hospitalier aux yeux du grand public, mais De Humani Corporis Fabrica examine cette réalité comme jamais auparavant. En immersion totale, sans artifices ni narration, la mise en scène de l’hôpital est digne d’un film d’horreur : plans sanguinolents, tension palpable et suspense latent, tout y est. Mais heureusement, tout rentre dans l’ordre. L’équipe parvient à suturer les blessures du patient, avec une précision et une rapidité déconcertantes. Finalement, peut-être y a-t-il encore de l’espoir ? En tout cas, on souhaite un prompt rétablissement au malade.
“De Humani Corporis Fabrica”
sortira début 2024 en Blu-Ray et DVD
ainsi qu’en location et achat VOD
Crédit Photo © Les Films du Losange
..






