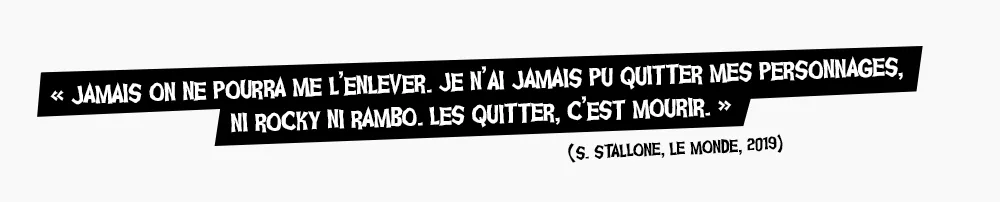Star incontestée des années 80, ringardisée par les années 90, puis ressuscitée dans les années 2000, Sylvester Stallone traine sa carcasse depuis six décennies sur les plateaux de tournage. Qu’elle soit moquée ou admirée, l’aura quasi légendaire de Sly ne laisse personne indifférent, cache en réalité une personnalité plus complexe qu’elle n’y parait, et a quasiment fait oublier le talent premier du Monsieur : être acteur.

© “La taverne de l’enfer” tous droits réservés
Premier round : 1946-1976
L’année 2023 aura été une année florissante pour Sylvester Stallone qui sera passé du meilleur au pire, comme un condensé des périodes fastes et celles moins glorieuses de sa riche carrière. Un navet avec Expendables 4 (Scott Waugh), un caméo jouant sur le mythe Sly dans le très sympa Les Gardiens de la Galaxie – Vol.3 (James Gunn), une téléréalité anecdotique avec La Famille Stallone sur Paramount+, une bonne série où le comédien retrouve un lieu d’expression avec Tulsa King (Taylor Sheridan), et enfin un documentaire intitulé sobrement Sly (Thom Zimny) revenant sur son parcours. Et pour comprendre qui est Sylvester Stallone, il nous faut retourner aux origines. Quand on évoque les acteurs italo-américains, on pense d’abord à Al Pacino ou Robert De Niro, mais Stallone aussi est le fils d’un immigré italien débarqué à New-York seulement une douzaine d’années avec sa naissance en 1946. Dès l’accouchement, les complications se présentent puisque l’usage des forceps pour sortir le petit Sylvester lui touchera de manière irréversible un nerf facial, paralysant du même coup sa bouche et sa langue. De ce petit fait anecdotique naitront pourtant deux des attributs caractéristiques de l’acteur : sa bouche tordue et son défaut de prononciation, desquels découleront beaucoup de moqueries et parodies en tous genres. Évoluant au côté d’un père, Francesco Stallone, violent et relativement jaloux de ses enfants, Sly se réfugie rapidement dans l’art dramatique pour combattre sa timidité maladive, et dans le sport pour se bâtir un corps et pouvoir se défendre, lui qui vit dans le dur quartier de Hell’s Kitchen à New York.
 Dans les années 70, un Stallone bientôt trentenaire peine à trouver des rôles et cachetonne en faisant de la figuration non créditée, comme dans Bananas (Woody Allen, 1971) ou Klute (Alan J. Pakula, 1971). Devenu quasiment sans domicile fixe, il tourne même dans un film érotique : The Party at Kitty and Stud’s (Morton Lewis, 1970), re-titré opportunément L’Étalon italien suite au succès de Rocky (John G. Avildsen, 1976). Et Rocky, venons-en. Alors qu’il fait l’expérience de l’extrême pauvreté, Stallone assiste à un combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner qui lui inspirera le scénario de Rocky. Il propose le script à tous les studios qui se montrent intéressés mais qui refusent que le jeune scénariste en tienne la tête d’affiche. MGM et United Artists lui proposeront 200.000 dollars pour qu’il accepte de se retirer au profit d’un Robert Redford ou d’un James Caan, mais il refuse et tient bon. La suite, on la connait ; le succès sera phénoménal, Stallone devient du jour au lendemain une star qui se voit nommée aux Oscars à la fois comme scénariste et comme acteur, ce qui n’était plus arrivé depuis Charlie Chaplin et Orson Welles. Mais au final de quoi parle Rocky ? Tout le monde en a une certaine image liée à un a priori ou aux dérives futures de la carrière de Stallone, mais au fond, le film originel est en creux un portrait intimiste de l’acteur et scénariste. Le noble art peut être vu comme une allégorie des combats que Stallone a menés pour espérer atteindre son rêve, et au final le long-métrage s’attache moins à parler de sport que des petits destins de Rocky, Adrian et Paulie. Loin des délires patriotiques à venir ou du concept d’american dream, le film raconte une Amérique oubliée où les laissés pour compte ne peuvent espérer qu’un coup du sort, ici le choix d’Apollo Creed d’affronter l’inconnu qu’est Rocky, pour s’en sortir. Sous ses airs de conte, le film dégage une vraie noirceur. Des personnages comme Paulie ou Mickey agissent souvent par pur opportunisme, Philadelphie, et plus largement l’Amérique, est montrée telle qu’elle est, crade, froide. Seuls Rocky et Stallone apportent du cœur au film. Et sauf pour ceux qui souhaiteraient réduire la prestation de l’acteur au culte « Adriaaaaan », la prestation de Sylvester Stallone éblouit par sa force brute qui n’est pas sans rappeler celle de Marlon Brando dans Sur les quais (Elia Kazan, 1954), autre grand film sur la workin class. Il faut revoir la scène où Rocky hurle sur Mickey puis se ravise dans un dernier geste désarmant pour comprendre l’étendue du jeu du comédien. Stallone et Rocky forment donc un tout, dont, on le verra par la suite, les courbes vont se suivre sur près de cinquante ans.
Dans les années 70, un Stallone bientôt trentenaire peine à trouver des rôles et cachetonne en faisant de la figuration non créditée, comme dans Bananas (Woody Allen, 1971) ou Klute (Alan J. Pakula, 1971). Devenu quasiment sans domicile fixe, il tourne même dans un film érotique : The Party at Kitty and Stud’s (Morton Lewis, 1970), re-titré opportunément L’Étalon italien suite au succès de Rocky (John G. Avildsen, 1976). Et Rocky, venons-en. Alors qu’il fait l’expérience de l’extrême pauvreté, Stallone assiste à un combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner qui lui inspirera le scénario de Rocky. Il propose le script à tous les studios qui se montrent intéressés mais qui refusent que le jeune scénariste en tienne la tête d’affiche. MGM et United Artists lui proposeront 200.000 dollars pour qu’il accepte de se retirer au profit d’un Robert Redford ou d’un James Caan, mais il refuse et tient bon. La suite, on la connait ; le succès sera phénoménal, Stallone devient du jour au lendemain une star qui se voit nommée aux Oscars à la fois comme scénariste et comme acteur, ce qui n’était plus arrivé depuis Charlie Chaplin et Orson Welles. Mais au final de quoi parle Rocky ? Tout le monde en a une certaine image liée à un a priori ou aux dérives futures de la carrière de Stallone, mais au fond, le film originel est en creux un portrait intimiste de l’acteur et scénariste. Le noble art peut être vu comme une allégorie des combats que Stallone a menés pour espérer atteindre son rêve, et au final le long-métrage s’attache moins à parler de sport que des petits destins de Rocky, Adrian et Paulie. Loin des délires patriotiques à venir ou du concept d’american dream, le film raconte une Amérique oubliée où les laissés pour compte ne peuvent espérer qu’un coup du sort, ici le choix d’Apollo Creed d’affronter l’inconnu qu’est Rocky, pour s’en sortir. Sous ses airs de conte, le film dégage une vraie noirceur. Des personnages comme Paulie ou Mickey agissent souvent par pur opportunisme, Philadelphie, et plus largement l’Amérique, est montrée telle qu’elle est, crade, froide. Seuls Rocky et Stallone apportent du cœur au film. Et sauf pour ceux qui souhaiteraient réduire la prestation de l’acteur au culte « Adriaaaaan », la prestation de Sylvester Stallone éblouit par sa force brute qui n’est pas sans rappeler celle de Marlon Brando dans Sur les quais (Elia Kazan, 1954), autre grand film sur la workin class. Il faut revoir la scène où Rocky hurle sur Mickey puis se ravise dans un dernier geste désarmant pour comprendre l’étendue du jeu du comédien. Stallone et Rocky forment donc un tout, dont, on le verra par la suite, les courbes vont se suivre sur près de cinquante ans.
Deuxième round : 1977-1989
Après le succès du film d’Avildsen, Sly s’engage sur le réussi FIST (Norman Jewison, 1978), nouveau propos social où l’acteur incarne une sorte de Jimmy Hoffa menant la révolte des camionneurs américains. Échec. Alors Stallone reprend sa plus belle plume et décide de passer derrière la caméra pour réaliser La Taverne de l’enfer (1978) qui suit le destin de trois frères dans les bas-fonds de Hell’s Kitchen. Encore un film à la portée sociale où le sport sert de métaphore pour exprimer une lutte bien plus large, et où Stallone compose une variation de son personnage fétiche. Tandis qu’il confirme son regard mélancolique sur ce que l’Amérique appelle les loosers, on y perçoit déjà une tendance à vouloir capitaliser sur une formule. Échec. Fort de son expérience de réalisateur et sentant que sa carrière est encore fragile, il se lance dans un Rocky 2 : La Revanche (1979) qui sonne autant comme un retour aux fondamentaux que comme un piège dans lequel l’acteur va s’enfermer à jamais. Le film est néanmoins réussi. On y retrouve la simplicité et l’émotion brute du premier épisode, et Rocky devient plus que jamais l’alter égo de Stallone qui avec ce nouveau film/combat doit, comme son personnage, dissipé le malentendu sur sa légitimité. S’il perdait dans le premier film – l’objectif était de tenir la distance – il se voit sacré champion du monde à la fin du second opus. Alors, Stallone commence à toucher les étoiles. Les Faucons de la nuit (Bruce Malmuth, 1981) où il rejoue Serpico (Sidney Lumet, 1973) et À nous la victoire (John Huston, 1981) où il côtoie Pelé, Michael Caine et Max Von Sidow, sont des échecs et il va devoir ressortir sa machine à écrire pour éviter d’être placardiser pour de bon. Il révise un script qui tournait alors depuis des années à Hollywood : Rambo (Ted Kotcheff, 1982). Avec ce rôle de vétéran de la guerre du Vietnam, Stallone compose un autre personnage culte qui accompagnera sa carrière. Mais c’est un versant plus sombre que Rocky qui, comme le boxeur de Philadelphie, est rejeté par la société américaine puisque symbole de son échec guerrier. « Rambo véhicule la culpabilité de l’Amérique » dira Stallone.
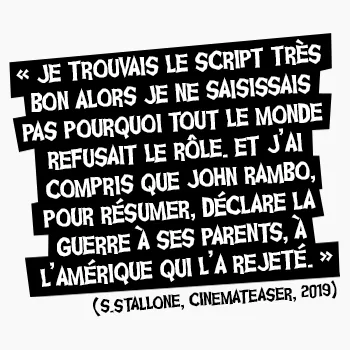 Là encore, Stallone n’épargne pas son pays dans sa façon de décrire comme les USA en ont fait une machine de guerre et idéologique, pour finalement le laisser livré à lui-même à son retour du front. Et de la même manière que Rocky n’est pas un film sur la boxe, Rambo (Ted Kotcheff, 1982) n’est pas un film d’action bas du front, loin s’en faut. Stallone, l’acteur, livre là encore une très grande prestation, cette fois-ci en intériorité, où tout passe dans les yeux jusqu’à une explosion finale lors d’un monologue déchirant. Nous sommes encore loin de la marionnette des Guignols de l’info. Mais le tournant va vite s’opérer avec un troisième épisode de sa désormais franchise : Rocky 3 : L’œil du tigre (Sylvester Stallone, 1982). Rocky est désormais sur le toit du monde et enchaine les succès, ce que l’on peut voir comme une parabole de ce que vit alors Stallone. Le boxeur comme l’acteur se sont embourgeoisés et ne prennent plus de risques dans des combats/films faciles. Sly, qui réalise à nouveau, est comme absent à lui-même dans ce film à l’esthétique qui amorce un changement par rapport aux deux premiers épisodes. Avec Rocky 4 (S. Stallone, 1985), l’acteur-scénariste-cinéaste lâche totalement prise et livre une œuvre atrophiée tant sur le plan artistique puisqu’il résume à lui tout seul toute l’imagerie eighties et ses excès, que sur le plan idéologique où Stallone pense résumer la Guerre Froide en un combat de boxe et faire revenir l’URSS du « bon côté ». Ce n’est pas peu dire qu’avec ce film délirant, Stallone montre au monde entier que son égo l’a emporté ! La même année, Rambo 2 : La Mission (George Costamos) décide de trahir tout le message politique du premier film pour rejouer la grande Histoire en un affrontement soviétiques vs. Rambo. Si, pour le coup, le film a vraiment bien vieilli et reste bien narré – James Cameron y est scénariste – et spectaculaire, l’idéologie, encore une fois, fait au mieux sourire. « Je me suis retrouvé enfermé dans une sorte de fantaisie mythique, c’était ridicule » dira Stallone (CinemaTeaser, 2019). « Vraiment, je dois m’excuser. Mon égo était hors de contrôle ! » (Sylvester Stallone, Sly, Thom Zimny, 2023). La star est au sommet de sa gloire cette année-là – plus haut qu’il ne le sera plus jamais – mais oublie de proposer une chose en cours de route : du jeu d’acteur. Et c’est là, entre postures monolithiques et melon boursouflé, que le malentendu Stallone prend racine et s’installe pour toujours… Cobra (G. Costamos, 1986), Over The Top : Le Bras de fer (Menahem Golan, 1987), Haute sécurité (John Flynn, 1989) ou Tango & Cash (Andreï Kontchalovski, 1989), s’ils peuvent se déguster comme de petits plaisirs coupables ne sont que le prolongement de la crise d’égo de Stallone. Devenu héros infaillible et invincible, un corps divin plus qu’un humain véritable, l’acteur allait vite retomber sur Terre.
Là encore, Stallone n’épargne pas son pays dans sa façon de décrire comme les USA en ont fait une machine de guerre et idéologique, pour finalement le laisser livré à lui-même à son retour du front. Et de la même manière que Rocky n’est pas un film sur la boxe, Rambo (Ted Kotcheff, 1982) n’est pas un film d’action bas du front, loin s’en faut. Stallone, l’acteur, livre là encore une très grande prestation, cette fois-ci en intériorité, où tout passe dans les yeux jusqu’à une explosion finale lors d’un monologue déchirant. Nous sommes encore loin de la marionnette des Guignols de l’info. Mais le tournant va vite s’opérer avec un troisième épisode de sa désormais franchise : Rocky 3 : L’œil du tigre (Sylvester Stallone, 1982). Rocky est désormais sur le toit du monde et enchaine les succès, ce que l’on peut voir comme une parabole de ce que vit alors Stallone. Le boxeur comme l’acteur se sont embourgeoisés et ne prennent plus de risques dans des combats/films faciles. Sly, qui réalise à nouveau, est comme absent à lui-même dans ce film à l’esthétique qui amorce un changement par rapport aux deux premiers épisodes. Avec Rocky 4 (S. Stallone, 1985), l’acteur-scénariste-cinéaste lâche totalement prise et livre une œuvre atrophiée tant sur le plan artistique puisqu’il résume à lui tout seul toute l’imagerie eighties et ses excès, que sur le plan idéologique où Stallone pense résumer la Guerre Froide en un combat de boxe et faire revenir l’URSS du « bon côté ». Ce n’est pas peu dire qu’avec ce film délirant, Stallone montre au monde entier que son égo l’a emporté ! La même année, Rambo 2 : La Mission (George Costamos) décide de trahir tout le message politique du premier film pour rejouer la grande Histoire en un affrontement soviétiques vs. Rambo. Si, pour le coup, le film a vraiment bien vieilli et reste bien narré – James Cameron y est scénariste – et spectaculaire, l’idéologie, encore une fois, fait au mieux sourire. « Je me suis retrouvé enfermé dans une sorte de fantaisie mythique, c’était ridicule » dira Stallone (CinemaTeaser, 2019). « Vraiment, je dois m’excuser. Mon égo était hors de contrôle ! » (Sylvester Stallone, Sly, Thom Zimny, 2023). La star est au sommet de sa gloire cette année-là – plus haut qu’il ne le sera plus jamais – mais oublie de proposer une chose en cours de route : du jeu d’acteur. Et c’est là, entre postures monolithiques et melon boursouflé, que le malentendu Stallone prend racine et s’installe pour toujours… Cobra (G. Costamos, 1986), Over The Top : Le Bras de fer (Menahem Golan, 1987), Haute sécurité (John Flynn, 1989) ou Tango & Cash (Andreï Kontchalovski, 1989), s’ils peuvent se déguster comme de petits plaisirs coupables ne sont que le prolongement de la crise d’égo de Stallone. Devenu héros infaillible et invincible, un corps divin plus qu’un humain véritable, l’acteur allait vite retomber sur Terre.
Troisième round : 1990-2005
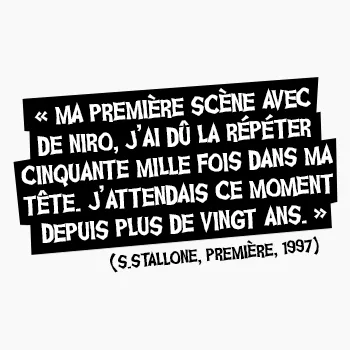 Et la chute s’amorce tout doucement alors que les années 90 démarrent. Comme un signe du destin, c’est avec Rocky 5 (J.G. Avildsen, 1990) qu’elle est préfigurée. Jusqu’ici, Rocky répondait à la situation que vivait Stallone ; l’anonymat et la pauvreté de Rocky, la confirmation de Rocky 2, l’embourgeoisement de Rocky 3 et le boulard de l’espace dans Rocky 4. Avec Rocky 5, Stallone anticipe inconsciemment le virage qui va alors s’opérer. Dans ce cinquième volet, Rocky se retrouve ruiné et doit retourner dans les bas-fonds de Philadelphie, où il va coacher un jeune talent quitte à y passer tout son temps et oublier sa famille. Cet épisode est le plus mal-aimé de toute la franchise puisqu’il propose un récit plus terre à terre, tentant de revenir aux origines modestes du premier film. Ce n’est pas une réussite pour autant car le film pèche parfois par manque de sincérité – ce volet est moins un retour aux sources que ce que sera le sixième épisode, plus authentique et en phase avec la situation personnelle de Sly – mais en retrouvant une esthétique et un traitement plus proche des origines, Stallone s’autorise un retour au jeu d’acteur et à l’émotion. Le film est un échec cuisant, eut regard des chiffres délirants du quatrième film – inflation prise en compte, cela donne du 856 millions de dollars contre 280 millions de billets verts, soit une chute vertigineuse. Peu avant, c’est Rambo 3 (Peter MacDonald, 1988) qui avait été une déculottée au box-office, et à l’instar d’une tripotée de productions de la fin des années 80, un film incapable de comprendre et d’anticiper la fin de la Guerre Froide. Quasiment hors propos, la figure désormais va-t-en-guerre de John Rambo ne fait plus recette. Et plus largement, c’est tout le système Stallone qui semble devoir être repensé, à l’heure où les héros et la masculinité sont en train d’évoluer vers d’autres modèles. Sans James Cameron à ses côtés pour le guider, ce qui est l’aubaine de son concurrent Arnold Schwarzenegger, il se perd dans deux comédies indignes qui ne lui siéent guère : L’Embrouille est dans le sac (John Landis, 1991) et Arrête ou ma mère va tirer ! (Roger Spottiswoode, 1992). Le tempo comique n’est pas vraiment le fort de Stallone et ces deux long-métrages demeureront ses uniques franches tentatives de comédie. Alors, l’acteur va revenir à l’action en s’adaptant tant bien que mal à l’énergie nineties. D’abord avec des films pompant la formule de Die Hard : Piège de cristal (John McTiernan, 1988) – un homme lambda qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, doit affronter une situation périlleuse – que seront Cliffhanger : Traque au sommet (Renny Harlin, 1993) et Daylight (Rob Cohen, 1996), deux honnêtes séries B de luxe. Et en réaction au succès de Terminator 2 : Le Jugement dernier (James Cameron, 1991) avec le concurrent Schwarzy, Sly tente l’aventure SF avec Demolition Man (Marco Brambilla, 1993) et Judge Dredd (Danny Cannon, 1995), pour quelques répliques cultes à la clé, mais sans grand éclat artistique. Enfin, L’Expert (Luis Llosa, 1994) et Assassins (Richard Donner, 1995) viennent faire perdurer l’image musculeuse du comédien en la filmant comme un vestige des années 80, étonnamment sexualisé – la nudité de Stallone est une première dans sa carrière à cette époque – alors que les standards évoluent vers des corps plus filiformes à la Keanu Reeves dans Speed (Jan De Bont, 1995) ou à la Tom Cruise dans Mission : Impossible (Brian De Palma, 1996). Mais son image, c’est avec le très grand Copland (James Mangold, 1997) que Stallone va la tordre une bonne fois pour toutes. En revenant à un rôle en intériorité, sheriff méprisé et impuissant face à la corruption de ses semblables, Stallone se mesure à de sacrés poids lourds : Robert De Niro, Ray Liotta, Harvey Keitel, etc. Enfin il ose un vrai contre-emploi qui nécessite pour lui de transformer son corps – une prise de vingt kilos – et de recommencer à jouer. Et quelle prestation ! Bouleversant de bout en bout, il rappelle le grand comédien et la gueule de cinéma qu’il a toujours été, convoquant par la même tous les regrets d’un acteur qui regarde les ratages de sa filmographie. On aurait pu penser que cette performance allait pouvoir servir de boussole pour la suite de sa carrière, mais l’échec financier du film, relatif, le poussera à faire une pause, et à finalement retourner à des productions peu recommandables. « James Mangold m’a forcé à explorer des recoins sombres où je n’étais jamais allé. J’ai adoré travailler avec lui, et j’ai aimé le film. Mais son échec a confirmé mon idée selon laquelle mon moment était passé. » (Sylvester Stallone, Variety, 2019). Get Carter (Stephen T. Kay, 2000), Driven (R. Harlin, 2001), Compte à rebours mortel (Jim Gillepsie, 2002) et même des passages dans Spy Kids 3 : Mission 3D (Robert Rodriguez, 2003) et Taxi 3 (Gérard Krawczyk, 2003) ; ainsi démarrera le nouveau millénaire pour une légende hollywoodienne en passe d’être totalement ringardisée voire placardisée par l’industrie…
Et la chute s’amorce tout doucement alors que les années 90 démarrent. Comme un signe du destin, c’est avec Rocky 5 (J.G. Avildsen, 1990) qu’elle est préfigurée. Jusqu’ici, Rocky répondait à la situation que vivait Stallone ; l’anonymat et la pauvreté de Rocky, la confirmation de Rocky 2, l’embourgeoisement de Rocky 3 et le boulard de l’espace dans Rocky 4. Avec Rocky 5, Stallone anticipe inconsciemment le virage qui va alors s’opérer. Dans ce cinquième volet, Rocky se retrouve ruiné et doit retourner dans les bas-fonds de Philadelphie, où il va coacher un jeune talent quitte à y passer tout son temps et oublier sa famille. Cet épisode est le plus mal-aimé de toute la franchise puisqu’il propose un récit plus terre à terre, tentant de revenir aux origines modestes du premier film. Ce n’est pas une réussite pour autant car le film pèche parfois par manque de sincérité – ce volet est moins un retour aux sources que ce que sera le sixième épisode, plus authentique et en phase avec la situation personnelle de Sly – mais en retrouvant une esthétique et un traitement plus proche des origines, Stallone s’autorise un retour au jeu d’acteur et à l’émotion. Le film est un échec cuisant, eut regard des chiffres délirants du quatrième film – inflation prise en compte, cela donne du 856 millions de dollars contre 280 millions de billets verts, soit une chute vertigineuse. Peu avant, c’est Rambo 3 (Peter MacDonald, 1988) qui avait été une déculottée au box-office, et à l’instar d’une tripotée de productions de la fin des années 80, un film incapable de comprendre et d’anticiper la fin de la Guerre Froide. Quasiment hors propos, la figure désormais va-t-en-guerre de John Rambo ne fait plus recette. Et plus largement, c’est tout le système Stallone qui semble devoir être repensé, à l’heure où les héros et la masculinité sont en train d’évoluer vers d’autres modèles. Sans James Cameron à ses côtés pour le guider, ce qui est l’aubaine de son concurrent Arnold Schwarzenegger, il se perd dans deux comédies indignes qui ne lui siéent guère : L’Embrouille est dans le sac (John Landis, 1991) et Arrête ou ma mère va tirer ! (Roger Spottiswoode, 1992). Le tempo comique n’est pas vraiment le fort de Stallone et ces deux long-métrages demeureront ses uniques franches tentatives de comédie. Alors, l’acteur va revenir à l’action en s’adaptant tant bien que mal à l’énergie nineties. D’abord avec des films pompant la formule de Die Hard : Piège de cristal (John McTiernan, 1988) – un homme lambda qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, doit affronter une situation périlleuse – que seront Cliffhanger : Traque au sommet (Renny Harlin, 1993) et Daylight (Rob Cohen, 1996), deux honnêtes séries B de luxe. Et en réaction au succès de Terminator 2 : Le Jugement dernier (James Cameron, 1991) avec le concurrent Schwarzy, Sly tente l’aventure SF avec Demolition Man (Marco Brambilla, 1993) et Judge Dredd (Danny Cannon, 1995), pour quelques répliques cultes à la clé, mais sans grand éclat artistique. Enfin, L’Expert (Luis Llosa, 1994) et Assassins (Richard Donner, 1995) viennent faire perdurer l’image musculeuse du comédien en la filmant comme un vestige des années 80, étonnamment sexualisé – la nudité de Stallone est une première dans sa carrière à cette époque – alors que les standards évoluent vers des corps plus filiformes à la Keanu Reeves dans Speed (Jan De Bont, 1995) ou à la Tom Cruise dans Mission : Impossible (Brian De Palma, 1996). Mais son image, c’est avec le très grand Copland (James Mangold, 1997) que Stallone va la tordre une bonne fois pour toutes. En revenant à un rôle en intériorité, sheriff méprisé et impuissant face à la corruption de ses semblables, Stallone se mesure à de sacrés poids lourds : Robert De Niro, Ray Liotta, Harvey Keitel, etc. Enfin il ose un vrai contre-emploi qui nécessite pour lui de transformer son corps – une prise de vingt kilos – et de recommencer à jouer. Et quelle prestation ! Bouleversant de bout en bout, il rappelle le grand comédien et la gueule de cinéma qu’il a toujours été, convoquant par la même tous les regrets d’un acteur qui regarde les ratages de sa filmographie. On aurait pu penser que cette performance allait pouvoir servir de boussole pour la suite de sa carrière, mais l’échec financier du film, relatif, le poussera à faire une pause, et à finalement retourner à des productions peu recommandables. « James Mangold m’a forcé à explorer des recoins sombres où je n’étais jamais allé. J’ai adoré travailler avec lui, et j’ai aimé le film. Mais son échec a confirmé mon idée selon laquelle mon moment était passé. » (Sylvester Stallone, Variety, 2019). Get Carter (Stephen T. Kay, 2000), Driven (R. Harlin, 2001), Compte à rebours mortel (Jim Gillepsie, 2002) et même des passages dans Spy Kids 3 : Mission 3D (Robert Rodriguez, 2003) et Taxi 3 (Gérard Krawczyk, 2003) ; ainsi démarrera le nouveau millénaire pour une légende hollywoodienne en passe d’être totalement ringardisée voire placardisée par l’industrie…
Quatrième round : 2006-2014
 Et le miracle arriva… Depuis plus de quinze ans et l’échec de Rocky 5, Stallone se bat comme un diable, un peu comme il avait eu à le faire en 1976, pour faire renaitre son personnage totem. Personne ne croit au retour du boxeur de Philadelphie, d’autant que Sly a quasiment soixante ans au compteur. Pourtant, alors que les critiques avaient déjà préparé leurs articles à charge, Stallone réussi l’impensable avec Rocky Balboa (S. Stallone, 2006) ; une œuvre testamentaire où il retrouve enfin la pureté du premier film et où l’émotion est palpable à chaque photogramme. On fustige souvent les films jouant sur une nostalgie artificielle, mais ici, tout est d’une grande sincérité et on retrouve un acteur-réalisateur impliqué sortant de sa léthargie. Il faut re-contextualiser la chose ; en 2006, voilà presque dix ans que Stallone n’a pas produit le moindre jeu et qu’il se fourvoie dans des productions indignes de sa stature. Quels chocs que ces scènes où il se met à nu et joue sur une fibre quasi inédite comme lorsqu’il évoque cette chose à l’intérieur de lui qu’il lui reste à évacuer lors d’un dernier tour de piste. Et comme par magie, Rocky redevient l’avatar de son auteur, lui qui a tout perdu et qui veut prouver qu’il lui reste des choses à dire et à faire. Comme en 1976, Sylvester Stallone reprend les rênes de son destin à la faveur de ce personnage si attachant et inspirant, qui comme dans le premier film, perd à la fin mais qu’importe. La critique est donc surprise et le film engrange un succès tel qu’il remet en selle la légende Sly. Et comme l’homme veut balayer la poussière sous tous ses tapis, il décide d’en finir avec le malentendu Rambo avec une quatrième aventure tout aussi incongrue. Ce sera John Rambo (S. Stallone, 2008). Dans ce volet tardif, où le vétéran sort de sa retraite dans le fin-fond de la Thaïlande pour aller en découdre avec la junte birmane, Stallone fait des choix intéressants. Déjà, il décide d’ancrer son personnage dans un conflit actuel, en Birmanie donc, et d’alerter sur ce qui s’y passe, là où il aurait pu choisir la facilité d’aller sur les fronts irakiens où Bush avait mené son invasion à l’époque. Ensuite, il décide, dans un geste assez fou, de justifier la folie meurtrière de son personnage. John Rambo est le produit de l’Amérique et une machine de guerre. Rambo 2 : La Mission et Rambo 3 avaient fait de lui un dieu antique, John Rambo le remet sur le chemin du premier film, littéralement avec le dernier plan, en assumant le propos politique initial. Sans concession, violent, barbare même, l’ambiguïté n’est plus permise. Stallone a bouclé la boucle de ses deux personnages cultes, de ses deux facettes, lumineuse avec Rocky, sombre avec Rambo, et est enfin rentré dans le 21ème siècle.
Et le miracle arriva… Depuis plus de quinze ans et l’échec de Rocky 5, Stallone se bat comme un diable, un peu comme il avait eu à le faire en 1976, pour faire renaitre son personnage totem. Personne ne croit au retour du boxeur de Philadelphie, d’autant que Sly a quasiment soixante ans au compteur. Pourtant, alors que les critiques avaient déjà préparé leurs articles à charge, Stallone réussi l’impensable avec Rocky Balboa (S. Stallone, 2006) ; une œuvre testamentaire où il retrouve enfin la pureté du premier film et où l’émotion est palpable à chaque photogramme. On fustige souvent les films jouant sur une nostalgie artificielle, mais ici, tout est d’une grande sincérité et on retrouve un acteur-réalisateur impliqué sortant de sa léthargie. Il faut re-contextualiser la chose ; en 2006, voilà presque dix ans que Stallone n’a pas produit le moindre jeu et qu’il se fourvoie dans des productions indignes de sa stature. Quels chocs que ces scènes où il se met à nu et joue sur une fibre quasi inédite comme lorsqu’il évoque cette chose à l’intérieur de lui qu’il lui reste à évacuer lors d’un dernier tour de piste. Et comme par magie, Rocky redevient l’avatar de son auteur, lui qui a tout perdu et qui veut prouver qu’il lui reste des choses à dire et à faire. Comme en 1976, Sylvester Stallone reprend les rênes de son destin à la faveur de ce personnage si attachant et inspirant, qui comme dans le premier film, perd à la fin mais qu’importe. La critique est donc surprise et le film engrange un succès tel qu’il remet en selle la légende Sly. Et comme l’homme veut balayer la poussière sous tous ses tapis, il décide d’en finir avec le malentendu Rambo avec une quatrième aventure tout aussi incongrue. Ce sera John Rambo (S. Stallone, 2008). Dans ce volet tardif, où le vétéran sort de sa retraite dans le fin-fond de la Thaïlande pour aller en découdre avec la junte birmane, Stallone fait des choix intéressants. Déjà, il décide d’ancrer son personnage dans un conflit actuel, en Birmanie donc, et d’alerter sur ce qui s’y passe, là où il aurait pu choisir la facilité d’aller sur les fronts irakiens où Bush avait mené son invasion à l’époque. Ensuite, il décide, dans un geste assez fou, de justifier la folie meurtrière de son personnage. John Rambo est le produit de l’Amérique et une machine de guerre. Rambo 2 : La Mission et Rambo 3 avaient fait de lui un dieu antique, John Rambo le remet sur le chemin du premier film, littéralement avec le dernier plan, en assumant le propos politique initial. Sans concession, violent, barbare même, l’ambiguïté n’est plus permise. Stallone a bouclé la boucle de ses deux personnages cultes, de ses deux facettes, lumineuse avec Rocky, sombre avec Rambo, et est enfin rentré dans le 21ème siècle.
Enfin Sly semble en paix avec son image, et conscient qu’il ne pourra jamais être totalement autre chose que ce qu’Hollywood et le public attendent de lui, il met au placard ses ambitions de toujours, par exemple cette adaptation de la vie d’Edgar Allan Poe avec Robert Downey Jr. qui était son projet le plus personnel. Comme souvent dans sa carrière, pour le meilleur mais souvent pour le pire, il souhaite faire plaisir aux fans et se lance dans un projet bien loin du poète romantique : Expendables : Unité spéciale (S. Stallone, 2010). Avec cette réunion d’ancien briscards des actionners des années 80, il surfe allègrement sur la nostalgie et plus particulièrement celle qui consiste à idéaliser les eighties et qui trouvera une apogée avec Stranger Things (Matt & Ross Duffer, 2016-En Production). Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Bruce Willis ou encore le concurrent de toujours Schwarzenegger, tout le monde est là pour un projet qui transpire la testostérone mais aussi la sincérité et un certain artisanat, à l’heure où commence le règne des super-héros en tout numérique. Le succès est tel que deux suites, Expendables 2 : Unité spéciale (Simon West, 2012) et Expendables 3 (Patrick Hughes, 2014), de plus en plus cyniques et débridées, sortiront dans la foulée. Stallone joue alors à plein sur la nostalgie en s’associant dans des binômes anachroniques – avec Schwarzy, encore, dans le pas terrible Évasion (Mikael Hafström, 2013), ou avec De Niro dans le pas génial Match retour (Peter Segal, 2013) où seul l’intérêt de voir un combat Rocky Balboa vs. Jake La Motta demeure – ou en tournant pour des cinéastes typiques des années 80 comme Walter Hill pour Du plomb dans la tête (2012) avec à la clé un résultat pas franchement notable. Stallone retombe dans ses travers, encore, et il faudra désormais compter sur une nouvelle génération de cinéastes pour le sortir de sa torpeur.
Cinquième round : 2015-2024
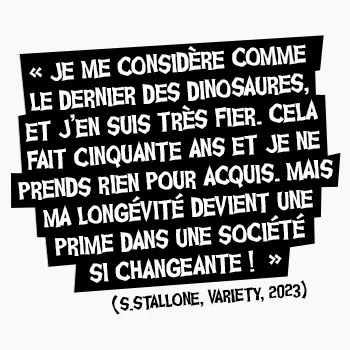 Et c’est Ryan Coogler, réalisateur du très bon Fruitvale Station (2013) et du futur Black Panther (2018), qui va venir le réveiller avec un projet tout personnel de sa part, lui qui a été biberonné à Rocky et ses suites : Creed : L’Héritage de Rocky Balboa (2015). Encore une fois, les spectateurs et la presse sourient et encore une fois, la magie opère. Cette fois, plus question de remonter sur le ring, il s’agira d’entrainer le fils illégitime d’Apollo Creed, son ancien rival, et de combattre la maladie. A l’instar de Rocky Balboa en 2006, dans ce spin-off, le premier dont Stallone ne soit pas à l’initiative, l’émotion est vive et la réussite est quasi-totale. En choisissant une esthétique propre à cette nouvelle saga sur Adonis Creed, Coogler fait un léger pas de côté sans pour autant renier la maison mère et ses fondements humanistes et mélancoliques. La performance de Stallone, bien dirigé, impressionne tant et si bien qu’il se voit récompensé d’un Golden Globe et est même nommé aux Oscars, près de quarante ans après le premier Rocky. Ce qui aurait dû être une consécration laisse place aux vieux réflexes, et Stallone de s’embourber à nouveau dans des productions de secondes zones – Évasion 2 (Steven C. Miller, 2018), Évasion 3 (John Herzfeld, 2019), Le Samaritain (Julius Avery, 2022) et un incroyablement mauvais Expendables 4 (Scott Waugh, 2023). Comme Coogler avant eux, ce sont deux jeunes auteurs qui vont alors jouer de l’image de Stallone pour le maintenir sur la A-List : James Gunn et Taylor Sheridan. En jouant de l’aura du comédien, Gunn fait tourner Stallone dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 (2017) et Vol.3, mais aussi dans son très bon The Suicide Squad (2021). Des incursions super-héroïques discrètes puisqu’elles relèvent soit du caméo, soit d’un doublage, mais qui permettent à Sly de s’imposer auprès d’une nouvelle génération et d’être de nouveau en phase avec son époque.
Et c’est Ryan Coogler, réalisateur du très bon Fruitvale Station (2013) et du futur Black Panther (2018), qui va venir le réveiller avec un projet tout personnel de sa part, lui qui a été biberonné à Rocky et ses suites : Creed : L’Héritage de Rocky Balboa (2015). Encore une fois, les spectateurs et la presse sourient et encore une fois, la magie opère. Cette fois, plus question de remonter sur le ring, il s’agira d’entrainer le fils illégitime d’Apollo Creed, son ancien rival, et de combattre la maladie. A l’instar de Rocky Balboa en 2006, dans ce spin-off, le premier dont Stallone ne soit pas à l’initiative, l’émotion est vive et la réussite est quasi-totale. En choisissant une esthétique propre à cette nouvelle saga sur Adonis Creed, Coogler fait un léger pas de côté sans pour autant renier la maison mère et ses fondements humanistes et mélancoliques. La performance de Stallone, bien dirigé, impressionne tant et si bien qu’il se voit récompensé d’un Golden Globe et est même nommé aux Oscars, près de quarante ans après le premier Rocky. Ce qui aurait dû être une consécration laisse place aux vieux réflexes, et Stallone de s’embourber à nouveau dans des productions de secondes zones – Évasion 2 (Steven C. Miller, 2018), Évasion 3 (John Herzfeld, 2019), Le Samaritain (Julius Avery, 2022) et un incroyablement mauvais Expendables 4 (Scott Waugh, 2023). Comme Coogler avant eux, ce sont deux jeunes auteurs qui vont alors jouer de l’image de Stallone pour le maintenir sur la A-List : James Gunn et Taylor Sheridan. En jouant de l’aura du comédien, Gunn fait tourner Stallone dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 (2017) et Vol.3, mais aussi dans son très bon The Suicide Squad (2021). Des incursions super-héroïques discrètes puisqu’elles relèvent soit du caméo, soit d’un doublage, mais qui permettent à Sly de s’imposer auprès d’une nouvelle génération et d’être de nouveau en phase avec son époque.
Cette époque qu’il questionne également dans la série Tulsa King, nouvelle production de Taylor Sheridan donc, où il incarne un vieux mafieux italo-américain sortant de prison et « puni » par ses capos en devant s’exiler à Tulsa, dans un état où à priori ne se passe pas grand-chose. Une dynamique qui rappelle Demolition Man puisque dans ce film où il était décongelé après des années passées dans un frigo, il devait s’adapter à un monde changé et nouveau. Ici, c’est la même chose, le personnage de Stallone doit comprendre les changements technologiques et de mentalité, comme une allégorie de la place de l’acteur au sein d’une industrie où il fait figure de dinosaure. En ayant fait ses adieux, encore, à ses personnages fétiches – dans le conclusif Creed 2 (Steven Caple Jr., 2018) et dans l’ignoble et absolument dispensable Rambo : The Last Blood (Adrian Grunberg, 2019), qui constituent chacun à leurs façons un regard sur la filiation, chère à Sly depuis au moins Rocky 5 – Stallone se retrouve désormais livré à lui-même. Du haut de ses 77 ans, dont cinquante passés devant les caméras, il est à tournant de sa légende où il ne peut plus vraiment se réinventer comme lorsqu’il en a eu l’occasion avec Copland, ni investir de manière crédible le genre de l’action comme en témoigne sa mise en retrait dans Expendables 4. Sly est comme prisonnier de son image, pour le meilleur quand elle est dignement célébrée par Gunn ou Coogler, et pour le pire quand il se refuse de faire mourir ses héros et à lâcher ses vieilles franchises. C’est ainsi qu’un Cliffhanger 2 devrait prochainement sortir sur nos écrans, dirigé par le frenchie Jean-François Richet, qu’un Demolition Man 2 est régulièrement annoncé, ou qu’une suite centrée sur un Rocky venant en aide à un jeune immigré mexicain est évoquée. Reste que Sylvester Stallone est une personnalité unique dans le paysage hollywoodien, lui qui a tout traversé et tout assumé, de ses mauvais choix de carrière à ses crises d’égo, lui qui a toujours eu des velléités artistiques fortes – en témoignent ses projets avortés sur Poe ou son activité dans la peinture – tout en étant pieds et poings liés à son image publique, lui qui a amené tant d’humanité à ses rôles musculeux, lui qui a été tant moqué et réduit à une bêtise supposée. Stallone, à l’instar d’un Clint Eastwood, est une personnalité clivante, qui incarne un versant d’une Amérique conquérante et impérialiste dans l’inconscient collectif – ce qui est davantage le fruit des récupérations de Ronald Reagan, par exemple, qu’une idéologie profonde – mais qu’il faut savoir appréhender sans a priori pour y découvrir un cœur battant. Gratter la surface, en retenant les films où Stallone a vraiment fait l’acteur, pour y distinguer le pourquoi de la légende…