
© Tous Droits Réservés
A qui c’est cette guerre qui traîne là ?!

© Tous Droits Réservés
De deux choses l’une : pour votre serviteur, Sylvester Stallone est un auteur à part entière. Et pour tout dire, un auteur avec du talent quand on gratte derrière le biceps un peu trop apparent, avec des thèmes qui lui sont propres et qui évoluent avec lui (réussir puis rester au top, avant de retomber, vieillir ou non, accepter et/ou souffrir des ravages du temps, je vous renvoie à mon article de Rambo : Last Blood). Je pense par exemple qu’on peut dire, sans craintes, que Rocky Balboa (2006) est un des plus beaux mélodrames des années 2000, certainement le plus poignant scénario d’un homme qui est donc, bien un auteur. Seconde chose : je ne porte pas le premier Rambo particulièrement dans mon cœur, à l’instar de la saga dans son ensemble contrairement aux Rocky (1976 – 2018, si l’on compte jusque Creed II) qui sont partie intégrante de mon attrait stallonesque. Rambo, c’est le plaisir assumé de la sueur, l’actionner 80’s comme on peut les aimer pour ce qu’ils ont d’exubérant, de spectaculaire, de sans-prétention, avec un charme vintage qui gomme les imperfections même si l’on comprend très bien que la critique de l’époque ait pu s’arracher les cheveux devant la connerie politique du fond. A mon sens, les Rambo perdent vite le relief que l’épisode inaugural – on y revient juste plus bas bien entendu – avait, et ne le retrouvent qu’avec le passage, comme par hasard, de Stallone lui-même à un poste plus significatif sur le plan artistique, c’est à dire directement – et pour la première fois de la série alors qu’il a mis en boîte quatre Rocky – réalisateur sur John Rambo (2008). Depuis quelques années, Rambo premier volet jouit en tous cas d’une aura de réhabilitation mais est-elle bien méritée ? Studio Canal, via une énième édition – méritée, elle aussi ? – nous permet de juger à nouveau sur pièce et de se faire une idée une bonne fois pour toutes, si tant est que ce soit possible pour une œuvre quelconque.
L’histoire, issue du roman éponyme de David Morrell publié en 1972, est désormais un classique : le vétéran John Rambo est de ceux qui, à l’issue de la guerre du Viêt Nam, rentrent chez eux en se sentant dépossédés. Lorsque le long-métrage commence, John est une âme en peine, sac en bandoulière, l’attitude d’un enfant musclé mais perdu dans un pays qu’il parcourt faute de mieux et d’endroit où se poser. Hélas par une terrible cruauté de l’Histoire, les anciens combattants du conflit sont désormais mal vus, voire méprisés par leurs concitoyens… Rambo est ainsi interpellé par un shérif odieux qui sur le motif de vagabondage va l’emprisonner, puis, le torturer. Mais ébouillanté par des souffrances qui lui rappellent les tortures qu’il a subies en terre ennemie, Rambo s’enfuit et se réfugie dans une foret voisine, des hommes de plus en plus nombreux à ses trousses… Et c’est de ce « de plus en plus nombreux » que se niche la grossièreté de Rambo, critiquée à juste titre, mauvais poids indépassable dans la balance du bon goût. Un schéma narratif du toujours plus, allant de la prison à la forêt où John tisse des pièges à ses poursuivants et s’enfuit toujours, pour évidemment aboutir jusqu’à la scène finale, séquence de guerre à un contre mille – un des codes qui bâtiront la saga avec plus ou moins de réussite – où les lumières 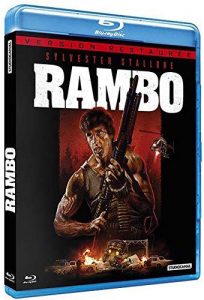 de la ville sautent sous les yeux d’une Garde Nationale désemparée face à un seul homme à peine blessé ou fatigué. Le grotesque n’a pas attendu les suites bourrines de la saga pour empâter pourtant des qualités pourtant bien réelles, entre autres, une première partie exceptionnelle ; un récit subversif à l’époque du retour à la vie civile pour les vétérans ; enfin un traitement des syndromes post-traumatiques en la personne d’un soldat qui ne sait plus vivre qu’en reproduisant la guerre partout où l’on s’oppose à lui. Sans ses défauts d’actionner, Rambo aurait pu être un des grands travaux cinématographiques sur la guerre du Viet Nâm.
de la ville sautent sous les yeux d’une Garde Nationale désemparée face à un seul homme à peine blessé ou fatigué. Le grotesque n’a pas attendu les suites bourrines de la saga pour empâter pourtant des qualités pourtant bien réelles, entre autres, une première partie exceptionnelle ; un récit subversif à l’époque du retour à la vie civile pour les vétérans ; enfin un traitement des syndromes post-traumatiques en la personne d’un soldat qui ne sait plus vivre qu’en reproduisant la guerre partout où l’on s’oppose à lui. Sans ses défauts d’actionner, Rambo aurait pu être un des grands travaux cinématographiques sur la guerre du Viet Nâm.
Quant à l’édition Studio Canal, elle est bien « restaurée » comme son artwork l’indique avec effet. En Blu-Ray, le long-métrage de Ted Kotcheff – dont vous avez déjà entendu parler sur ce site mais avec un western méconnu des années 50’s, Fais ta prière Tom Dooley (1959) – est irréprochable sur les plans visuels et sonores. Tout travail plastique sur ce First Blood est d’autant plus pertinent que les paysages américains, la nature et l’espace sont des motifs majeurs de l’œuvre… Si vous vous demandez si une énième galette était nécessaire puisqu’une version haute def’, on en a déjà eu dans le steelbook Ultra HD et Blu-Ray sorti en 2019, c’est que cette sortie-ci nous permet d’avoir les films à l’unité alors que le coffret regroupait la trilogie initiale. Les bonnii également penchent en faveur de ce diisque unitaire puisqu’ils sont particulièrement fournis avec commentaires audio, scène coupée, fin alternative, making-of, et plusieurs autres documents (sur la restauration, le symbole Rambo, la “formation des héros”…).






Pingback: Le justicier de New-York de Michael Winner - Critique sur Fais Pas Genre !