Faut-il encore présenter le phénomène Vermines ? Si vous êtes amateurs de cinéma de genres et intéressé par cette épineuse question de la revitalisation de l’imaginaire du cinéma français, vous n’êtes certainement pas passé à côté de ce film d’horreur made in France qui a mis tout le monde d’accord. Quelques jours après son incroyable nomination au César du Meilleur Premier Film, nous revenons avec le réalisateur Sébastien Vaniček sur ses débuts, la fabrication du projet, les grands sujets qui le traversent et l’accueil inespéré pour un film d’invasion araignée qui pourrait, on l’espère, faire date dans l’Histoire des cinémas de genres français.

© Tandem Films
Forcer la Mue
Je te propose de démarrer sur une non-question, en évitant celle qu’on a dû te poser mille fois déjà « d’où vous vient cet amour du cinéma de genre ?», parce que j’ai l’impression qu’on demande toujours de se justifier d’un amour matriciel pour ce cinéma-là.
Merci d’éviter ça parce que je suis toujours un peu mal à l’aise avec cette case « film de genre ». Bien sûr que Vermines en est un, mais on voit bien que les frontières sont de plus en plus fines, preuve en est qu’aujourd’hui, un film d’invasion d’araignées peut mettre d’accord Mad Movies et Les Cahiers du Cinéma, même si chaque média n’aime pas forcément le film pour les mêmes raisons. J’ai fait un film d’horreur – de natural horror même, si on veut être plus précis – et j’aime l’horreur en tant que spectateur, mais mon appétit pour le cinéma de genre ne se limite pas au fantastique, à la science-fiction et à l’horreur. Je pense qu’on le réduit souvent à ça, alors que pour moi le genre n’est pas un « sujet », c’est plutôt une façon de faire, une façon d’aborder la mise en scène sur un angle particulier qu’est celui des effets, des codes. Je suis persuadé qu’on peut « genrer » une dispute d’un couple dans un bâtiment haussmannien. Je ne différencie pas vraiment les films entre eux, je différencie les cinéastes et leur façon d’aborder la mise en scène.
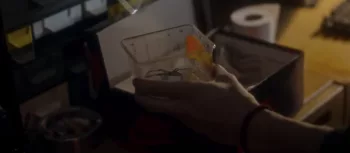
© Tandem Films
Je vais quand même t’amener sur le terrain des débuts, parce que j’ai lu que tu avais commencé enfant à expérimenter le filmage en empruntant la caméra de ton père pour filmer des insectes. Je trouve évidemment ça très intéressant au regard du fait que tu filmes des araignées dans ton premier long-métrage.
J’avais remis la main sur cette vidéo juste avant qu’on démarre le tournage de Vermines et je l’avais partagée sur les réseaux en parallèle de la photo du clap du premier jour. C’était vachement émouvant, parce que quinze années séparaient cette vidéo et le début de la production du film. En effet, depuis très jeune je m’intéresse au vivant et notamment aux insectes et autres vies microscopiques. Ce qui me fascinait et me fascine toujours dans ce monde c’est qu’il est peuplé d’espèces quasiment invisibles ou auxquelles on ne prête pas grande attention. Je voulais déjà à l’époque les filmer, les esthétiser, les donner à voir. Et puis c’est aussi souvent des espèces que la majorité des gens considère comme laides et j’ai justement toujours été très intéressé par cette idée d’esthétiser la laideur. Je trouve beaucoup de charme dans toutes choses considérées comme laides, sales, cassées. C’est quelque chose qui me vient de ma pratique du dessin. Je n’ai jamais fait un seul dessin qui cherchait le beau, mais je dessinais des visages burinés ou monstrueux, avec une esthétique très sombre et nerveuse.
Sans parler forcément du cinéma – j’ai promis qu’on allait pas là dessus – cet amour du fantastique te vient donc clairement de l’enfance ?
Je ne sais pas si je parlerais vraiment d’un amour du fantastique, je dirais plutôt que j’ai été très tôt attiré par des récits de gens a priori « normaux » à qui il arrive des choses extraordinaires. J’aime les histoires de résilience qui mettent en scène des personnages considérés comme des « zéros » qui vont devenir des héros en se surpassant. C’est vraiment ce type d’histoires qui m’ont toujours le plus touché et auxquelles je m’identifiais le plus en tant que jeune gars de banlieue.

© Tandem Films
Je voudrais aussi que l’on s’arrête sur ta longue expérience en courts-métrages dans des économies et des cadres qui me semblent assez divers. J’ai lu sur le site de La Ruche Production – qui produit certains de tes courts-métrages – que tu as d’abord réalisé une cinquantaine de petits films de façon quasiment instinctive ?
C’est les cinquante courts-métrages que personne verra jamais (rires) ! Personne ne les a jamais vus à part moi, même pas ma famille. C’est des expériences personnelles, des tentatives, des brouillons. L’idée pour moi c’était de m’exercer un maximum et d’apprendre de mes erreurs, d’apprendre en faisant. Ça m’a permis d’apprendre à filmer, à monter, à éclairer, à comprendre l’importance du son et de la musique. Je commence à mentionner mes courts-métrages à partir du moment où j’ai commencé à vraiment écrire des scénarios. Le premier c’est Marave Nachave (2012) l’histoire d’un boxeur nul mais passionné, c’est un moyen-métrage de cinquante minutes, encore une fois une histoire de zéro. C’était déjà très très « genré », très nerveux dans le style. Je pense que sans ces petits films il n’y aurait jamais eu Vermines.
Ensuite tu réalises deux courts-métrages dans un cadre qui me semble un petit plus produit, dans un circuit qui semble aussi plus traditionnel qu’est celui du court-métrage avec un producteur, avec des financements publics aussi. Il s’agit de Mayday (2015) et de Crocs (2018).
J’avais rencontré l’association Vairon dans le 93 qui essayait de soutenir les jeunes créateurs et c’est dans ce cadre qu’on a démarré et que j’ai réuni pour la première fois une équipe de collaborateurs dont beaucoup continuent de bosser avec moi aujourd’hui. C’est comme ça qu’on a fait Mayday (2015), qui n’était pas vraiment produit au sens où le budget n’était en fait que du financement participatif. Le scénario était secondaire pour nous, on voulait surtout faire un film qui choque les gens, qui envoie du lourd à l’image et au son. Le film a bien fonctionné en festivals, il a beaucoup voyagé et on a gagné pas mal de prix, ça m’a permis de faire ensuite Crocs (2018) qui lui, était en effet plus produit. On avait eu le CNC, France 2, la Région… Un budget de 100.000 euros si ma mémoire est bonne. J’ai tourné avec les mêmes équipes que le précédent, c’est un projet qui nous a permis à tous de vraiment nous professionnaliser.

“Holo” © Lourd Metrage
Un peu plus tard, tu développes avec Jérôme Niel une sorte de label, Lourd Métrage, et notamment deux courts-métrages qui sont Pas Bouger (2021) et Holo (2022) qui ont la particularité d’être auto-produits et diffusés gratuitement sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte de production de ces films et qu’est-ce qui a motivé cette envie de les diffuser ainsi ?
Le confinement a beaucoup joué là-dedans, tout ce que j’avais potentiellement mis en place pour faire de cette passion un métier s’écroulait. En sortie de crise du COVID, il m’a fallu être pragmatique, me poser les vraies questions. J’avais deux choix : soit retourner bosser à Super U ou Disneyland comme je le faisais avant, ou bien profiter de l’année blanche accordée aux intermittents pour refaire des courts-métrages avec mes potes, sans aucun budget, et essayer de voir ce qui se passe. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré Jérôme Niel avec qui on a fait d’abord les trois épisodes de Zer (2021) puis les deux films que tu cites. Le dernier en date, Holo (2022) est certainement mon court-métrage le plus professionnel d’apparence, alors qu’on l’a réalisé avec à peine 500 euros ! Mais tout le monde au sein de l’équipe commençait à maîtriser son sujet et moi-même à avoir une griffe à la réalisation, un peu plus identifiable. C’est vraiment des films de débrouille. Le chef-opérateur, Alexandre Jamin – qui a aussi fait l’image de Vermines – tournait à ce moment-là une publicité pour Disney et on avait péta la caméra le week-end pour filmer (rires). Pour ce qui est de la diffusion, j’avais été vachement frustré avec Crocs de constater qu’on est très vite dépendant du système des festivals, qui sont un peu les seuls diffuseurs possibles pour le court-métrage. C’est très compliqué du coup pour les jeunes aspirants cinéastes car en clair il y a deux choix : soit tu mets ton film directement sur YouTube et ça te dé-évalue aux yeux du milieu – d’un coup tu deviens un youtuber et alors c’est pas de l’art – soit tu vas en festivals et ton film n’est vu par personne sinon les gens de l’entre-soi du petit milieu du cinéma – parce qu’en plus ces festivals souvent veulent l’exclusivité et t’interdisent de poster ton film sur internet… J’en ai eu un peu marre de ce système-là, c’est hyper dur de mettre autant de temps, d’énergie et de sérieux dans la réalisation de courts-métrages pour qu’au final, le fait qu’ils soient visibles ou non ne dépende même pas de toi.

“Pas Bouger” © Lourd Métrage
Le fait de faire ces films avec Jérôme Niel, qui a une forte audience auprès des internautes, à dû forcément visibiliser ton travail ?
Oui, même si notre idée à l’un et à l’autre c’était de déplacer Jérôme là où son public ne l’attendait pas forcément. Dans Pas Bouger il a un rôle très dramatique. Ça rejoint une démarche plus globale, l’idée de casser les codes, de faire bouger les lignes, en tout cas, de ne pas respecter celles qui sont imposées par les systèmes du court-métrage ou de la production internet, qui sont très normés. Même si on allait diffuser les films sur YouTube, on s’est dit qu’il fallait assumer un désir de cinéma et ne surtout pas penser au rabais. Ce sont des films qui ont de l’ambition à l’image et au son. C’est vraiment ma volonté de carrière, de redonner ses lettres de noblesse au divertissement, à ce que l’on qualifie de « populaire ». Et plus généralement, de refuser ces cases. Vermines ne parle que de ça, l’idée qu’il ne faut pas mettre les choses dans des boites.
Ce qui nous intéresse c’est aussi de savoir comment on bascule du court-métrage vers le long et comment tu es approché par Harry Tordjman, ton producteur – qui a officié de longues années sur des séries de formats courts pour Canal+ (Bref, Serge le Mytho, Bloqués) puis a produit des documentaires pour la salle sur des sujets de société assez engagés – et comment démarre le projet Vermines.
Il m’avait repéré en 2013 au Mobile Film Festival où je présentai un film. Il était dans le jury et nous avait donné un prix. A cette époque, il sort du succès de Bref (Kyan Khojandi & Navo, 2011-2012) et il enchaîne les projets chez Canal, tout ce qu’il produit se transforme en or. Et pourtant, au milieu de tous les films présentés au festival, il choisit de récompenser (avec l’équipe de Bref) un film avec des extraterrestres langue-de-boeuf et des pauvres OVNIS faits sur After Effects ! Ça montrait déjà un certain appétit pour ce genres de films. A cette époque il m’avait simplement demandé : « Pourquoi tu veux faire du cinéma ? » mais j’étais encore très jeune et naïf, je pense qu’il me fallait encore dix bonnes années de maturation pour répondre à ça. Quand on s’est revus dix années plus tard, il m’a reposé cette même question avant toute chose et cette fois je pouvais y répondre : je voulais faire un cinéma des sensations, faire ressentir des émotions aux spectateurs. C’est la seule chose avec laquelle on ne peut pas tricher : ce qu’on ressent. Je voulais créer ça, une vérité. Cette réponse lui a plu et je lui ai pitché Vermines : « c’est l’histoire d’une invasion d’araignées dans un immeuble ». Et à ça, il m’a répondu, « Ok d’accord, mais ça parle VRAIMENT de quoi ? ». C’est là que j’ai pu verbaliser tout le sens profond du film, le fait de ne pas se sentir considérer comme on doit l’être parce que victimes de stéréotypes. C’était mon cas dans ce milieu : j’ai pas le parcours qu’on attend d’un jeune aspirant cinéaste, je viens de banlieue, j’ai pas fait d’école de cinéma, je fait des films d’un certain genre dont certains ont en plus été diffusés sur internet… Tout ça mêlé, je souffrais d’un vrai syndrome de l’imposteur. Harry a senti que j’avais envie de casser les murs et que derrière mon idée de petit film d’horreur j’avais un propos à défendre. Il nous a accompagnés tout au long du développement. C’est un producteur très investi et qui a vraiment envie de produire ce qu’il aime en tant que spectateur.

“Crocs” © La Ruche productions
Forcément quand on regarde rétrospectivement tes courts-métrages – tous visibles sur la plateforme Shadowz – il y a un sujet majeur qui semble lier au moins Crocs et Pas Bouger au scénario de Vermines, c’est la question de la maltraitance animale et du commerce qui en découle.
C’est en effet un sujet qui me touche tout particulièrement, mais elle rejoint ce que je te disais tout à l’heure quand on parlait des insectes. Pour moi il s’agit de donner une voix à des êtres qui n’ont pas la capacité de parler et de se défendre, les rendre beaux dans leur bestialité. Je suis fasciné par exemple qu’il n’y ait pas de notion de bien ou de mal chez les animaux, tout est très pur, même la cruauté l’est. Depuis toujours je trouve que c’est un sujet d’étude passionnant si bien que je les trouve clairement plus intéressant à filmer que les êtres humains. Très vite ce qui m’a intéressé c’est de mettre des êtres humains face à des animaux, et inversement. Dans Crocs par exemple, je souhaitais animaliser l’être humain et humaniser l’animal. Je ne parle pas d’anthropomorphisme, parce que c’est une forme de négation de la bestialité, mais je voulais essayer de donner accès aux sentiments de la chienne et générer de la compassion pour elle. Typiquement dans ce court-métrage, on a une brute épaisse qui organise des combats de chiens mis en parallèle avec une chienne forcée au combat qui veut juste retrouver ses chiots, on accède à son point de vue. Plus généralement, la cruauté envers les animaux est quelque chose qui me révulse en tant qu’homme et sur lequel je souhaite dire des choses. C’est fou que le trafic d’animaux exotiques soit le quatrième le plus important dans le monde mais que personne n’en fasse des films parce que c’est moins stylé que la drogue.
Le prologue de Vermines à ce titre est d’une incroyable efficacité, il fait presque office de note d’intention, tout y est : le propos sur les animaux, l’analogie évidente avec l’immigration et le désir affirmé de faire du spectacle.
Il y avait vraiment l’idée d’avoir quasiment les trois actes du film contenus dans cette séquence inaugurale, avec une mise en scène pensée en échos, par exemple le plan du terrier d’araignée qui renvoie au plan du couloir plus tard. Avec Florent Bernard – qui co-scénarise le film avec moi – on voulait vraiment réussir à créer une empathie immédiate pour le « monstre ». Ça fait partie des codes que d’avoir un prologue qui pose un peu l’origin story de la créature, mais on voulait les décaler un peu. Normalement, dans les films de monstres de ce genre, l’animal est un antagoniste dangereux et c’est tout, je voulais y mettre un peu plus de nuance, qu’on comprenne qu’elles sont surtout des victimes qui tentent de survivre. Car si on fait l’effort de regarder le film du point de vue des araignées, dès cette séquence, on peut avoir de la compassion pour elles. Je voulais aussi éviter l’effet Dents de la Mer (Steven Spielberg, 1975) qui a créé vraiment une peur généralisée du requin, qui perdure encore aujourd’hui. Au contraire, mon but c’était de prendre à revers les arachnophobes et leurs préjugés, qu’ils ressentent un peu de pitié pour ces araignées arrachées de leur terre pour être revendues à l’autre bout du monde.
Sans jamais asséner son message façon slogan, le film réussi à tenir un propos politique assez ferme sur l’immigration. C’est l’une des grandes forces du cinéma de genres que de pouvoir utiliser la métaphore pour dénoncer ou dire des choses très profondes sur la société.
Oui, les araignées sont ramenées en France, enfermées dans des petites boîtes dans un environnement qu’elles ne connaissent pas. L’endroit est si peu accueillant pour elles qu’elles vont être forcé de rentrer en mode survie, de devenir de plus en plus dangereuses parce que l’endroit lui-même est inhospitalier et conflictuel. Forcément oui, je parle à travers elles d’immigration et de ce que cela peut signifier d’arriver dans un pays qui ne veut pas de nous, où l’on est stigmatisé et pointé du doigt, rangé dans des immeubles qui ressemblent à un assemblage de petites boîtes où l’on entasse les gens. Ce contexte qui force l’individu à s’endurcir et à devenir plus violent pour survivre.

© Tandem Films
Parlons du travail sur le plateau avec les araignées, je t’ai entendu maintes fois parler en interview des différentes méthodes utilisées pour obtenir telle ou telle action – je ne vais donc peut-être pas te les faire répéter – mais à travers tes explications, on sent surtout une vraie démarche éthique autour du travail avec des animaux, qui rejoint assez naturellement le propos de tes films..
C’est une question capitale. Je crois que d’abord, l’une des premières choses nécessaires quand on travaille avec des animaux c’est d’être en capacité de se rendre flexible. Sans cela, on peut s’acharner à essayer d’obtenir des choses et du coup contrevenir au bien être animal. J’avais déjà travaillé avec des chiens donc j’avais complètement acquis cette notion-là, d’apprendre à repenser sa mise-en-scène en fonction de ce que l’animal est en capacité de te donner ou non. Dès qu’on a envisagé qu’il y aurait des vraies araignées sur le plateau, on s’est tout de suite mis en recherche de quelqu’un qui les connaissait parfaitement et qui saurait nous dire précisément ce qu’elles peuvent faire et comment le faire. On a donc travaillé avec un éleveur, Karim Daoues de La Ferme Tropicale, qui a vraiment un amour incommensurable de ces petites bêtes et qui est réputé dans le milieu pour ses conditions d’élevages hyper éthiques et adaptées. Même lui, il ne vends pas ses animaux à n’importe qui, il vérifie que les personnes ont la possibilité d’accueillir et de s’occuper convenablement de chaque espèce, c’est hyper contrôlé. On a essayé aussi de rendre le plateau le plus safe possible pour les araignées, de s’assurer qu’aucun membre de l’équipe n’allait paniquer à leur approche, on ne voulait pas d’un mauvais réflexe et que quelqu’un en écrase une par exemple… Pour cela, une assistante caméra s’est faite hypnotisée pour vaincre cette phobie et deux des actrices, Sofia Lesaffre et Lisa Nyarko, ont été en formation chez Karim pour mieux appréhender les araignées et en avoir moins peur. Et puis, outre le tournage, il y a l’après qu’il a fallu penser aussi. Elles n’ont pas une espérance de vie très longue, mais en attendant qu’elles meurent de vieillesse, il a fallu trouver aux deux cent araignées qu’on a fait travailler, des solutions de replacement, dans des conditions correctes.
Quelle a été le rôle concret de Karim sur le projet, il ne s’est pas contenté de vous fournir les araignées j’imagine ?
Non pas du tout, d’abord il a travaillé avec nous en amont pour nous aiguiller sur le choix de l’espèce. C’est quelque chose de pas anodin car on cherchait une araignée avec certaines caractéristiques physiques très définies, mais il fallait quand même trouver l’espèce qui serait la plus adaptée aux conditions de tournage. Sur le plateau, il était là pour veiller à leur bien-être mais aussi nous donner ses conseils pour obtenir d’elles certaines choses. On ne peut pas dresser une araignée, donc il faut connaître parfaitement l’ensemble de leurs comportements pour les inciter à faire telle ou telle action.
C’est intéressant ce que tu racontes car tu n’es pas sans savoir que le métier de dresseur animalier pour le cinéma a été très décrié ces dernières années, certaines des grandes figures françaises du milieu ayant été pointé du doigt pour leurs méthodes de travail assimilées très nettement à de la maltraitance. Contre ces méthodes, d’autres animaliers développent une technique qui s’apparente plus au comportementalisme animalier. Ils analysent les caractéristiques de l’espèce et la variété de caractéristiques individuels au sein de cette même espèce. Ainsi un loup craintif jouera les scènes où le loup est craintif, un loup agressif les scènes où le loup est agressif. L’animal n’est jamais forcé à jouer contre-nature. Bien sûr, il semble compliquer de faire autrement avec les araignées puisqu’on ne peut pas les dresser, mais c’est une méthode qui te parle ?

“Crocs” © La Ruche productions
Complètement. Sur Crocs je n’ai pas travaillé avec un dresseur animalier. La chienne – qui est aussi dans Vermines – n’est pas un animal dressé pour le cinéma. Je connaissais bien Samir, son maître, et j’avais une totale confiance dans sa relation avec son animal. Lui-même ne souhaitait pas lui faire faire des choses sous la contrainte. Pour cela, il faut être en capacité de s’adapter, se donner la possibilité d’être flexible comme je le disais, c’est vraiment la clé. Si tu es sur un énorme film ricain et que toute la lumière et la caméra sont impossible à déplacer sans perdre une demie heure sur le plan de travail, c’est compliqué et c’est le début de la catastrophe. Car c’est le problème à mon sens avec certains dresseurs animaliers – fort heureusement ils sont pas tous comme ça – c’est qu’ils sont engagés pour leur capacité à faire faire des choses à des animaux. Ils doivent donc rendre des comptes. Mais dès que de l’argent et la réputation est en jeu, ils peuvent commencer à stresser si l’animal ne fait pas ce qu’il est censé faire et du coup être tenté de mettre les animaux sous pression pour y parvenir. On connaît tous cette vidéo tragique sur le tournage de Mes vies de Chien (Lasse Hallström, 2017) où l’on voit un dresseur balancer un berger allemand à la flotte parce qu’il a besoin qu’il soit filmé entrain de nager d’un point A à un point B. Le chien panique et manque de se noyer. Fort heureusement ces images sont sorties et le film a été totalement boycotté. Je ne pense pas que tous les dresseurs fonctionnent ainsi, mais je sais que cela existe, alors, pour éviter que cela ne se produise sur l’un de mes plateaux, je ne travaille pas avec des dresseurs de cinéma. Je fais autrement.
L’une des grandes qualité du film ce sont ses effets-spéciaux et plus spécifiquement ton habilité à transitionner des vraies araignées à leurs doublures numériques sans que cela ne se voie jamais. Je voudrais donc te faire parler du travail avec MacGuff – studio responsable des effets-spéciaux numériques du film, mais aussi cette année de ceux du Règne Animal (Thomas Cailley, 2023) – est-ce qu’ils étaient présents sur le tournage ?
On avait deux superviseurs VFX de chez eux – Leo Ewald et Thierry Onillon – qui étaient là sur le plateau pour nous aider dans les prises de décision et s’assurer qu’on leur fournirait tous les éléments nécessaires pour la bonne réalisation des trucages. D’abord, on a essayé de tourner un maximum de choses avec les vraies araignées. On savait que même si on n’avait pas totalement le plan parfait, ça pourrait faire office de références pour les équipes de MacGuff par la suite, ne serais-ce qu’en terme de lumières, etc… Et puis, il ne faut pas oublier qu’on avait aussi à notre disposition des araignées SFX imprimées en 3D, avec une armature en fil de fer pour être manipulables. Elles ont été conçues par Atelier 69. On a donc eu recours à toute une gamme de techniques différentes qui s’alternaient selon les besoins de chaque plan. Mais tout ça n’était pas improvisé sur le moment, c’est le fruit d’un long travail de préparation pour définir en amont quel plan allait utiliser telle ou telle méthode. La seule chose qui nous est arrivée c’est de supprimer des plans VFX parce que les araignées réelles nous avaient offert des actions vraiment cool et qu’on ne pouvait pas rêver mieux. Ça a été salvateur, car nous n’avions pas un énorme budget et un plan VFX ça coûte très cher !
Est-ce que les techniciens des effets spéciaux ont aussi été amenés à observer voire même utiliser les araignées réelles ?
Ils ont filmé un nombre incalculables de « plates » (des images le plus souvent sur fonds verts, qui servent de bibliothèque de références et/ou d’usage aux effets-spéciaux, ndr) – des araignées sous tous les angles, faisant tout un tas d’action, des textures de toiles, etc… – et l’Atelier 69 avait aussi créé des modélisations en 3D sur lesquelles ils se sont basés pour leur propre travail d’effets spéciaux pratiques. C’est le cumul de tout ça qui a permis à nos araignées numériques d’être aussi réalistes.

© Tandem Films
Concrètement, comment cette contrainte des effets spéciaux a-t-elle un impact sur des décisions de mise en scène ?
Ça demande constamment d’être en capacité de projeter dans son esprit ce à quoi ça va ressembler. Il faut donc savoir éclairer et cadrer correctement quelque chose qui n’est même pas là physiquement devant tes yeux, ça demande une réflexion, une anticipation de tout un tas de facteurs. Typiquement sur un plan fixe, tu vas éviter d’avoir une lumière trop prononcée et frontale parce que tu sais que derrière, le photo-réalisme des araignées numériques risque d’être un peu bancal. Donc très vite tu penses à les dissimuler partiellement dans la pénombre, en utilisant le clair-obscur. C’est l’un des grands enseignements d’un film comme Jurassic Park (Steven Spielberg, 1994). A l’époque Spielberg a conscience des limites de cette nouvelle technologie et il doit lui aussi faire fonctionner les uns avec les autres des animatroniques et des dinosaures numériques. Pour ça il a cette idée de génie de filmer son tyrannosaure de nuit, derrière des arbres et sous la flotte. Pour moi c’était évidemment une source d’inspiration d’autant plus que je partais du principe à l’époque, qu’au vu du budget du film, mes effets n’allaient pas être fous. Au final, les équipes de MacGuff ont tellement adoré le projet qu’elles ont livré des plans très largement au dessus de mes attentes. Pour tout te dire, les plans VFX étaient tellement bien que j’ai un peu regretté de ne pas avoir plus souvent fait des plans où l’on voit les araignées numériques en pleine lumière.
Le choix de l’espèce est très intéressant parce qu’elle est prend le contrepied total de l’araignée au cinéma, souvent une mygale disproportionnée, poilue, purulente et avec des crocs acérés. Celles que tu mets en scène sont moins exotiques, elle ressemblent presque à s’y méprendre à l’araignée qu’on peut croiser dans nos salons. C’est plutôt malin parce que ça convoque en nous des peurs encore plus intimes.
L’une des idées de Vermines était de dépoussiérer les codes de la natural horror qui ont toujours eu une connotation un peu série B. A l’époque, le choix d’utiliser des mygales ou des tarentules étaient à mon sens pragmatique. Ils n’avaient pas d’effets spéciaux numériques et ces araignées sont parmi les plus grosses et lentes, donc elles incarnaient plus facilement le gigantisme. Nous ce n’était pas forcément notre angle, il ne s’agit pas d’un film de monstre géant. J’ai donc eu en effet envie d’aller chercher une espèce qui nous ramènerait davantage à notre vie de tous les jours et donc à des peurs quotidiennes. On a choisi la Heteropoda Maxima, une espèce du Laos, parce qu’elle a des points communs avec la tégénaire domestique, cette grande araignée à longues pattes qu’on a tous à la maison dans la salle de bain. Avant de faire ce choix, on a pas mal interrogé des arachnophobes pour essayer de comprendre ce qui leur faisait peur chez les araignées, et souvent les longues pattes sombres et l’imprévisibilité de leurs mouvements, le fait qu’elles puissent courir super vite, faisait partie des éléments les plus récurrents. L’Heteropoda avait ses caractéristiques tout en ayant aussi la possibilité d’être beaucoup plus grosse. La seule chose sur laquelle on a triché c’est que c’est une araignée qui ne tisse pas de toile en vérité.
Elle a aussi quelque chose de très graphique, façon ligne claire, est-ce que cette simplicité-là dans ses traits, l’a rendu plus facile à animer en 3D ?
Pas vraiment, au contraire même parce qu’elle se déplace super vite et de façon imprévisible. Les artistes de VFX ont tendance à vouloir trouver ce qu’on appelle des patterns (modèles d’animations types qu’on peut ensuite dupliquer ou légèrement adapter au besoin, ndr) pour gagner du temps d’animation par la suite. Donc dès le départ ils ont essayé d’en fabriquer quelques-uns pour la marche de nos araignées mais je n’y croyais pas, j’avais l’impression de voir une araignée de jeu vidéo, comme celles de Diablo 3. On s’est donc mis à ré-observer l’Heteropoda Maxima et on a constaté qu’en fait, elle a deux pattes avant qui servent principalement de radars ou d’antennes et les six autres qui font office de mécanique. Mais ce n’est pas une mécanique cadencée, chacune des pattes est capable d’agir indépendamment de l’autre ce qui rend leur mobilité assez difficile à retranscrire en pattern, c’est cette imprévisibilité qui les rendent d’ailleurs aussi flippantes. On a donc essayé de trouver quelque chose, au contraire, de totalement aléatoire, tout en étant cohérents bien sûr avec les séquences et les objectifs des araignées : est-ce qu’elles attaquent, est-ce qu’elles fuient, est-ce qu’elles sont désorientées ou apeurées ?

© Tandem Films
Je voudrais forcément t’amener sur une séquence en particulier qui pour moi est une masterclass. C’est celle de la salle de bain. Un court-métrage à part entière, avec ses pics de tensions, ses retombées et qui non sans humour arrivent admirablement à mêler une horreur graphique et sensorielle puissante à un aspect quotidien, au sens où la situation nous rappelle forcément à tous et à toutes des moments vécus. Ce que je trouve fort, c’est que c’est une séquence extrêmement ludique, et qui tend à re-convoquer chez ceux et celles qui jureraient qu’ils ne sont pas arachnophobes des réflexes de peur qu’ils ont tous pu avoir dans pareille circonstance.
On l’a vraiment conçue comme une séquence pivot, c’est un chapitre important du récit qui nous fait basculer véritablement vers quelque chose de plus horrifique. Pour moi elle est aussi la synthèse de ce qu’est le film : elle est flippante mais aussi un peu drôle, elle est ludique et en même temps chaotique, elle déploie des codes d’un truc un peu réaliste et quotidien et en même temps c’est l’un des moments où l’on pousse le plus (dans le début du film) les effets sonores et la musique… Tout est concentré dedans. Déjà dès l’écriture, avec Florent, on voulait condenser dans la scène à peu près toutes les peurs lambda des arachnophobes : les araignées dans les conduits, sous le meuble et qu’on ne voit pas, dans les vêtements, qui sortent de la douche, tu écrases la maman mais ça fait sortir des milliers de bébés… Après, même si c’était une séquence, comme toutes les autres, très préparées en amont, avec chaque plan storyboardé scrupuleusement et tout, c’est l’araignée qui encore une fois nous a offert bien plus de choses qu’on ne le pensait. Typiquement sur une séquence comme ça, on tourne d’abord les plans de l’araignée, puis ensuite, on adapte les plans avec les acteurs pour qu’ils puissent réagir exactement à ce que l’animal nous a donné. C’est ce qu’on a donc fait avec Finnegan (Oldfield), en lui demandant de jouer ses réactions. Mais j’avais besoin aussi d’un plan qui le réunisse lui et l’araignée dans le même plan. J’ai eu cette idée qu’il se saisisse d’un verre pour la capturer mais que l’on se rende compte de la vraie taille de l’araignée en comparaison avec le verre. Cette notion d’échelle était importante. A ce stade, elle est subtile, parce que les araignées ne sont pas aussi énormes qu’à la fin, mais c’est la première fois où le spectateur se dit « D’accord, super, elles grossissent… ». Je demande à Finn’ si ça va le faire pour lui, il me dit que oui, mais je comprend très vite qu’en fait pas trop ! (rires). Grâce à cette peur qu’il essayait de contenir, on a obtenu des réactions super ambigües et très drôles ! Ça fait partie je pense du ressenti dont tu parles, parce que ça parle à tout le monde, ce mec qui veut faire le bonhomme mais sursaute dès que l’araignée bouge une patte.
C’est aussi une pure séquence de montage, car tu dois faire fonctionner trois espaces en un – Finnegan avec l’araignée, Sofia enfermée dans la douche, les autres dans le couloir – tout en veillant à rester lisible et à maintenir la tension.
Oui et c’est d’ailleurs une séquence qui s’est vraiment trouvée au montage. Tout le monde savait qu’elle était cruciale mais elle rendait aussi pas mal sceptique, car il y avait beaucoup d’enjeu autour d’elle. J’ai tardé à la montrer aux gens, car si j’étais en capacité de me projeter et que je savais à quoi je voulais que cela ressemble, c’est souvent très énergivore de devoir rassurer tout un tas de personnes sur le fait que la séquence n’est pas ratée et qu’elle va être chan-mé. J’avais demandé à ce que l’on me fasse confiance, qu’on me laisse expérimenter, faire des allers-retours avec le sound design et le compositeur pour trouver la scène. C’est une séquence très métronomique et on a utilisé les violons pour marquer des temps, faire monter crescendo la tension. Ce genre de séquence nécessite dès le montage d’être habillée et maquillée pour fonctionner, je sais que si je bosse bien le son et que je plonge les spectateurs dans la tension, y a un truc de codes qui fait que « Pop ! Ça fait des Chocapics ! ».
Quand on sort de la séquence en tant que spectateur on est forcé de se dire « il nous a tout mis, maintenant, il a un intérêt à tenir les promesses derrières, à nous donner encore plus ! ».
C’était l’idée, je voulais que ce soit une séquence qui tiennent les gens en apnée, qui suscite des réactions dans la salle, des cris, des rires. Quand on coupe au noir à la fin, on le voit en projection, les gens relâchent tout mais ils sont chargés pour la suite. Comme je te le disais plus tôt, c’est une scène pivot, après cette séquence on abandonne l’idée de l’araignée domestique. La menace n’est plus dans la salle de bain ou sous le canapé du salon, elle envahit tout un immeuble, elle mute. Et donc les enjeux de mise en scène se revitalisent aussi du fait que la menace grandit, littéralement.

© Tandem Films
Les réactions du publics ne me semblent pas venir seulement des artifices de peur, mais aussi du fait que tes comédiens y croient tellement fort que l’identification à eux et à leur peur est beaucoup plus facile.
C’est ce que je n’arrêtais pas de dire aux comédiens : « Les araignées, comment on les gère, c’est mon affaire, vous, croyez en ce que vous jouez ! ». C’est un film de personnages, c’était important qu’ils existent chacun très fort, qu’ils jouent ensemble, qu’ils soient crédibles en tant que groupe mais aussi en tant qu’individus. Chacun et chacune ont beaucoup donné pour affiner les personnages. Durant les lectures, avec Florent, on les a beaucoup écoutés parler pour que les dialogues et la caractérisation de chacun soient plus efficaces. On a eu de la chance aussi de réunir un casting de jeunes comédiens qui a aucun moment prenait de haut la démarche du film d’horreur. Ils avaient envie de faire bouger les choses, de raconter des histoires différemment que ce que le cinéma français a l’habitude de faire. Ils ont pris un risque. Sur le papier, « une invasion d’araignée dans un immeuble », y a pas beaucoup d’acteurs, même peu confirmés, qui auraient eu le courage de s’y jeter aveuglement, parce qu’il y a toujours la crainte de jouer dans un navet.
Ce qui ressort du film et de ton propos, c’est aussi quelque chose qui tient de l’élan générationnel.
On se reconnaît dans nos envies de cinéma, dans nos références, en grande partie parce que l’on est de la même génération trentenaire. C’est le cas aussi de l’équipe technique, c’est des gens avec qui je bosse depuis quinze ans, avec qui j’ai grandi professionnellement voire intimement, donc on parle le même langage.

© Tandem Films
Ce qui plaît aussi c’est le fait que Vermines assume ses effets, il n’a pas peur de la mise en scène, des codes, notamment dans son usage du son et de la musique. L’identité sonore – même si ça paraît un poncif – participe totalement à créer ce climat de peur. Je voudrais donc te faire parler du travail de montage son et principalement du processus pour créer et définir l’empreinte sonore de ces araignées.
L’équipe son qui bosse avec moi, que ce soit César Mamoudy au montage son ou Vincent Cosson au mixage, c’est encore une fois des gens avec qui je travaille depuis des années et qui connaissent vraiment très bien ma façon d’envisager le son. Typiquement, César sait que je suis le genre de relou à demander à ce qu’un bruit de porte ne soit pas juste un son de porte de sonothèque, mais un assemblage de sons divers pour créer la sonorité parfaite. Ce qui était par contre assez nouveau pour nous, c’était de créer complètement le son d’une créature. On a d’abord cherché à savoir s’il existait des sons d’araignées et c’est bien sûr le cas, elles ont des muscles et de nombreuses espèces utilisent les stridulations de ces parties-là pour communiquer. On a donc écouté des enregistrements scientifiques de ces sons pour s’en inspirer. Très vite, on a suivi l’idée qu’il fallait partir du réel et l’amplifier. Je voulais aller trigger des zones chez le spectateur, créer des variations de tonalité, ajouter des sons presque humanoïdes… Utiliser tout un tas d’éléments comme ça qui peuvent générer un inconfort chez les gens. L’un des enjeux du son c’est qu’il devait aussi prendre en charge le hors-champs et à travers lui, renseigner le spectateur sur une menace parfois invisible. Typiquement quand les araignées commencent à grossir, on ne les voit pas immédiatement à l’image mais on ne reconnaît pas la tonalité sonore des petites araignées à laquelle on s’est habitué. On a utilisé des résonances plus graves, ça nous semble tout de suite plus étrange et nous alerte sur le fait que la créature qui fait ce bruit-là est certainement beaucoup plus grosse que celles qu’on a déjà vues. Pour trouver ces petits détails sonores qui allaient enrichir l’identité de nos araignées on est vraiment passés par une phase d’expérimentation, dans un auditorium de bruitages, à écouter le son de tout un tas d’objets et matières. Pour finir c’est l’association de trois sons différents qui ont donné nos stridulations : une corde tendue qui frotte sur une caisse de résonance en bois, des frottements de brindilles sèches et des billes dans un tube.
Là aussi, ça nous ramène à Jurassic Park et cette fameuse légende autour du son emblématique du cri du T-REX.
Bien sûr, on s’inspire forcément des expérimentations de nos prédécesseurs surtout quand elles sont réussies. Plus généralement, c’est un film qui revenait beaucoup comme référence à l’écriture, surtout dans la bouche de Florent (Bernard) qui m’en parlait souvent. A titre personnel, je me méfie des références quand j’écris et réalise, par peur d’être cannibalisées par elles. Mais l’association entre Jurassic Park et Vermines me paraît quand même évidente, puisqu’on recherche la même ambiguïté autour du monstre, divertir et faire peur à la fois. Les dinosaures de Spielberg nous ont quand même enseigné ça : on peut tomber fou amoureux ou en fascination d’une créature qui nous terrifie.

© Tandem Films
Vermines est aussi un huis clos et on a souvent tendance à considérer l’espace clôt, restreint, comme une contrainte. En tant que spectateur, j’ai plutôt eu la sensation que cet immeuble devenait au contraire pour toi un espace ludique, un grand terrain de jeu de mise en scène.
À l’écriture, on évoquait pas mal Die Hard (John McTiernan, 1988) comme un modèle d’utilisation de l’espace unique de façon ludique. Dans le film de McTiernan comme dans le mien, on parle d’un huis clos mais malgré tout, dans chacune de nos tours, il y a tout un tas d’espaces différents à filmer. Dans notre cas, dans la deuxième partie du film, il y avait un vrai enjeu narratif à ce que l’on sache précisément où les héros se trouvaient dans l’immeuble, sans avoir besoin de le préciser par du dialogue. Donc, pour pouvoir se focaliser en terme de mise en scène sur l’action, la tension, les enjeux émotionnels, il fallait que cette cartographie du lieu soit bien posée dès le début. Dans Die Hard, ça passe par des détails dans le décor, si on voit un poster derrière lui, alors on sait qu’on est à tel étage, etc… C’est ce qui nous a inspiré pas mal d’idées scénaristiques, ou à motiver la nécessité de faire passer nos personnages dans certains décors dans la première partie parce qu’on en avait besoin dans la seconde. Par exemple, il était hyper important que le public comprenne que le couloir des caves menait au parking. Une fois qu’on est assuré que la configuration de l’immeuble est comprise, quand on revient dans ces lieux, je peux me permettre des angles différents sans craindre de perdre les spectateurs.
L’immeuble est en grande partie un décor de studio et pourtant son identité visuelle et sonore est extrêmement authentique.
Je l’ai traité comme un personnage à part entière. Le travail mené au son était assez similaire à celui qu’on a fait sur les araignées. Je voulais qu’il sonne de façon particulière et que son identité sonore évolue au fil du film. A mesure que la catastrophe se répand, il sonne comme un navire rouillé entrain de sombrer, ça grince, tous les sons sont pressurisés. Ça participe complètement à l’atmosphère anxiogène et claustro qui s’installe progressivement, y compris à l’image.
Ce qui m’a aussi beaucoup marqué concernant l’écriture, c’est que certains codes du genre s’appuient sur le décor et sa spécificité. Je prends l’exemple des ascenseurs et lumières défaillants ou en panne qui en plus d’être des supports de mise en scène racontent quelque chose de l’état de délabrement dans lequel on laisse les immeubles de cité.
C’est purement du vécu. Petit, quand il fallait descendre les poubelles, ça me terrifiait de savoir que vu que le minuteur de la lumière marchait une fois sur deux, tu n’étais jamais sûr d’avoir vraiment une minute avant que le local poubelle soit plongé complètement dans le noir. Même tout ce jeu avec les capteurs de détection de mouvements qui galèrent quand tu rentres chez toi la nuit, ça parle à tous les jeunes de banlieue ! Plus généralement, ça servait aussi la caractérisation de notre personnage principal, Kaleb (Théo Christine), qui habite un immeuble qui est en train de rendre l’âme et qu’il essaye désespérément de garder au moins propre.

© Tandem Films
Parlons aussi du décor extérieur qu’on voit peu mais suffisamment, cette barre d’immeuble, Les Arènes de Picasso à Noisy-Le-Grand, dont l’architecture évoque une ruche ou une toile d’araignée. J’imagine qu’outre le fait que tu y as vécu, ce choix spécifique n’était pas anodin ?
C’était évident, car dans chaque petite fenêtre ou habitations, il y a une petite vie, ça fait un parallèle immédiat avec l’installation vétuste de Kaleb pour loger ses espèces tropicales qui sont entassées les unes sur les autres, dans des petits vivariums. A l’international, beaucoup de spectateurs sont persuadés que c’est un immeuble qui n’existe pas et qu’on a créé en effets spéciaux dans le but premier de rendre parlante cette analogie. Mais non, il existe bien.
L’une des images les plus politiques du film n’a pas besoin de grand discours dialogué pour prendre du sens, c’est celle de cet immeuble qu’on explose à la dynamite. On laisse pourrir les problèmes durant des années puis dès qu’il y a un point de non-retour, on rase.
Exactement, et là aussi, c’est du vécu. D’ailleurs, le plan qui précède est tout aussi politique, je montre un panneau avec l’immeuble qu’ils vont reconstruire sur les ruines de celui-ci. C’est plus beau d’apparence, plus vert, mais dans le fond, ça reste un entassement de petites boites. C’est ce qui se passe dans pas mal de cités en France : on laisse pourrir les immeubles sur le long terme, aucun entretien, les gens vivent dans des endroits où la peinture s’effrite, les murs pourrissent et où plus rien ne fonctionne. Malgré tout, les habitants de ces immeubles sont attachés à leurs logements, pour certains ils y vivent depuis dix ans ou plus, ils y ont créé des souvenirs, ils y ont élevé leurs enfants, ils y vieillissent. Puis d’un coup, on leur dit qu’il faut sortir du terrier dans lequel on les a terrés, et on le dynamite devant leurs yeux. C’est méga violent. Et puis derrière, ça met des familles entières sur le carreau qu’il faut reloger, ça dé-tisse des liens sociaux importants, les gens sont parfois obligés d’aller vivre ailleurs et de s’éloigner de leur famille, de leurs amis. Lors de la projection du film à Noisy-le-Grand, ce plan a vraiment marqué les spectateurs, c’est une vision cauchemardesque pour eux.
Évoquons l’espace de financement et notamment sur cette question assez précise d’un projet qui dépend pour beaucoup de sa réalisation, des effets. Comment avez vous fait, ton producteur et toi – dans un contexte français où la recherche de financement est extrêmement dépendante du papier, du scénario et où l’on te demande souvent plus d’expliquer ou de justifier le pourquoi plutôt que le comment – pour faire comprendre que beaucoup d’éléments narratifs, du propos profond du film aussi, allaient passer d’abord par la mise en scène ?
C’est difficile de répondre à cette question car je ne voudrais pas donner l’impression que je détiens le manuel de « comment faire pour réussir ». Je peux juste t’expliquer comment ça s’est passé pour nous et comment on s’est adaptés à tout ça. Déjà je le répète souvent, mais je pense très fort que faire un long-métrage relève du miracle. Car dans tout le processus de recherche de financements, a priori, tout représente des obstacles à sauter, des pièges à éviter, des bonnes ou mauvaises directions à prendre. Il y a donc à mon avis un facteur chance important là-dedans, il faut être là au bon moment et devant les bonnes personnes. Après l’écriture de notre première version de scénario avec Florent, je savais que malgré ses qualités, le scénario n’allait pas suffire. Il allait falloir convaincre. Donc très concrètement, Vermines ce n’est pas qu’un scénario de 90 pages, c’est aussi un dossier de 150 pages de dessins préparatoires, de moodboards, de recherches graphiques en tous genres – une partie du contenu de ce dossier seront d’ailleurs visibles dans le livret qu’on va mettre dans l’édition Blu-Ray collector qu’on est en train de concocter. C’était très important pour que la lecture du scénario soit teintée d’emblée d’une direction artistique claire. L’idée c’est d’éviter que les lecteurs se posent la question de « à quoi ça va ressembler » ou « comment ils vont faire ça ». Après notre parcours est particulier parce que les premiers à monter sur le film sont Netflix France. Au début, l’ambition c’était de faire un Netflix Original, destiné aux plateformes. Et contre toute attente, ils reviennent vers nous en nous disant « On veut le faire, mais on veut le sortir en salles, on pense que c’est un film qui prendra tout son sens avec un public qui hurle ».

© Tandem Films
A l’époque de leur arrivée sur le marché, tous les boucliers se sont levés pour dénoncer le risque que les plateformes s’emparent des talents, on présageait même la mort du système français et des salles de cinémas. Voilà donc une production telle qu’on n’en fait plus en France, qui sort en salles et cartonne produit par Netflix…
On était les premiers surpris ! Mais ce n’est pas sans revers de la médaille : quand ils produisent un film pour leur plateforme, la plupart du temps ils le produisent à 100% ou quasi. Dans notre cas, ils ne pouvaient être producteurs qu’à 30% donc il a fallu aller chercher les 70% manquants ! Harry est donc allé à la chasse aux financeurs pendant que Florent et moi continuions d’affiner le scénario. Je dois dire que le fait que Netflix se positionne sur le film avec l’ambition de le sortir en salles n’a pas surpris que nous mais l’ensemble de la profession aussi. Ça a certainement rendu curieux beaucoup de monde à propos du projet Vermines et a donc quelque peu facilité les rendez-vous. Ce qui a été déterminant, c’est la rencontre d’humain à humain, notamment pendant Cannes, où l’on est allés au charbon pour parler du film aux gens qui pouvaient supposément s’y intéresser et y mettre de l’argent. Je pense qu’incarner le projet a beaucoup compté nous concernant, car si la rencontre opère, si tu parles bien de tes intentions et que tu donnes l’impression de savoir où tu veux aller et pourquoi tu veux le faire, tu captes l’attention des personnes en face et le projet leur reste en mémoire. On a même eu le luxe de choisir qui allaient être nos partenaires car beaucoup de monde voulait le faire au final. En définitif, c’est beaucoup de boulot mais aussi de la chance.
Mais de ce fait, la locomotive Netflix aidant, vous n’avez pas eu besoin de passer par les aides publiques telles que le CNC, les régions etc ?
Si on a déposé à tout ça, parce qu’on a toujours besoin de plus d’argent. Mais on en a eu aucun ! Le film n’était vraiment pas compris malgré le dossier. On a eu deux refus de la région Île-de-France sous prétexte que le film était « trop rock’n’roll » ! Ne pas donner cette aide à un gamin de Seine St-Denis qui depuis quinze ans, ne filme que dans sa région, et s’acharne à montrer l’urbanité et sa beauté… J’étais dégoûté. Quand j’ai lu ce retour, je me suis dit « Ok, si ce sont des gens de 70 piges qui lisent mes dossiers, c’est sûr que j’aurai jamais leur soutien ». C’est un peu le problème de ces commissions et du système globalement – même si ça bouge parce qu’une nouvelle génération arrive progressivement aux manettes – c’est qu’il y a un fossé générationnel entre ceux qui décident et ceux qui font. Ça participe d’ailleurs d’un certain entre-soi et d’un mépris de classe. On a eu une seule aide, qu’est l’aide spécifique aux effets spéciaux, mais c’est Alexandre Aja qui était le président du jury. Le mec a beau être un fils de réalisateur, il a aussi été un jeune qui voulait faire des films de genres en France, qui n’a pas été soutenu comme il aurait dû l’être, qui aujourd’hui mène une carrière aux Etats-Unis et qui pourrait clairement déserter le terrain, mais non, il veut justement soutenir des jeunes cinéastes français, ne pas reproduire les erreurs de ses aînés.

© Tandem Films
J’ai aussi l’impression que l’on essaie d’opposer deux camps. D’un côté un cinéma de genres qu’on appelle communément « d’auteur » qui pratiquerait une stratégie d’hybridation soupçonnée d’être opportuniste voire d’être un cheval de Troie ; de l’autre un cinéma de genres qui aurait un rapport plus pur au divertissement pour certain, ou plus infantile (voire idiot) pour d’autres. Alors qu’en réalité l’un des dénominateurs commun entre ton projet et Le Règne Animal par exemple, c’est qu’ils jouent de façon très maîtrisée et équilibrée sur les deux tableaux. Vermines est indéniablement un film hybride, notamment dans le fait qu’il convoque par son propos, par son décor, tout un pan du cinéma d’auteur français récent (le film de banlieue notamment) qui transporte avec lui des sujets de société très forts.
Je pense qu’on a un vivier de jeunes cinéastes aux personnalités très riches, qui font un cinéma très transversal entre différentes influences. C’est dommage que les institutions soient un peu lentes à soutenir la diversité sous toutes ces formes parce qu’elle fait vraiment la richesse de cette nouvelle génération. Si on arrête un moment de mettre les cinéastes dans des cases prédéfinies, potentiellement ça va donner des propositions différentes, inattendues. Franchement, pour moi je suis un auteur. Vermines est un film d’auteur. Mais c’est aussi un film de divertissement. On revient à ça, c’est un truc générationnel, on est une génération qui a grandi avec Jurassic Park, pas avec la Nouvelle Vague. Notre vision du divertissement elle est assez pure, pour nous c’est quelque chose de noble, dans lequel peuvent s’exprimer des cinéastes qui savent faire et savent dire des choses. C’est aussi un cinéma qui a la possibilité de rassembler tous les types de spectateurs. Si tu souhaites juste passer un bon moment devant un spectacle sensationnel, tu en as pour tes quinze balles, si tu es intéressé par le propos et seulement ça, t’as de quoi penser au film et son sujet pendant une semaine. Et peut-être même que tu accéderas aux deux versants du truc quand même, tu vas te divertir pendant et réfléchir après. J’essaie de pas oublier que le public est multiple et que pour plein de monde venir au cinéma c’est pas anodin financièrement, c’est important ça aussi.
C’est une transversalité sans catégorisation que l’on retrouve notamment dans le cinéma sud-coréen contemporain et qui est en grande partie responsable de sa réussite.
Carrément, c’est un super exemple et je m’étonne de pas t’avoir encore parlé de cinquante films sud-coréens depuis le début de l’interview ! (rires) Un film comme Parasite (Bong Joon-Ho, 2019) est vraiment l’une des meilleures illustrations de mes précédents propos, c’est un film avec un sujet social hyper fort mais qui est vraiment très divertissant, très rassembleur, son succès en salles n’est pas étonnant parce que ce n’est pas un film de niche. Un autre exemple qui me parle très fort c’est Get Out (Jordan Peele, 2017), pour les mêmes raisons.
Le film a fortement fonctionné sur le jeune public disait-on perdu à la cause des salles voire même irréconciliable avec le cinéma français tout court. On a souvent entendu ici des cinéastes nous parler d’une nécessité à aller chercher cette audience, à la ramener au cinéma en lui proposant des films pas seulement qui parlent d’eux mais qui, en tout cas, s’adressent à eux. Est-ce que tu te reconnais dans cette démarche ?
Totalement. Après son passage à Venise, Vermines a fait sa première en France à L’Etrange Festival et à la fin de la projection un jeune spectateur qui devait avoir seize ans est venu spontanément me voir pour me dire « je te remercie, c’est la première fois que je vois un film français qui parle mon langage, qui me représente». Forcément ça fait plaisir car je repense au jeune de banlieue que j’étais et qui se plaignait de ce manque de représentation-là. Mais je ne vois pas ça comme un truc d’entre-soi non plus, je pense que justement avant on parlait de culture urbaine – il y avait une façon de s’habiller très spécifique à la banlieue, l’esprit hip-hop tout-ça, c’était marginal. La génération actuelle elle est aussi vachement transversale à ce niveau-là. Culturellement elle s’abreuve partout, elle accepte moins les cases.

© Tandem Films
C’est assez rare pour nous d’avoir la possibilité de rencontrer un cinéaste après la sortie de son film, si bien qu’on aborde souvent les questions de distribution et d’accueil du public par l’expectative. J’en profite donc pour revenir sur cette sortie qui me semble, d’un regard extérieur, être un coup de maître de la part de ton distributeur Tandem (255.000 entrées au jour où l’on publie) Toute la réputation de Vermines s’est construite petit à petit, par sa carrière festivalière d’abord puis par ce bouche-à-oreille positif mais aussi par une campagne marketing très inspirée et tournée vers la jeunesse, notamment sur les réseaux sociaux.
Dès le premier rendez-vous avec le distributeur Mathieu Robinet de chez Tandem j’ai été clair quant au fait que je souhaitais être présent à toutes les étapes de la sortie du film. Pour moi, c’est le prolongement direct de mes intentions de réalisateur, donc la bande-annonce ou l’affiche ce sont des choses qui sont importantes pour moi et sur lesquelle j’ai un avis à donner. Même en ce moment on travaille sur l’édition vidéo, je ne lâche rien, je veux que chaque chose qui soient proposée dans les bonus soit contrôlée, bien faite. Mais on ne s’est pas engagés avec Tandem uniquement parce qu’ils consentaient à me laisser participer à ce travail, mais aussi parce que c’était très clair qu’ils avaient envie de faire le film et de se battre pour lui. C’est très important à mon avis pour qu’une sortie soit réussie. Ils avaient aussi pris un risque financier assez gros, c’était un sacré pari, donc ils avaient tout intérêt à ce que ce soit un film rentable. La sortie a été préparée très en amont et chaque chose qui est sortie en ligne a été longuement discutée. Le seul endroit où j’ai été forcé de déléguer et de leur faire confiance c’est sur les réseaux sociaux, j’y suis un petit peu mais dès qu’on commence à parler de TikTok et tout ça, je suis un peu largué. C’est pas forcément mes codes donc je laisse faire ceux et celles qui maitrisent ces outils, mais toujours dans la transparence, on m’informe préalablement des contenus, on en discute, on me sollicite parfois… En clair, on a tellement discuté de la direction artistique générale de la sortie en amont – et surtout de ce que l’on ne voulait pas faire – que derrière ça relevait du contrat de confiance. Tout le monde s’est mis à son poste, avec ses aptitudes, son domaine d’expertise, pour que la sortie soit la plus événementielle possible.
Tu es allé de nombreuses fois à la rencontre du public et pas uniquement en festivals où a priori les gens sont des amateurs de ce cinéma-là, acquis à la cause. En effet avec l’équipe vous vous invitez régulièrement par surprise dans les salles de paris et de proche banlieue. Quel constat tu tires de ce contact avec le public ? Penses-tu que la fameuse digue qu’on pensait infranchissable du « si c’est français, c’est nul » est enfin fissurée ?
On s’en est rendu compte surtout via les réseaux sociaux en fait, parce que les acteurs et moi avons reçu un nombre incalculable de messages privés enthousiastes, de remerciements… Et les gens ont partagé en masse leur avis sur le film en incitant les gens à y aller. Et beaucoup des messages tournaient autour du fait que c’était « enfin un film d’horreur français trop bien ». Donc forcément, cette émulation-là, on l’a sentie et elle nous a vachement émus. Même si le film a été plutôt bien accueilli par la presse, y compris des magazines de cinéma comme Les Cahiers du Cinéma, on n’a pas bénéficié d’une grosse couverture télé et radio par exemple, donc on sait à quel point c’est le bouche-à-oreille, notamment en ligne, qui a été déterminant dans le succès. Si on se rend en salles pour faire une surprise au public, c’est pour rendre ce qu’il nous a donné, pour dire merci tout simplement. Tandem a eu le flair aussi de nous envoyer en tournée un peu partout pour des avants-premières parce que ces projections là ont été déterminantes pour la suite. Tout est parti de là : du bruit répandu par ceux qui avaient pu voir le film avant tout le monde que, le 27 décembre, y avait ce film à aller voir absolument en salles. On a eu deux ou trois vagues de bouche-à-oreille successives et je pense que le public s’est aussi élargi progressivement – là on commence à avoir des gens plus âgés qui vont voir le film parce qu’ils ont entendu ou lu que c’était vachement bien. Après le Nouvel An par exemple, les 2, 3 et 4, on a fait des scores de fou. Les gens ont dû peut-être s’en parler pendant le réveillon ?

© Académie des Césars
Il manquait certainement une dernière validation pour qu’on parle d’unanimité, celui de la profession, du milieu. A la surprise générale vous avez obtenu deux nominations aux Césars. Celle pour les effets spéciaux n’est pas tant que ça inattendue, mais le fait que Vermines soit nommé dans la catégorie Meilleur Premier Film est un signal fabuleux. Comment tu as accueilli cette nouvelle ? J’ajoute que les cinémas de genres ne sont pas en reste avec les présences de Vincent doit mourir (Stephan Castang, 2023), Mars Express (Jérémie Perrin, 2023) et bien sûr Le Règne Animal (Thomas Cailley, 2023) qui fait partie des favoris. Il ne s’agit pas du cas unique de Vermines, vos quatre propositions participent à une forme de revitalisation du cinéma français.
J’étais ultra surpris. La catégorie du Meilleur Premier Film c’est celle dans laquelle on ne peut être nommé qu’une fois dans sa vie donc bon… Si t’y es pas… C’est fini. J’y croyais pas, je suis encore sous le choc pour rien te cacher. Y a une reconnaissance certes, mais y a vraiment surtout enfin un regard sur le taff que c’est de faire du « genre ». Y a presque double de boulot que sur un film dit « réaliste ». On doit faire croire au public en des trucs extraordinaires et l’emmener dans l’histoire. Faut vraiment être déterminé. Être nommé c’est une chose – Julia Ducournau a eu pas mal de nominations si mes souvenirs sont bons – mais avoir le trophée, cela en est une autre. Y a toujours un plafond de verre à franchir quand il reste que cinq films et que t’es paumé au milieu d’un drame, d’un film politique ou d’un truc qui ressemble à une pièce de théâtre. Je respecte à fond ce genre de film aussi, mais c’est vrai que personnellement je juge qu’on les connait, ça y est, on les a vus ces films. La catégorie Meilleur Premier Film ou Meilleure Révélation, pour moi, ça doit récompenser le cinéma de demain. Quand tu vois un acteur comme Quenard nommé cette année, je me dis : « oui, ça c’est nouveau, j’ai jamais vu ça, je veux en voir plus, faut encourager ça », parce que le gars propose des trucs qu’on a jamais vus et qui nous bouleversent. J’envisage la catégorie Meilleur Premier Film de la même manière. À qui on donne de la force pour qu’il aide les choses à bouger ? Ça revient à ce que je te disais sur le CNC, les régions et compagnie. Tout ça faut que ça bouge, mais pour ça il faut que ce qu’on fait soit reconnu par nos pairs. C’est pas une mince affaire, les gars sont des durs à cuire !
Forcément, après un tel succès et une adhésion unanime de l’équipe à ton premier long-métrage, il est évident que nous attendons beaucoup de la suite. Deux questions en une : d’abord, est ce que ce n’est pas un peu pesant voir tétanisant que tant de monde – ceux qui regardent mais aussi ceux qui font – t’assigne désormais le rôle de porte-drapeau ? Ensuite, est-ce que tu penses déjà à transformer l’essai rapidement ?
Je suis très lucide quant au fait que j’ai encore tout à prouver, donc je ne me considère surtout pas comme un porte-drapeau. Le succès d’un premier film ça peut être un coup de chance, quelque chose que tu ne revivras plus jamais. Pour moi, c’est la réception d’un film qui lui donne du pouvoir : son succès public, critique, comment il est accueilli par la profession. J’ai l’impression, presque, que Vermines ne m’appartient plus. La seule chose flatteuse c’est que désormais pas mal de gens attendent mon prochain film, c’est pas tant une responsabilité ou une pression qu’une source de motivation, du carburant pour relancer le moteur. Je compte tourner en fin d’année ou tout début d’année prochaine, on est en écriture d’un tout nouveau projet avec Florent et son financement est très bien avancé, on ne devrait pas tarder à en dire plus ! (Depuis la publication de cet entretien, a été annoncé que Florent Bernard et Sebastien Vanicek ont été embauchés par Sam Raimi pour un spin-off de la saga Evil Dead, ndr)
Propos de Sébastien Vanicek
Recueillis et retranscrits par Joris Laquittant






