Quelle tempête ce Court-Métrange. L’Ouverture nous avait happés, l’Animation entraînés et le Double un peu laissés à la dérive. Et voilà que les vents se lèvent de nouveau. L’aquilon menaçant de l’Ailleurs et le mistral tourbillonnant du Mythe. Bien que bousculés par ces bourrasques ininterrompus, celles-ci nous ont permis de nous envoler loin, bien loin du confinement de notre visionnage à domicile. Terres inconnues, univers parallèles, monstres passés et futurs, inextricables malédictions… Après avoir été ballotés partout et emportés si haut, nous voilà relâchés, en chute libre, profitant de ce dangereux instant de liberté pour ancrer profondément dans nos mémoires, et peut-être dans les étoiles, ces fabuleuses images qui nous avaient été offertes et les noms de leurs responsables. Avant que la houle ne reprenne ou que nous atteignions le sol, nous aimerions partager avec vous un peu de notre ballet aérien.

Jour 4 • Des visiteurs, venus d’ailleurs
Premier vent. Alors que le Double invitait à l’introspection, l’intériorité, l’Ailleurs exhorte à l’inconnu, à ce qui nous est étranger. Ce que l’on ignore ou pire encore, ce que l’on ignore ignorer. L’Ailleurs nous fait entrer dans, ou nous impose, un autre temps, un autre espace, auxquels nos sens et notre logique tentent de donner forme. Un monde de choses, d’entités et d’endroits potentiels, qui dans l’attente d’être clarifiés persistent dans cet état mouvant d’être et de non-être. Serons-nous prêts à traverser cet Ailleurs incertain ? À accueillir ceux qui en viennent ? Devrons-nous y ou leur faire face ? Le pourrons-nous ? Si l’absence de réponses à ces questions vous laisse démuni.es, voilà 5 courts qui comme 5 hypothèses de réalités ont de quoi vous rôder à tout imprévu.
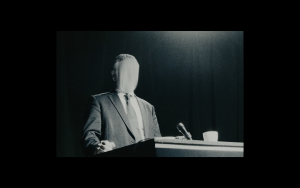
© Tous Droits Réservés
Dans son impressionnant From Beyond, Fredrik S. Hana, nous rejoue l’épisode de la rencontre du troisième type, par ce dispositif maintenant bien connu du montage d’images « d’archives » et de found footage. Sans trame narrative précise, le court réussit à nous faire croire à son alien, et à la suite d’événements troublants suivants son arrivée, par un savoureux cocktail de sombre, de flous, de hors-cadres et d’effets spéciaux. La véritable prouesse de ce court n’est pourtant pas tant de faire exister ces êtres venus d’ailleurs que de nous faire réaliser l’étrangeté de l’humanité à laquelle on croit appartenir. Ambiances sonores pesantes, voix et visages déformés… Tout nous renvoie un portrait déstabilisant de nous-mêmes. Obsédés par ces nouveaux venus, nous sommes vus incapables de refréner notre curiosité et nos instincts primaires de domination et de contrôle sur eux, une réalité potentielle créant un malaise qui culmine dans la séquence finale… Le film, plus proche depuis le début de l’esthétique évocatrice du clip ou de la critique ambiante de l’art contemporain, se resserre dans ses dernières secondes sur une suite d’événements précis : le viol d’un alien par un homme, puis les répercussions et conséquences de son acte. Un climax extrême, terrifiant de potentialité, s’achevant sur une référence au fœtus cosmique de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick (1968), habilement réemployée. Méritons-nous seulement cet Ailleurs ?
Le court-métrage post-apo The Fore-Men d’Adrian Bobb, est moins convaincant. Tentant plus mal que bien de dissimuler son amateurisme, qui se révèle surtout à son scénario mal ficelé. L’histoire s’emmêle rapidement dans un amoncellement d’explications par le dialogue de ce que l’on regarde : post-apo, backstorys, événement historique, créatures, entités, objectifs contradictoires, brèches temporelles… Tout ça en peu de temps, jusqu’à que ce château de cartes branlant soit quasiment balayé par une trop courte scène d’action. On enchaîne enfin sur une sortie vers l’ailleurs, soit l’extérieur post-apo, tant attendu : un monde décomposé, comme toute une réalité en ayant percuté un autre, habilement camouflé et élevé par une brume blanche omniprésente. On ne retiendra donc vraiment que quelques images marquantes de ce court, notamment ces humanoïdes masqués vêtus de noir et leurs tentacules-drones sinistres. Un contraste de qualité des VFX qui ne fait malheureusement que mettre en exergue la faiblesse du reste, assez creux. On sent l’ambition de genre sans fondement, sans réflexion particulière, dont le vide est comblé comme trop souvent par un ajout en continu d’informations et d’éléments nouveaux. Le soufflé gonfle et s’aplatit. Mais ce n’est pas tout le monde qui s’essaye au soufflé.
Pour rester dans les VFX de qualité, la petite bande du studio NEW3DGE nous offre le cinématique Tribes, tout en images de synthèses. On le croirait tiré de l’introduction ou de la communication d’un jeu vidéo indé engagé de la dernière décennie, à la Spec Ops : The Line de Yager Development (2012). Ces jeux d’auteur qui usent habilement de gameplays classiques pour nous faire remettre en question nos choix, notre vision du monde. Ici, Tribes nous déroule une suite de panels au ralenti évoquant comme une fresque médiévale 3D, une tragédie, celle de la brutale attaque d’une tribu africaine par une autre et du massacre qui s’en est suivi. Si la performance graphique est assez inégale, la réalisation est excellente. Les tableaux et mouvements de caméra sont magistralement choisis, les ambiances sont fascinantes, les sujets touchants ou glaçants. Une belle et saisissante représentation de ce cruel monde des guerres intestines, auxquels ne survivent que les seigneurs de guerre et les enfants soldats. L’Ailleurs de la guerre, où tout n’est plus que ruines et désolation, où tout ce qui survit se corrompt. La cinématique d’intro est donc nickel, est-ce qu’on peut avoir le jeu s’il vous plaît ?

© Tous Droits Réservés
Baisse de tension avec le Gussy de Chris Osborn, qui commençait pourtant bien : un found footage de deux gamins chassant un monstre en forêt avec la caméra digitale des parents. Vraie réussite que ces images saisies du point de vue de ces nains galopants. Le cadre bouge, les arbres paraissent encore plus gigantesques, on ne sait ni où on est ni où on va. Un retour trop bref dans l’enfance de ces aventures partagées où les jeunes imaginaires se mêlent, se découvrent et se construisent ensemble. La brusque irruption du monstre, bien trop réel, dans ce jeu d’enfant est donc d’autant plus soudaine, l’inversion chasseur-chassés d’autant plus alarmante. Puis le diamant saute sur le vinyle et on se retrouve 15 ans plus tard. Les gamins devenus grands, toujours traumatisés de cette expérience, reviennent à la forêt pour retrouver leur monstre. On revient à un dispositif plus classique, plus psychologique ou philosophique, où le genre passe quasiment en sous-texte pour servir une ou plusieurs intentions qu’on a encore du mal à distinguer. Dans l’approche, cette forêt, ce centre commercial puis cette cabane hors du monde, avec ces personnages mutiques dont on ne peut que deviner le tourment intérieur, aspirent presque au Stalker (1979) de Tarkovski. Mais le scénario et la réalisation ne suivent pas. Tout est assez beau mais assez creux. On sent qu’on veut nous dire quelque chose par ces silences, par cette relation entre ces deux hommes, par cette immortelle créature et ce monde parallèle mais les mots ne sortent pas et les images ne parlent pas assez. Peut-être sommes-nous passés à côté de quelque chose. Peut-être pas.
Dernier ailleurs, le petit bonbon d’hommage au cinéma fait maison qu’est Le Saboteur d’Anssi Kasitonni et sa clique. Le dispositif rappelle celui employé par Shin’ichirō Ueda, dans son Ne Coupez Pas de 2017 (l’original mérite vraiment d’être vu malgré le remake récent d’Hazanavicius), qui nous montrait d’abord le très bancal film fini, puis nous racontait son origine et ses galères de tournages. Presque pareil ici mais par deux écrans actifs en simultané. À gauche, le résultat final, un court-métrage amateur, quasi parodie du cinéma et des séries d’action des années 70-80, type Rambo III (1988) de Peter MacDonald rencontre Mission:Impossible de Bruce Geller. À droite, le making-of, le vrai, de chacun des plans du court, au moment même où ceux-ci apparaissent. Le résultat n’a que peu d’intérêt, encore un ancien soldat qu’on vient tirer de sa retraite pour l’envoyer détruire un ailleurs indistinct, alors que « c’est pas sa guerre ». C’est surtout les énormes et ingénieux efforts mis en œuvre par cette bande de cinéastes qui nous charment. On y apprend comment simuler un saut en parachute, une tempête de neige, la projection d’un missile et l’explosion d’une base, ou plus simplement mais plus impressionnant encore, comment obtenir un reflet de flammes dans des jumelles. Une véritable déclaration d’amour au cinéma (et particulièrement au cinéma d’action) qui n’est pas sans nous rappeler les tournages fait-main des Fabelmans de Spielberg sorti plus tôt cette année. On adore, mais étant donné que l’idée a déjà été abordée plusieurs fois, on se permettra une demande : et si pour une fois le scénario du film d’action amateur était un poil plus rodé ? Quitte à filmer dans de pareilles conditions et avoir de toute façon un résultat amateur… Mais bon, la promesse est tenue, tout le monde s’est bien amusé et c’est ce qui compte vraiment.
Jour 5 • Des mythes au logis
Le Mythe est le versant spirituel de l’Ailleurs. L’ignorance existentielle comblée par la superstition, la mise en commun de suppositions et d’expériences vécues en histoires plus solides, plus durables, puisque partagées. À nous d’y croire ou non, d’y apporter notre touche ou non. Comme un liquide, le Mythe s’adapte à son contenant local. Il prend la forme de l’environnement dans lequel il est raconté et s’anime de l’âme de ceux qui le racontent. En ce sens, il devient un miroir déformant et accusateur de nos sociétés, révélateur de nos torts, nos angoisses, nos jugements hâtifs ou excessifs. Un excellent thème donc pour un festival comme le Court-Métrange, dont l’internationalité nous permet de découvrir 5 court-métrages venant du monde entier, exposant avec talent les spécificités des régions dont ils proviennent. Preuve que malgré nos différences de surface, nous avons tous nos démons.

© Tous Droits Réservés
Première étape assez convenue de ce voyage, le croque-mitaine espagnol de German Sancho, Caraoscura. Une légende de mangeur d’enfants protéiforme, racontée par ses premières victimes. Dans leur chambre-grenier, un frère et une sœur échangent ce qu’ils savent sur ce monstre alors que les signes de sa présence proche s’accumulent. On cherche à se tester, à se faire peur, mais rapidement à se rassurer, à trouver des moyens de se défendre, ensemble. Hormis une nuit américaine bleue Klein assez lourde et sans contraste, l’exercice de l’horreur est plus que réussi, au point qu’on croirait que le court dispose des moyens d’un long-métrage. Sans fioritures (ni originalité), le scénario se révèle efficace, prenant le temps de poser l’angoisse et de nous transposer dans le point de vue de ces pauvres enfants. On retrouve ce dispositif d’une légende orale affreusement concrétisée dans le réel, évoquant un passé flottant, stagnant, dont les maux non résolus hantent encore nos pensées et nécessitent d’être montrés, parfois violemment. Cette approche place le film dans la continuation du courant, ou plutôt, de la tradition horrifique espagnole : REC de Jaume Balagueró et Paco Plaza, Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro (mexicain certes mais se basant sur un univers fantastique et historique espagnol) et surtout de L’Orphelinat de Juan Antonio Bayona. À la hauteur de ses semblables, le court se permet d’employer des méthodes plus modernes de l’horreur, à savoir un montage plus rythmé, plus portée sur la surprise, l’action et le retournement de situation. Une qualité technique qui nous fera vraiment regretter le manque d’une touche plus personnelle, de personnages ou d’un monstre plus caractérisés, d’un contexte plus défini, ou même soyons fous, d’un fond, d’une idée ou d’une critique.
Direction l’Amérique, son high school et son racisme avec l’excellent, le vraiment top, Nian de Michelle Krusiec. Au point qu’on se demande pourquoi une réalisatrice pareille, maîtrisant parfaitement les codes du slasher, de l’horreur asiatique et du teen movie social n’ait pas déjà signée chez Blumhouse ou A24. On nous y raconte avec humour et tension l’histoire d’une jeune adolescente qui écoute les conseils belliqueux de sa mère et choisit de faire face à sa bully raciste. Rapidement démunie face à la brute, la jeune femme fait appel à un esprit protecteur de sa famille par le biais d’un masque cérémoniel. Mais celui-ci appelle non seulement le chasseur de démon auquel il appartenait mais aussi le démon lui-même, qui finit par la défendre plus que de raison. Retournement sur retournement, le court nous fait en réalité le récit d’une adaptation, d’une intégration difficile. On y voit les éléments considérés comme bons ou mauvais outre-Pacifique s’unir dans l’adversité pour survivre à la haine de ce pays qui accueille si mal. Le ton est juste, les intentions visuelles sont précises, subtiles et recherchées. Le tout est uni dans une vision claire qui réussit à faire exister ces mythes chinois dans l’univers américain comme s’ils avaient toujours fait partie de son panthéon d’esprits (une leçon bien retenue du malheureusement moins réussi American Gods de Bryan Fuller et Michael Green). Le court ne fait cependant pas l’impasse sur cette vérité que le cinéma américain nous sert depuis des décennies, du western à Scorcese, de Ben Hur (William Wyler, 1959) à Michael Bay : mieux qu’une carte verte, c’est la violence qui permet d’être intégré aux USA. La limite entre la simple constatation de ce drame ou son encouragement est toujours ténue, mais c’est toute la question de la représentation de la violence par le genre. Une vision qu’on a donc hâte de voir développée, étendue, multipliée sur nos écrans, nos grands écrans si possible. Talent à suivre !
On rembarque pour atterrir dans le grand froid norvégien, où nous accueille la petite claque d’Unborn Biru d’Inga Elin Marakatt. En à peine quelques secondes nous voilà projetés dans ce qu’on pourrait supposer être le XVIIème siècle, dans une région rurale aux conditions hostiles, pour suivre les malheurs d’une mère seule d’une enfant en bas âge, enceinte, démunie et marginalisée. Rien que ça. Et comme si ça ne suffisait pas, suite à un acte désespéré, cette femme sera punie d’une bien sanglante malédiction. Pas de monstre ou de fantôme ici, du moins pas à l’image. La réalisatrice y fait en effet le choix d’une horreur fantastique au sens original du terme, soit de l’intrusion incertaine du surnaturel dans le réel. Tout est dans les absences, les ambiances, dans quelque chose de bien plus insidieux. Un choix subtil assez bien maîtrisé, qui met en évidence tout l’intérêt du Mythe évoqué plus haut. On nous présente un village où les normes sociales se mêlent allégrement aux superstitions. Transgresser un interdit, c’est non seulement risquer le jugement des hommes, mais surtout celui bien plus violent des forces invisibles. Merveilleusement interprétée par Sofia Jannok, le personnage d’Inga nous présente toute l’injustice de ce système déraisonné, où l’on obéit et l’on juge vite, sans réfléchir, par égoïsme, par peur d’être teinté, sali du malheur des autres. Un monde où les innocents malchanceux sont contraints au crime et poussés à endosser le terrible rôle de paria pour satisfaire la conscience commune. Magnifique, même si on aurait apprécié une petite pincée d’extraordinaire en plus.

© Tous Droits Réservés
Dernière étape avant la fin du mythique voyage, on quitte le grand extérieur pour s’enfermer dans une barre d’appartement russe. Non, attendez, revenez ! On vous jure qu’il n’y a pas d’erreur sur votre AirBnb, c’est juste mieux que ça en a l’air. Dans Shurik, Aleksandr Samsonov nous narre un conte digne des frères Grimm d’un enfant abandonné par ses parents à une étrange voisine. Puisqu’on parle international, ce très beau court fut l’occasion de prouver la puissance universelle du cinéma. En effet, les sous-titres n’étaient pas disponibles sur notre version en ligne pour ce court et notre russe est aussi rouillé qu’une porte de manoir hanté. Un exercice de visionnage qu’il faudrait qu’on s’inflige plus souvent, quand l’œuvre s’y prête, car il nous impose un vrai regard de spectateur de cinéma. Un regard actif, participant, qui cherche des indices, qui se met à la place des personnages, tout ça pour glaner la moindre information permettant de mieux comprendre ce qui se déroule sous nos yeux. En récompense, on ne comprend pas forcément tout mais on ressent. On est d’autant plus touché par cet enfant minuscule lancé aux mains de cette femme au visage surnaturel, factice, qui nous terrifie de ses changements d’humeurs. Complètement empathique de ce petit homme abandonné, nous nous retrouvons comme lui à l’affût du moindre danger, profitons du moindre moment de repos et plus risqué, nous laissons charmer par cette sorcière et son antre incohérente. Jamais filmé en plan large, cet appartement clos sur lui-même, aux murs et sols couverts de bibelots et vêtements en tout genre pourrait être gigantesque comme minuscule. La magie y opère très vite et culmine lorsque l’on découvre l’atelier verdâtre de la voisine, où celle-ci construit et peint des matriochkas (ça, on l’a saisit), soit des poupées russes à son propre effigie. Des dizaines et des dizaines, partout, de toutes tailles, qui vous regardent l’air méchant. Rien ne réponds à nos questions, on ne sait jamais s’il s’agit vraiment d’une sorcière ou simplement d’une femme âgée vu des yeux d’un enfant, une femme seule, ensevelie sous ses souvenirs et engloutie par son dernier passe-temps. L’irréel concret finit tout de même par surgir lorsque que les parents de l’enfant reviennent enfin. La femme et ses poupées ont disparu. Ne reste que l’enfant, devenu poupée russe géante, qui, rancunier, leur fait la tête. On pourrait crier à l’absurde mais étrangement tout paraît naturel, logique. Dans un style similaire à la Fièvre de Pétrov de Kirill Serebrennikov (2021), l’étrangeté surgit dans la vie comme si elle en avait toujours fait partie, et les personnages comme le public ne peuvent que l’accepter, faire avec, continuer. Un fabuleux cinéma du symbole qui nous atteint en plein cœur, nous rappelant que l’incohérence du monde n’empêche pas d’y vivre ou d’y trouver le bonheur. Serions-nous témoin d’un nouveau courant du surréalisme russe ? On l’espère. Quoi qu’il en soit, Shurik demeure un vrai petit bijou qui nous a beaucoup plu, avec ou sans sous-titres. On va réinstaller Duolingo, on sera prêt pour l’année prochaine, promis.
Et oui c’est déjà la fin du voyage, la fin du Mythe. Pour pas que l’on termine trop triste, Xuan Trang et Nguyen Thi nous accueillent bras ouverts et crocs sortis dans leur sombre cuisine d’After Taste. On aurait peut-être pas dû mais l’odeur du pitch était trop alléchante : une jeune cheffe à peine sortie d’école rejoint la brigade haute gastronomie d’un chef égocentrique et pervers, au moment où sa grand-mère médium meurt et lui cède son rôle de nourrisseuse de démons-ogres à l’ insatiable faim. Ambitieux certes, mais de nouveau c’est clairement un court-pour-le-long et l’un de ceux qui s’en sort le mieux jusqu’à maintenant sur cet exercice compliqué. Bien que beaucoup d’informations nous soient balancées à toute vitesse dès l’ouverture (légende, statut familial, cuisine, démons, relations toxiques…), tout fonctionne. Parce qu’on ne se contente pas de nous dire ce qu’il se passe, on nous le fait vivre. La perdition et l’excès d’informations deviennent parts entières du dispositif, on se sent très proche de l’héroïne, qui incarne et subit toutes ces pressions. Dépassés par ce qu’on voit déjà, tout ce qu’on sent venir mais qu’on ne voit pas encore en devient d’autant plus terrifiant. Un beau tour de passe-passe scénaristique donc, renforcé par de solides interprétations et de sublimes décors et mises en scène. Troublant de voir à quel point résonnent entre eux ces mondes réel et surnaturel, qui tout deux s’abreuvent de l’énergie des vivants. After Taste installe parfaitement son ton, sombre, vicieux, irréel ainsi que sa menace d’une mort violente, s’approchant de plan en plan. Les effets spéciaux ont beau être un peu à la traîne et le final un peu précipité, il est trop tard pour faire machine arrière. L’idée est posée, l’obsession installée, on a faim de plus. Qu’on nous serve le long, et vite !
De retour sur terre, on a ouvert nos rideaux pour réaliser qu’on était jamais vraiment partis et que les ombres menaçantes dans les coins de notre chambre n’étaient qu’un manteau froissé (l’était-ce vraiment ?). Pourtant, alors que la lumière, le vent frais d’octobre et le doux bruit des klaxons parisiens réinvestissent nos appartements, nous nous sentons différents. Comme investis d’esprits d’ailleurs, témoins d’horreurs voisines, détenteurs de vérités autres. Nos carnets remplis de noms et de projets à suivre, nos cœurs emplis d’espoir pour l’avenir du genre qui quand on étend un peu ses horizons est tellement encore riche et prometteur. Merci le Court-Métrange de checker le pouls de ces cinémas pour nous, en effet, il bat à toute vitesse. Et dire que le festival n’a pas encore tout donné…

