Comme à son habitude, Playlist Society enrichit nos réflexions cinéphiles par des ouvrages qui réussissent l’exploit de revendiquer une analyse complexe et riche sans jamais tomber dans le jargonneux et la mise à distance des néophytes. Dans Géographie Zombie, les ruines du capitalisme, le géographe Manouk Borzakian nous offre une grille de lecture passionnante de l’une des figures les plus emblématiques des cinémas de genres, en la passant au tamis d’une étude sociologique et géographique dense. L’actualité zombiesque étant très chaude en ce moment, avec la sortie en salles, conjointement à sa présentation à Cannes, du nouveau film de Jim Jarmusch, nous avons invité Manouk Borzakian a discuter avec nous de son livre bien sûr, mais aussi, de The Dead don’t Die (Jim Jarmusch, 2019).

© Tous droits réservés
Les morts ne meurent jamais
Ton livre Géographie Zombie, les ruines du capitalisme édité chez Playlist Society est publié alors qu’on est en pleine « actualité zombie » avec la sortie en salles de The Dead don’t Die (Jim Jarmusch, 2019). J’imagine qu’il peut y avoir quelque chose de frustrant à voir des films sortir sur les écrans alors qu’on aurait aimé les ajouter à un corpus de réflexion.
Je ne peux pas vraiment être frustré car vu la productivité du genre du film de zombies, il était évident que j’allais être un moment ou un autre pris de vitesse. Il arrive un moment où il faut tout simplement sortir le livre et accepter cet état de fait. On a quand même réussi, assez miraculeusement, à parler de la neuvième saison de The Walking Dead (2010-2020), ce qui était déjà un exploit. Concernant The Dead don’t Die, ma première impression c’est qu’il n’apporte pas grand-chose de nouveau à la figure du zombie. Même vis-à-vis de ma grille de lecture, qui est celle des sciences sociales, il n’y a rien de très original à en tirer, si ce n’est peut-être la façon dont il définit les zombies non pas comme des « autres » mais plutôt comme des « nous ». Il y a toujours une tension sur cette question dans les films de zombies. A savoir est-ce qu’il s’agit d’une forme d’altérité s’immisçant dans notre société ou bien au contraire, une simple retranscription de ce que nous sommes vraiment ? S’il y a une chose un peu nouvelle dans la vision du mythe chez Jarmusch, c’est donc principalement le fait qu’il ne choisit pas de loger sa représentation dans un entre-deux mais de dire très frontalement que les morts-vivants et les vivants sont pareils. Son idée c’est qu’on est tous des zombies, des individus complètement aliénés par le système capitaliste, qui consommons comme des bêtes. C’est même assez démonstratif, je trouve qu’il en fait beaucoup trop.

© Tous droits réservés
Ce qui lui est principalement reproché, en dehors du fait qu’il n’apporte pas un regard neuf sur le genre – ce qui peut même donner la sensation qu’il en méprise les codes, s’en moque – c’est que c’est un long-métrage qui n’empoigne pas comme il devrait, ou en tout cas comme il le pourrait, la critique sociale et politique de l’Amérique de Trump.
J’ai écrit un texte sur The Dead don’t Die pour Libération qui le relie à un autre film de la carrière de Jarmusch qu’est Dead Man (1996). Je trouvais amusant de faire un parallèle entre la ville au cœur de ce dernier, Machine – cette ville industrielle du Far-West avec ses rues poussiéreuses et dégueulasses dans lesquelles les gens se tirent dessus – et son exacte opposée, en tout cas en apparence, qu’est Centerville dans The Dead don’t Die, une petite ville sans histoires sur la côte est, où tout le monde s’aime et se respecte au point que même le raciste et le noir prennent leur café ensemble. Je crois en fait que ces deux visions de l’Amérique ne sont peut-être pas aussi antinomiques qu’il y paraît. Qu’on soit il y a cent cinquante ans, à Machine, dans un Far West qui façonne les racines du rêve américain mais qui commence à détruire la planète par l’industrialisation, ou bien dans Centerville, il fait à chaque fois le portrait d’une communauté américaine, à deux époques différentes, dans une ville qui pourrait être, dans les deux cas, presque n’importe où dans le pays. En cela, avec The Dead don’t Die je pense qu’il dit quand même quelque chose de l’Amérique. Je dirais même qu’il y a une sorte de filiation dans les cinémas de genres à utiliser comme décor ces villes américaines, dans lesquelles s’épanouit une petite communauté de gens simples qui n’aiment pas que leur paix sociale soit remise en question par l’arrivée d’étrangers, qu’importe leur nature ou provenance. On pense par exemple à la ville de Hope, dans Rambo (Ted Kotcheff, 1982) dans laquelle le personnage débarque au tout début, avec le Shérif qui lui dit « Écoutez ce n’est pas qu’on ne vous aime pas mais on préférerait quand même que vous partiez d’ici », un schéma qu’on retrouve dans plein de films, par exemple A History of Violence (David Cronenberg, 2005) ou Twin Peaks (David Lynch, 1991-2017). Le décor de ces films est toujours le même : une small town peu peuplée, où tous les habitants se connaissent, avec une mainstreet où sont regroupés l’essentiel des commerces. Et cette image c’est aussi, par certains aspects, celle des villes du Far West, avec le saloon, la banque…
Il est vrai que l’on retrouve totalement cette image dans le film de Jarmusch, au point qu’il en fait un véritable running-gag de mise en scène. On retrouve plusieurs fois une succession de plans tableaux, cartographiant cette petite ville américaine en en montrant les lieux communs (la station essence, le café, l’école…) et la voiture des policiers en patrouille qui passe devant chacun de ces lieux à la recherche de quelque chose qui pourrait sortir la ville de sa petite quiétude.
Cela dit quelque chose de comment l’Amérique se voit et telle qu’elle a envie de se représenter. A savoir l’idéal jeffersonien d’une communauté quasiment autonome qui est soudée sur des valeurs très américaines de piété, de famille et de travail. Jarmusch a vraiment quelque chose à dire là-dessus parce que le seul qui va en réchapper c’est celui qui refuse d’accepter les codes de cette communauté et qui a décidé de vivre en marge de tout ça, à savoir le personnage d’ermite incarné par Tom Waits. Le long-métrage est donc moins intéressant dans son rapport au film de zombie que dans sa vision de l’Amérique, puisque ce qu’il nous dit c’est que cette société est en train de se désagréger et que la seule façon de s’en sortir et d’y survivre, c’est de s’extirper de ce système et d’accepter de vivre en marge. C’est un message qu’on peut discuter mais qui est aussi très américain (il faut lire Thoreau, par exemple), et qui peut d’ailleurs lui aussi avoir une dimension très réactionnaire.
Peut-être que le principal regret qu’on peut avoir avec le film c’est qu’il aurait pu être le premier film de zombie de l’ère Trump, mais qu’au final, la critique politique reste très en surface. IL n’est pas militant pour un sou, d’ailleurs Jarmusch l’a dit lui-même à Cannes, le discours politique ne l’intéresse pas, parce qu’il ne le pense pas capable de résoudre les questions relatives à la survie humaine.

© Tous droits réservés
Je ne suis pas certain qu’il y ait un film de zombie qui ait déjà pris en main l’Amérique de Trump telle qu’elle est aujourd’hui, au sens où le genre n’a pas encore totalement digéré les spécificités de l’actualité politique trumpienne qui est quand même très particulière, elle sort du long terme pour être dans une forme d’immédiateté déstabilisante. Malgré tout, tous les films de zombie posent la même question – et Jarmusch n’échappe pas à la règle – à savoir qu’est-ce-qu’on fait face à cette menace ? Sur cette question, mon éditrice m’a dit une phrase très belle pour qualifier le livre : « cela donne envie d’être du bon côté de l’Apocalypse » et ça résume pas mal l’angoisse qui est présente dans l’ensemble des films du genre. On est irrémédiablement face à ces zombies – on peut discuter à l’infini de ce qu’ils sont mais en tout cas ils sont là – et la question c’est de savoir désormais ce que l’on fait face à ça, individuellement et collectivement. Plus on est réactionnaires, pour faire simple, plus on va se renfermer sur soi-même, dans son chez-soi, derrière des frontières etc…Donc d’une certaine façon, l’Amérique de Trump est déjà présente dans La Nuit des Morts-Vivants (Georges A. Romero, 1968) – à travers le personnage de Harry qui se castagne avec Ben, une sorte d’incarnation de la middleclass blanche – ou bien encore dans le remake de Tom Savini sorti en 1990, qui donne une place beaucoup plus grande à cette partie de la population qu’on appelle les rednecks. Je suis assez étonné que l’on puisse reprocher à Jarmusch de ne pas avoir été assez frontalement dans la critique de cette Amérique, parce qu’au contraire, je le trouve presque trop démonstratif. C’est presque trop limpide, trop appuyé, car même si le président n’est pas nommé, on devine qui est ciblé aux détours des informations télévisées présentes dans le récit, où l’on pointe du doigt l’extraction du gaz de schistes, les lobbies de l’énergie et les climato-sceptiques, pour les désigner responsables de la catastrophe en cours.
Pour reprendre la formule de ton éditrice, de quel côté de l’Apocalypse tu placerais Jim Jarmusch ?
Je crois que la réponse est assez claire. Il s’identifie assez explicitement à Bob, l’ermite observateur qui regarde la société se défaire sous ses yeux. C’était déjà la position des personnages de Only Lovers Left Alive (2013) qui évoluaient en marge d’un monde qui leur échappait totalement et dont ils ne voulaient plus du tout faire partie. Le personnage de Tom Waits incarne cette même distanciation au monde qui est à mon avis la position de Jarmusch lui-même. Ce qu’il nous dit à travers Bob c’est que ce monde le débecte, qu’il en est las, et qu’il préfère regarder tout ça de loin, en en étant tour à tour amusé et désabusé. Il a donc pour moi un message assez limpide, sa vision est très pessimiste – et on peut le comprendre – il juge ce monde tellement irrécupérable qu’au final Trump n’est qu’un détail, et en effet, je ne suis pas sûr qu’il faille s’en prendre spécifiquement à Donald Trump pour construire cette critique du monde contemporain.
Le fait de cartographier les lieux qu’il filme est une constante chez Jarmusch, tu parlais justement de Only Lovers Left Alive (2013), ce qu’il y faisait avec la ville de Détroit est assez intéressant, de même avec Paterson (2016), dont la ville donne son nom au film.
Oui et c’est déjà le cas dans Dead Man (1996) dans lequel il traitait l’Ouest Américain très différemment de ce que l’on faisait habituellement dans le western classique. La figure de la forêt par exemple, persistante dans le film, n’est pas une caractéristique topographique très présente dans les westerns qui ont plutôt filmé les prairies sans fin et les grands déserts. Pour rebondir sur Only Lovers Left Alive (2013) c’est vrai qu’il a un certain intérêt à filmer Détroit, cette ville qui est en train de se désagréger, en employant notamment de longs travellings qui font écho au début de Stranger than Paradise (1985). Souvent dans les films américains, surtout dans les blockbusters, les villes sont présentées par de longs travellings avant, filmés depuis un hélicoptère, alors que chez Jarmusch il me semble qu’on est toujours à hauteur d’homme. C’est peut-être une approche beaucoup plus sincère et charnelle de la ville et du rapport de l’individu au monde et à son environnement qui caractérise la vision que Jarmusch peut avoir des villes qu’il filme. Plutôt que cartographe, je le vois plus proche d’une approche « pédestre ». Dans Paterson (2016) par exemple, on sillonne la ville à pieds ou en bus. Je simplifie beaucoup, mais on peut dire qu’il y a une tension récurrente chez les géographes entre ceux qui regardent les villes de loin – à travers la vision zénithale de la carte – et ceux qui les regardent de près, en les parcourant. Si l’on devait utiliser cette même catégorisation chez les cinéastes, alors Jarmusch serait plutôt de la deuxième catégorie.

© Tous droits réservés
Depuis quelques années sur Fais pas Genre ! nous essayons de dresser un état des lieux du cinéma de genres français, et malgré quelques contre-exemples notoires – La Horde (Yannick Dahan & Benjamin Rocher, 2009) ou l’excellent La Nuit a Dévoré le Monde (Dominique Rocher, 2018) pour n’en citer que deux parmi d’autres – le genre du film de zombie n’a pas vraiment trouvé d’incarnation concrète dans notre cinéma. D’ailleurs, tu ne cites quasiment que des films américains dans ton livre – avec quelques exceptions, anglaises ou coréennes par exemple – est-ce que ce genre est pour toi avant tout américain ?
Je crois que c’est une problématique qui touche l’ensemble du cinéma européen, même si les Italiens ont un passif avec les films de zombie notamment avec Fulci, dont L’Enfer des zombies (1979) est une atrocité en matière d’imaginaire colonial. Il y a eu quand même quelques exemples comme en Espagne avec [•REC] (Paco Plaza & Jaume Balaguero, 2007) – mais globalement on ne peut pas dire que le film de zombie européen soit si développé. Je risque une explication qu’il faudrait vraiment étudier de plus près, mais j’ai l’impression que c’est quand même le cinéma américain, et les Américains en règle générale – et ce, bien avant l’arrivée de Romero – qui ont en eux cette angoisse de l’invasion. Tout le cinéma de science-fiction des origines était bordé par cette crainte, bien aidé dans les années 1950 par l’ambiance maccarthyste. De fait, on retrouve dans le cinéma américain – y compris contemporain – les motifs de l’infiltré, de la contamination, de l’invasion, ce qui, en d’autres termes, ressemble à la théorie du grand remplacement. Politiquement, cette vision du monde est très présente aux États-Unis – même si la formule est franco-française – et si on en entend parler en Europe – et de plus en plus – il me semble qu’elle n’a pas encore le même poids. Cette peur qu’on les Américains de se faire envahir, même si on ne sait pas vraiment par qui, est un terreau magnifique pour les films de zombies. C’est d’ailleurs surement parce que cette angoisse est présente en profondeur dans la société américaine que le film de zombie s’accommode très bien d’une ré-appropriation de ces grandes thématiques par Hollywood, en tout cas par un cinéma jugé plus « mainstream ». Car autant Romero est très critique et politique, autant World War Z (Marc Forster, 2013) par exemple, reprend à son compte cette logique d’une guerre permanente à mener pour ne pas se faire envahir, sans véritable dimension critique.

© Tous droits réservés
S’il existe un autre genre cinématographique qui est typiquement américain, je dirais même ontologiquement américain, c’est bien le western. Tu fais beaucoup de lien entre les deux genres au sein même du livre.
Ça me parle tout à fait car je suis venu aux films de zombies par mon intérêt pour le western. Le premier film de zombie que j’ai vu c’est Land of the Dead (George Romero, 2005) et je me souviens être sorti de la salle en me disant que c’était en fait le négatif du western. Le western c’est la progression vers l’Ouest par petites touches. La fameuse trilogie de la cavalerie de John Ford raconte très bien ça. Elle montre comment des têtes de ponts sont apparues dans l’Ouest et ont progressivement permis à la civilisation de s’étendre et de suivre un élan. Dans le film de zombie, on assiste au retournement total de tout cela, puisque les personnages ont reculé dans leurs « forts », en attente de renforts qui ne pourront pas arriver puisque la civilisation autour n’existe plus. Un an après la sortie du Romero, le philosophe Eric Dufour a consacré un livre aux films d’horreur (Le cinéma d’horreur et ses figures, Editions PUF, ndlr) et il explique, dans un chapitre nommé L’Effondrement de l’état de droit que le film de zombie c’est l’inverse du western. Alors que le western raconte comment l’on invente un état de droit sur un territoire vierge, le film de zombie, au contraire, raconte l’effondrement ou l’effritement de cet état de droit. Déjà dans les années soixante, des réalisateurs comme Sam Peckinpah questionnaient le mythe de l’Ouest Américain, mais à mon avis, sans vraiment la remettre concrètement en question. Même lorsque l’on regarde cette vague de westerns dits crépusculaires, on ne sent pas vraiment les réalisateurs remettre en question cette idée d’un territoire qui a été conquis par le courage et l’abnégation d’une poignée d’aventuriers. Avec les films de zombies, le rêve américain implose totalement, les films disent clairement que tout ce qui a été bâti à l’époque des pionniers était voué à l’échec et que le monde civilisé est en ruines. Cette idée d’un monde en ruines parcourt par ailleurs l’ensemble du cinéma de genre américain contemporain, évidemment dans les films catastrophe, mais aussi dans la science-fiction. Oblivion (Joseph Kosinski, 2013) par exemple, raconte l’histoire d’une Terre dont on aurait perdu totalement le contrôle et qu’il faut reconquérir.
On reconnaît souvent à Playlist Society de publier des livres qui parviennent à proposer une analyse dense, documentée et souvent novatrice, tout en évitant l’écueil du jargon qu’il soit universitaire ou plus généralement « de spécialiste ». Ton livre touche à la fois au cinéma mais aussi aux sciences sociales, qui sont deux univers très enclins au jargonnage et pourtant tu parviens toujours à nous rendre les choses accessibles.
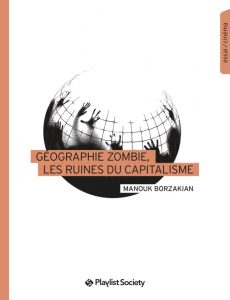 Je suis venu tardivement à écrire sur le cinéma, au départ j’utilisais ce medium plutôt comme support pédagogique notamment en mobilisant la figure du western et les films de genres. Un film comme Poltergeist (Tobe Hooper, 1982) par exemple est une matière passionnante pour expliquer à des étudiants la péri-urbanisation, de même que Invasion Los Angeles (John Carpenter, 1989) offre un panorama assez subtil des problématiques de la ville au début des années quatre-vingt-dix. Étant donné que je suis aussi enseignant dans le secondaire, ne pas tomber dans le piège du jargon est pour moi une question fondamentale. C’est une question très compliquée au sein des sciences sociales car il faut naviguer entre une attitude qui consiste souvent à utiliser des mots compliqués pour se faire accepter et reconnaître dans le milieu, et d’un autre côté il ne s’agit pas non plus d’être complaisant en disant que les mots compliqués ne servent à rien car parfois certains concepts nécessitent qu’on emploie des mots compliqués pour les définir. Toute la difficulté c’est de réussir à trouver un chemin entre les deux : ne pas se rendre inaccessible sans renoncer à la complexité de ce que l’on doit raconter. Je me suis bien évidemment posé la question d’être compréhensible et surtout de ne pas être incompréhensible sans raison. C’est un enjeu majeur parce que les sciences sociales sont aujourd’hui un peu coupées du monde. C’est quelque chose de très problématique, parce qu’elles sont censées apporter des éléments pour comprendre le monde, le critiquer et le transformer, mais parce qu’elles ne se rendent pas accessibles, la connexion ne se fait pas. Il y a bien sûr des gens qui essaient de faire ce travail de vulgarisation mais ils sont minoritaires, en tout cas c’est l’impression que j’en ai. Les chercheurs ont une énorme responsabilité dans l’imperméabilité de ces sciences et beaucoup en sont conscients par ailleurs, je ne suis pas du tout le seul à m’inquiéter de cela. On a bien sûr besoin de chercheurs et chercheuses pour comprendre le monde dans lequel on vit, mais il faut réussir à transmettre ce savoir, ces réflexions, au monde que l’on étudie et pour cela il faut d’abord réussir à se rendre compréhensible. Surtout que je suis convaincu que lorsque l’on est compliqué, ce n’est pas toujours bon signe sur ce que, soi-même, on a compris du sujet qu’on aborde.
Je suis venu tardivement à écrire sur le cinéma, au départ j’utilisais ce medium plutôt comme support pédagogique notamment en mobilisant la figure du western et les films de genres. Un film comme Poltergeist (Tobe Hooper, 1982) par exemple est une matière passionnante pour expliquer à des étudiants la péri-urbanisation, de même que Invasion Los Angeles (John Carpenter, 1989) offre un panorama assez subtil des problématiques de la ville au début des années quatre-vingt-dix. Étant donné que je suis aussi enseignant dans le secondaire, ne pas tomber dans le piège du jargon est pour moi une question fondamentale. C’est une question très compliquée au sein des sciences sociales car il faut naviguer entre une attitude qui consiste souvent à utiliser des mots compliqués pour se faire accepter et reconnaître dans le milieu, et d’un autre côté il ne s’agit pas non plus d’être complaisant en disant que les mots compliqués ne servent à rien car parfois certains concepts nécessitent qu’on emploie des mots compliqués pour les définir. Toute la difficulté c’est de réussir à trouver un chemin entre les deux : ne pas se rendre inaccessible sans renoncer à la complexité de ce que l’on doit raconter. Je me suis bien évidemment posé la question d’être compréhensible et surtout de ne pas être incompréhensible sans raison. C’est un enjeu majeur parce que les sciences sociales sont aujourd’hui un peu coupées du monde. C’est quelque chose de très problématique, parce qu’elles sont censées apporter des éléments pour comprendre le monde, le critiquer et le transformer, mais parce qu’elles ne se rendent pas accessibles, la connexion ne se fait pas. Il y a bien sûr des gens qui essaient de faire ce travail de vulgarisation mais ils sont minoritaires, en tout cas c’est l’impression que j’en ai. Les chercheurs ont une énorme responsabilité dans l’imperméabilité de ces sciences et beaucoup en sont conscients par ailleurs, je ne suis pas du tout le seul à m’inquiéter de cela. On a bien sûr besoin de chercheurs et chercheuses pour comprendre le monde dans lequel on vit, mais il faut réussir à transmettre ce savoir, ces réflexions, au monde que l’on étudie et pour cela il faut d’abord réussir à se rendre compréhensible. Surtout que je suis convaincu que lorsque l’on est compliqué, ce n’est pas toujours bon signe sur ce que, soi-même, on a compris du sujet qu’on aborde.
Propos de Manouk Borzakian,
auteur de « Géographie Zombie, Les ruines du capitalisme »
publié aux Editions Playlist Society
Retranscrits par Joris Laquittant
Merci à Benjamin Fogel et Elise Lépine
Retrouvez Manouk sur son blog Géographie et Cinéma






Pingback: Marâtres et Mauvaises Mères, figures de l'horreur | Analyse sur Fais pas Genre