Des coffrets consacrés à la Hammer, il y en a eu à foison ces dernières années : The Hammer Collection en vingt films chez nos amis anglais en 2015, 13 Cauchemars de la Hammer chez Elephant Films en 2017, Collection Hammer 9 Films, chez ESC en 2022, sans oublier Sex and Blood chez Tamasa en 2020, ce dernier constituant le tome 2 consacré à la maison de production britannique. Voici aujourd’hui – allez comprendre – le tome 1, couvrant la seconde moitié des années soixante et présentant sept réalisations plus ou moins représentatives de l’horreur gothique, à l’image restaurée (dépoussiérage et nouvel étalonnage des couleurs) et en version originale sous-titrée. On y trouve entre autres du Terence Fisher, du Christopher Lee, un peu de Peter Cushing, un soupçon d’érotisme, quelques litres de sang et pléthore de créatures diaboliques de toutes sortes. L’occasion pour nous de revenir sur les grandes années de ce studio mythique.

© Tous droits réservés
Aux sombres héros de la Hammer
« Dans les années 50, l’horreur à la sauce Hammer était l’expérience la plus terrifiante que le cinéma pouvait offrir. Cette terreur était alors incarnée par un astronaute mutant, un scientifique amoral et un vampire assoiffé de sang. La mort et le sexe n’étaient plus laissés à l’imagination du spectateur […] ». Telle est l’introduction du livre L’antre de la Hammer de Marcus Hearn, sorti en 2012 (aux éditions Akileos pour la version française). Si cette assertion peut être débattue, il ne fait aucun doute que sans l’emblématique studio, le cinéma d’horreur n’aurait pas été le même, tout comme il aurait été différent sans les « Universal Monsters » des années 30. Éminemment transgressifs, jouant constamment à contourner une censure féroce (en particulier outre-Manche), les productions de la Hammer furent, pendant deux décennies et à partir du milieu des années 50 le mètre étalon de la série B, de l’épouvante internationale inspirée des grands mythes de la littérature horrifique. A grand renfort de matériel promotionnel (parfois trompeur, mais la pratique est courante en ce temps), le studio promettait de l’effroi, du sang et de jolies filles. La compagnie est créée en 1934 par James Carreras et William Hinds et reprise après la guerre par leurs fils respectifs James et Anthony. C’est à partir du milieu des années 50 que le succès arrive grâce tout d’abord à la science-fiction avec Le Monstre (The Quatermass Xperiment, Val Guest, 1955) puis le fantastique horrifique avec Frankenstein s’est échappé (The Curse of Frankenstein, Terence Fisher, 1957). Distribués par Columbia ou Universal (ce qui permet opportunément d’exploiter la veine des « Universal Monsters » d’avant-guerre), ces films connaissent également un succès important aux États-Unis, notamment avec le réalisateur fétiche de la firme, Terence Fisher : Le Cauchemar de Dracula (Horror of Dracula, 1958), La Malédiction des pharaons (The Mummy, 1959), Le Chien des Baskerville (The Hound Of The Baskervilles, 1959), Les Deux Visages du Docteur Jekyll (The Two Faces Of Dr. Jekyll, 1960), La Nuit du loup-garou (The Curse Of The Werewolf, 1961), Le Fantôme de l’opéra (The Phantom Of The Opera, 1962)…Pendant ce temps, en France, le fantastique et l’horreur sont largement méprisés par les critiques de cinéma, hormis quelques grands classiques. Il faut attendre 1962 et la création de la revue Midi-Minuit Fantastique – qui nous sert à nous, modestement, d’inspiration quotidienne – pour que ces genres trouvent un modeste écho dans la presse autre que des entrefilets peu flatteurs. La période traitée dans le coffret Hammer Tome 1 – 1966-1969 L’âge d’or correspond à de nouveaux partenariats de distribution et de production. Pour inaugurer la collaboration avec le studio américain Seven Arts, deux doubles-programmes sont prévus : Dracula Prince of Darkness / Plague of The Zombies et Rasputin the Mad Monk / The Reptile. Les quatre films doivent être tournés d’une traite aux studios Bray, lieu de tournage emblématique de la Hammer, situés dans la campagne anglaise près de Londres, en commençant par la résurrection de l’une des créatures emblématiques du cinéma d’épouvante, le vampire, et son incarnation légendaire.
Dracula Prince des Ténèbres
(Dracula Prince of Darkness, Terence Fisher, 1966).

© Tous droits réservés
Pour cette suite, le rôle du vampire revient assez logiquement à Christopher Lee d’autant qu’en 1966, celui-ci est devenu incontournable. Il a tourné pour divers réalisateurs en Europe et notamment Mario Bava (Hercule contre les vampires, 1961 puis Le corps et le fouet, 1963), a endossé le rôle d’un nouveau méchant iconique (Le masque de Fu Manchu, Don Sharp, 1965) et a fini par s’émanciper de son éternel binôme Peter Cushing. Terence Fisher, quant à lui, reprend le personnage de Dracula là où il l’avait laissé en 1958 dans Le Cauchemar de Dracula, à savoir…Un tas de cendres. Le long-métrage s’ouvre d’ailleurs sur la superbe scène finale du premier volet où Van Helsing/Cushing règle son compte à Dracula/Lee en se jetant sur un rideau pour mettre le vampire face aux rayons mortels du soleil. L’équipe mobilisée pour le tournage est des plus classiques : Jimmy Sangster le scénariste maison est à l’écriture, James Bernard à la musique et Bernard Robinson aux décors. Le film narre l’histoire de Helen, Charles, Diana et Alan, quatre Anglais en route pour Carlsbad (il n’y a vraiment que des Anglais pour faire du tourisme dans les Carpates à cette époque-là…) et qui rencontrent le Père Sandor (Andrew Keir), un religieux pas très académique (il parle fort et boit) dans une auberge de campagne. Le religieux tente de dissuader les deux couples de passer par un certain château situé sur leur route. Mais comme tous bons sujets de la Couronne qui se respectent, ils n’en font qu’à leur tête. Seule Helen (Barbara Shelley), la femme d’Alan, émet des doutes. Le lendemain, en effet, le cocher s’arrête net en chemin et refuse d’aller plus loin (on se demande d’ailleurs pourquoi il a accepté la course…), lâchant nos quatre héros dans la cambrousse, non loin du château en question. Comme il leur paraît impossible de faire à pied la distance qui les sépare de Carlsbad, ils décident de passer la nuit dans une cabane ! Or l’arrivée providentielle d’une calèche sans cocher a tôt fait de dissuader les Anglais, aussi étrange que cela puisse paraître, de dormir dans la masure, et tout ce beau monde décide d’emprunter le mystérieux véhicule. Évidemment, celui-ci ne les mène pas à Carlsbad mais bel et bien au château. Pas davantage effrayé, le groupe décide de passer la nuit en ces lieux et ça tombe bien : la porte est ouverte et un dîner pour quatre est servi. Là encore, seule Hélène semble trouver la situation étrange voire effrayante. Klove, l’inquiétant serviteur qui apparaît soudain, affirmant que son maître est mort mais qu’il perpétue son hospitalité pour en honorer le souvenir, leur propose de s’installer pour la nuit. Son objectif est bien sûr tout autre : ressusciter son maître à l’aide de sang humain…

© Tous droits réservés
La mise en scène de Terence Fisher, qui s’est fait une spécialité de la relecture des monstres classiques, rend palpable par petites touches l’inexorable montée en tension, par des mouvements de caméra qui suggèrent la présence invisible de Dracula. Celui-ci n’apparaît qu’au bout de trois quarts d’heure lors d’un climax lentement mis en place, lorsque Klove égorge Alan suspendu par les pieds juste au-dessus du tombeau où se trouvent les cendres de Dracula. Les effets visuels mis en œuvre pour la reconstitution de son corps constituent l’un des moments forts du long-métrage. Bien qu’en 1966 la Hammer n’ait pas encore toutes les audaces qu’elle aura quelques années plus tard, les pierres sont déjà posées : de la violence, du sang et un érotisme malsain comme lorsque Diana (Suzan Farmer), hypnotisée par Dracula, s’apprête à lui lécher le torse d’où coule son sang vénéneux. Cette scène pleine de sous-entendus est décortiquée dans les bonus par Mélanie Boissonneau (co-auteure de Le studio Hammer, laboratoire de l’horreur moderne ? aux éditions Le Visage Vert, 2023). Si on ne peut s’empêcher de relever quelques incohérences dans le scénario – l’artifice de la résurrection est un peu tiré par les cheveux, les crucifix placés par Sandor dans les cercueils vides semblent être complètement passés à la trappe, Dracula ne tient pas suffisamment à la « vie » pour enjamber une petite fracture dans la glace qui le mettrait à l’abri de l’eau… – cette suite directe du Cauchemar de Dracula est néanmoins dans l’esprit de son prédécesseur, interprétée par des acteurs convaincus.
Un coffret consacré à la Hammer ne saurait en France se concevoir sans la présence dans les bonus de Nicolas Stanzick, spécialiste national du sujet qu’on peut également entendre disserter dans le coffret 13 cauchemars… Il est l’auteur de Dans les griffes de la Hammer (éditions Le Bord de l’Eau, 2010) et a participé depuis 2013 aux rééditions en de luxueux volumes de feue la revue Midi-Minuit Fantastique. Dans un style enthousiaste et passionnant, érudit mais très concis et pédagogique, il retrace l’histoire de la firme et en particulier la genèse des sept productions contenues dans le coffret. Il revient régulièrement sur le cinéaste qu’il admire sans conteste le plus : Terence Fisher (quitte à laisser parfois l’objectivité au placard), qu’il n’hésite pas à comparer à Hitchcock ou Tourneur. On apprend ainsi que dès la fin du tournage de Dracula Prince des Ténèbres, dans un souci d’économie, un nouveau film est mis en chantier dans les studios Bray, réutilisant certains décors et acteurs dont Christopher Lee et Barbara Shelley.
Raspoutine, le moine fou
(Rasputin the Mad Monk, Don Sharp, 1966).
Lee souhaite un long-métrage historiquement rigoureux et tel est le cas du projet initial de John Elder, nom de plume d’Anthony Hinds. Cependant, la réalité nécessite une réécriture du scénario. L’histoire est ainsi embellie afin d’éviter un procès avec le prince Félix Youssoupoff, à l’origine de l’assassinat de Raspoutine, qui est encore vivant à ce moment-là. Entre autres libertés prises avec les faits, Raspoutine, le moine fou confère des pouvoirs surnaturels à Raspoutine et le dépeint comme un monstre qui n’agit que par intérêt personnel. La réalisation est confiée à Don Sharp, qui connaît bien Lee avec qui il vient de tourner Le Masque de Fu Manchu (The Face of Fu Manchu, 1965) pour une coproduction germano-britannique. Le tournage commence le 7 juin 1965, soit trois jours seulement après la fin de celui de Dracula Prince des Ténèbres, à peine le temps pour Bernard Robinson de remanier les décors.

© Tous droits réservés
Raspoutine débarque dans une auberge (un élément de décor décidément récurrent) et guérit par l’imposition de ses mains la femme malade du tavernier. Fort de ce succès célébré dans la danse et l’alcool, il séduit la fille du patron. Son soupirant, jaloux, tente de l’assassiner mais y perd une main au passage. Le moine se réfugie dans son cloître, d’où il est rapidement chassé. Il décide alors de se rendre à la cour du tsar, à Saint Petersbourg. Dans une taverne (encore une), il défie un médecin alcoolique à la boisson pour gagner quelques kopecks. Il y rencontre ainsi des nobles proches du tsar – Don Sharp à ce moment-là fait un clin d’œil à Dracula Prince des Ténèbres, dans la scène où Raspoutine échange un regard hypnotique avec Vanessa joué par Suzanne Farmer, pareil à celui de Dracula lorsqu’il hypnotise la même Suzanne Farmer ; il en fait un autre quelques minutes plus tard, lorsque Sonia (interprétée par Barbara Shelley) s’agite dans son sommeil perturbé par le géant russe de la même manière que l’actrice passe une mauvaise nuit au château du vampire… Le lendemain, cette Sonia se rend chez le médecin qui héberge Raspoutine bon gré mal gré, le rencontrant “pour de vrai”, tombe sous son charme brutal et se donne à lui dans une scène très érotique pour l’époque : Raspoutine enlève – ou plutôt arrache – les vêtements de Sonia. Celui-ci jette lui-même un voile pudique sur la suite des événements en couvrant sa conquête d’un drap, prétexte à un fondu au noir. A ce moment-là, le cahier des charges de la Hammer est déjà bien respecté : main coupée et femme dévêtue. Après avoir obtenu ce qu’il voulait, Raspoutine va utiliser Sonia (et s’en débarrasser ensuite) pour réussir à entrer à la cour du tsar. Son influence grandit et engendre le mécontentement et les jalousies. Un complot pour se débarrasser de lui va prendre forme…
Malgré le talent de Bernard Robinson, et les angles différents choisis par Don Sharp, un œil avisé reconnaîtra de nombreux éléments des décors de Dracula prince des ténèbres, intérieurs comme extérieurs, en particulier le manoir de Oakley Court. Cependant, la présence mémorable de Christopher Lee est de nature à masquer la petitesse du budget. Ses costumes sont de plus en plus flamboyants – comme l’analyse Mélanie Boissonneau – à l’image de sa prestation, tant au niveau du texte – les occasions où il en a eu autant à la Hammer n’ont pas été pas si nombreuses – que physiquement, notamment lors des scènes de guérison et d’hypnose, ou encore durant sa lente agonie. Lee déclarera que Raspoutine fut l’un des rôles favoris, et cela explose à l’écran, tant il en fait des tonnes.
L’invasion des morts-vivants
(Plague of the Zombies, John Gilling, 1966).
En complément de programme de Dracula Prince des Ténèbres, L’invasion des morts-vivants est tourné à la suite de Raspoutine le moine fou dans des décors plus largement remaniés cette fois. Le zombie est en 1966 une créature qui a déjà été exploitée à maintes reprises, notamment avant-guerre. Dans Les morts-vivants (White Zombie, Victor Halperin, 1932), Bela Lugosi, maître vaudou, commande une horde de cadavres ambulants. Jacques Tourneur a également porté à l’écran le pouvoir des rites occultes en 1943 dans Vaudou (I Walked with a Zombie). Dans ces deux films, cités comme fondateurs par Nicolas Stanzick, les créatures d’outre-tombe ne sont pas celles que nous connaissons aujourd’hui, avec leur démarche saccadée et robotique et leur état de décomposition avancé. John Gilling leur donne un aspect bien plus proche de celui qu’on leur connaît aujourd’hui, grâce aux maquillages de Roy Ashton : à ce moment-là, celui-ci a déjà œuvré sur de nombreuses autres productions Hammer, et notamment Les Deux Visages du Dr. Jekyll (The Two Faces of Dr. Jekyll, Terence Fisher, 1960), La nuit du loup-garou (The Curse of the Werewolf, Terence Fisher, 1961). Il sera également le créateur du masque de La femme reptile (The reptile, John Gilling, 1966).

© Tous droits réservés
Parmi les marques de fabrique des productions Hammer (le sang rouge carmin, l’érotisme latent), il y aussi la scène d’ouverture qui doit être choquante (avec les critères de l’époque, s’entend). L’invasion des morts-vivants s’ouvre sur des tambours frénétiques et une cérémonie vaudoue mené par un prêtre masqué entouré de ses disciples et tenant devant lui une poupée d’argile sur laquelle il verse du sang après l’avoir déposée dans un cercueil miniature… Le public sait ainsi de suite à quoi s’en tenir. Le Dr. James Forbes et sa fille Sylvia arrivent dans un village des Cornouailles au beau milieu d’un enterrement. Ils se rendent chez leurs amis le Dr. Peter Tompson et son épouse Alice. Ils apprennent qu’une étrange épidémie sévit aux alentours, sous forme de morts mystérieuses, inexpliquées. Les villageois refusent qu’on autopsie les corps des défunts. Forbes est pris à partie dans une auberge (disons un pub, pour changer) par un jeune homme qui l’accuse de ne pas pouvoir expliquer la mort de son frère. Par ailleurs, Alice se comporte étrangement. Une nuit, elle quitte la maison, suivie par Sylvia intriguée qui tombe sur une bande de chasseurs à cheval. Ceux-ci la maltraitent et l’amènent chez Clive Hamilton, un châtelain, riche, arrogant et autoritaire. Ce dernier prie Sylvia de l’excuser et la convainc de ne pas aller à la police. Pendant ce temps, Tompson et Forbes déterrent secrètement un cadavre pour l’autopsier mais se font surprendre par la police. En ouvrant le cercueil, ils le découvrent vide, à la stupeur des policiers. De retour de sa virée nocturne, Silvia assiste à une terrible scène aux abords d’une mine d’étain abandonnée : Alice, apparemment sans vie, est jetée au sol par une créature démoniaque. Forbes est anéanti et l’autopsie révèle un sang non humain sur le corps…

© Tous droits réservés
Brook Williams n’est sans doute pas le plus crédible des acteurs dans le rôle du Dr. Tompson, mais la brochette de talents qui l’entoure compense son jeu stéréotypé : sa malheureuse épouse Alice est interprétée par la belle Jacqueline Pearce, André Morell est son mentor le Dr. James Forbes. On retrouve aussi un second rôle récurrent des films de la Hammer, Michael Ripper en policeman, qui bénéficiera d’un rôle beaucoup plus important dans La femme reptile. John Gilling, réalisateur au fort caractère, a déjà eu maille à partir avec la direction de la Hammer quelques temps auparavant, à propos de ce que la production avait fait de son scénario pour La Gorgone (The Gorgon, Terence Fisher, 1964). Il a une revanche à prendre et va donc tourner le scénario à sa guise. Nicolas Stanzick y voit un vrai message politique : les zombies, utilisés comme des esclaves, représenteraient l’exploitation par l’homme dit « civilisé » des ressources de ses colonies (ici les rites vaudous). Malgré une proximité scénaristique avec La femme reptile (les morts mystérieux, un culte impie, le final dans flammes…) et des scènes directement issues du Dracula de Bram Stocker (comme le fait remarquer Stanzick dans son analyse), le film comporte quelques moments de bravoure : la transformation d’Alice en zombie, sa décapitation, le cauchemar de Forbes au cimetière. Rarement vu au cinéma à cette époque, la fameuse « main de mort-vivant sortant de terre » deviendra rapidement un cliché par la suite. A noter aussi que L’invasion des morts-vivants sort à peine deux ans avant le prototype absolu qu’est La nuit de morts vivants de George A. Romero. Bien que beaucoup plus crue, sanglante et politisée, la vision du zombie de Romero a fort probablement été influencée par le(s) film(s) de la Hammer. Par ces scènes inédites pour l’époque, L’invasion des morts-vivants connaîtra un joli succès.
La Femme Reptile
(The Reptile, John Gilling, 1966).

© Tous droits réservés
John Gilling prend à nouveau les commandes pour ce quatrième et dernier long-métrage tourné en continu aux studios Bray, destiné à être le complément de programme de Raspoutine, le moine fou. On retrouve naturellement une partie du casting comme Jacqueline Pearce et Michael Ripper. La première va à nouveau incarner une créature monstrueuse tandis que le second va bénéficier d’un rôle qui en fera, au final, le vrai héros du film. A nouveau, la scène pré-générique est conçue pour marquer les esprits. Charles Spalding rentre chez lui dans son cottage et y trouve une lettre qui l’invite au château du Dr. Franklyn, son voisin. Il a juste le temps de monter quelques marches et d’entendre un cri le mettre en garde qu’une créature non identifiée le saisit et le mord à la nuque ; aussitôt son visage devient cendreux et la mousse lui vient aux lèvres, avant une chute fatale dans les escaliers…Son frère Harry hérite de sa maison et décide d’y emménager avec sa femme Valerie. Lorsqu’il arrive au village et demande où se trouve la demeure, tout le monde l’évite. De même, dans un pub (étonnamment !), personne ne daigne lui répondre. Il sympathise néanmoins avec Tom Bailey le tenancier de l’établissement. De retour chez lui, il croise « Mad » Peter, sorte de vagabond local un peu fêlé, qui tient des propos étranges et incohérents. Il l’invite à dîner sans pouvoir en tirer grand-chose mais au milieu de la nuit, il ressurgit, le visage noirci, la mousse aux lèvres et rend l’âme. Le lendemain, Valerie rencontre Anna, l’étrange fille fille du Dr. Franklyn. Elle invite le couple à dîner, qui se passe mal : le docteur Franklyn est pris inexplicablement de fureur lorsque sa fille joue de la sitar. Le lendemain, en déterrant les deux récents cadavres, le tavernier et Harry découvrent qu’ils ont tous deux été mordus dans la nuque comme par un cobra…
Nicolas Stanzick voit une nouvelle fois dans La femme reptile le même message politique porté par le réalisateur : la critique du colonialisme, ici une sorte de revanche des asservis sur les colons, sous la forme d’une malédiction qui poursuit le Dr Franklyn depuis son voyage à Bornéo. C’est également une sorte de revanche pour le « bas peuple », puisque Michael Ripper, abonné aux seconds rôles dans de nombreux films de la Hammer trouve en Tom Bailey le tavernier une occasion de devenir petit à petit le vrai héros du récit.
Dans les griffes de la momie
(The Mummy’s Shroud, John Gilling, 1967).

© Tous droits réservés
Dans les griffes de la momie est le troisième film de momie après La Malédiction des pharaons (The Mummy, Terence Fisher, 1959) qui renouvelait le genre au travers du duo Cushing/Lee et Les maléfices de la momie (The Curse of the Mummy’s Tomb, Michael Carreras, 1964), plus anecdotique et sans grande inventivité, présenté en complément de programme de La Gorgone. Dernier tournage aux studios Bray, c’est une œuvre mineure, avec les clichés habituels des histoires de momie. Dans les griffes de la momie est un récit de trahison dans l’Égypte antique. L’héritier du trône doit fuir dans le désert (une carrière de sable dans laquelle on a placé quelques palmiers, en réalité) alors qu’un traître comploteur a tué son père le pharaon. Mais le jeune prince meurt dans le voyage et avant de trépasser, il remet le sceau royal des pharaons à Prem le chef des esclaves. Dans les années 20, des archéologues retrouvent la tombe du jeune pharaon (qui en réalité, si vous avez bien suivi, est celle du chef des esclaves, mais cela n’a strictement aucune incidence sur l’intrigue). Alors que les explorateurs pénètrent dans la sépulture, ils rencontrent son gardien qui profère des menaces de malédiction. L’égyptologue vétéran de l’expédition, Sir Basil Walden se fait justement mordre par un serpent. Pendant ce temps, Stanley Preston le financier de l’expédition, un homme autoritaire et imbu de lui-même, donne une conférence de presse au cours de laquelle il se voit contraint d’accompagner une équipe de recherche (à travers la même carrière de sable…) : en effet l’un des archéologues est son fils Paul. A peine l’expédition rentrée, Preston père évince Basile Weldon en le faisant interner et récolte tous les lauriers de la découverte… Mais Weldon s’enfuit de l’hôpital psychiatrique et tombe aux mains d’une inquiétante voyante dont le fils est justement le gardien du tombeau. Grâce au linceul qu’il a dérobé dans les trouvailles de l’expédition, ce dernier ressuscite la momie. Sa première victime sera Weldon…

© Tous droits réservés
Malgré son budget très limité que John Gilling a du mal à dissimuler, il reste aujourd’hui une distraction correcte, notamment grâce à certains de ses acteurs, comme Michael Ripper, éternel second rôle de la Hammer, qui joue ici avec conviction le larbin de son ignoble patron, ou encore l’inquiétante voyante au regard terrifiant (Catherine Lacey). La momie est interprétée par Eddie Powell, la doublure habituelle de Christopher Lee. Les autres acteurs sont plus anecdotiques à l’image de Margaret Kimberly, beauté froide et sans charisme, qui livre une performance très éloignée de ce que les photos promotionnelles de l’époque promettaient. John Gilling admettra que c’est son plus mauvais film, réalisé pour des raisons alimentaires et pour souffler entre les tournages épuisants du Saint. Il prendra se retraite après ce film où tout sent le micro budget : la « reconstitution » de l’Égypte antique pour la scène d’ouverture se limite à quelques costumes et accessoires. Les extérieurs sont de fait quasi inexistants et on ne croit pas une seule seconde se trouver au Caire les rares fois où les personnages sortent dans la rue. On est loin d’autres productions Hammer qui se passaient en partie dans le désert comme La déesse de feu (She, Robert Day, 1964) avec Urusla Andress, filmé dans le désert du Negev ou Un million d’années avant J.C. (One Million Years B.C., 1965, Don Chaffey) avec Raquel Welch, tourné aux Canaries. Les Bowie, responsable des effets spéciaux (la mort du vampire dans Le Cauchemar de Dracula, c’était lui), nous offre tout de même une belle décomposition finale de la momie. Le quatrième et dernier volet de la série sera La momie sanglante (Blood from the Mummy’s Tomb, 1971, Seth Holt) avec la délicieuse Valérie Leon, l’une des « Hammer Girl » les plus marquantes et future « James Bond Girl ».
Frankenstein créa la femme
(Frankenstein Created Woman, Terence Fisher, 1967)

© Tous droits réservés
Frankenstein créa la femme est le quatrième film (sur un total de sept) de la Hammer consacré à l’obsessionnel démiurge. En effet, le roman étant tombé dans le domaine public, rien n’empêche plus la firme britannique d’exploiter le sujet. En 1957, Frankenstein s’est échappé ouvre le bal, et un contrat de distribution est signé avec la Warner. Pour le second volet, La Revanche de Frankenstein (The Revenge of Frankenstein, 1958, Terence Fisher), c’est Columbia qui distribue, tandis que pour le troisième, L’Empreinte de Frankenstein (The Evil of Frankenstein, 1964, Freddie Francis), le deal se fait avec Universal, ce qui a une conséquence intéressante : le monstre a le même aspect que dans les films des années trente. Pour ne pas changer, la première scène agresse directement la sensibilité du spectateur : Hans, un jeune enfant, assiste à la décapitation de son père. Plus tard, devenu jeune homme, il travaille pour le Dr. Frankenstein. Pour célébrer la réussite d’une de ses expériences, Hans est envoyé chercher du champagne au pub (!) du coin. Là, trois petites frappes aristocrates s’en prennent à Christina (Susan Denberg, un mannequin en vogue à l’époque, la « Miss August » dans Playboy en 1966), la fille du tavernier, défigurée et handicapée. Hans corrige les butors, en blesse un au visage avec un couteau. Après la fermeture de l’établissement, alors que Hans a rejoint son aimée (ce qui donne lieu à une séquence d’acte sexuel et de nu suggérés, presque impensable pour la censure anglaise de l’époque), le savant touche enfin au but : il parvient à isoler l’âme d’un mort. Tandis que les trois jeunes gens reviennent en cachette au bar, ils se font surprendre par le tenancier que dans leur ivresse ils tuent. Hans est accusé de ce meurtre durant une parodie de procès, pendant lequel il n’ose avouer qu’il a passé la nuit avec son aimée. Il est condamné à la guillotine. Christina arrive au moment où la tête du jeune homme est tranchée : de désespoir, elle se suicide en se jetant à l’eau. Mais les deux corps sont récupérés par le Baron Frankenstein…
Cushing est de retour chez la Hammer dans le rôle qu’il connaît bien du scientifique, après avoir fait quelques infidélités chez la concurrence. Son personnage est peu concerné par les gens, il méprise la religion, n’a aucune empathie pour la souffrance ni de scrupules. Sa seule obsession, ce sont ses expériences pour vaincre la mort. Frankenstein créa la femme prend le contre-pied de ses prédécesseurs, puisque en lieu et place du monstre habituel, Frankenstein crée la beauté, en corrigeant les infirmités dont souffre Christina. Les thèmes chers à Terence Fisher – la dualité des personnages, la monstruosité séduisante, comme dans Les Deux Visages du Docteur Jekyll (The Two Faces Of Dr. Jekyll, 1960) ou Les Vierges de Satan (The Devil Rides Out, 1968) – sont omniprésents, mais on peut aussi voir le réalisateur tenter de mettre en scène un mélodrame, en les personnes de Hans et Christina, amants maudits et poignants.
Les Vierges de Satan
(The Devil Rides Out, Terence Fisher, 1968).

© Tous droits réservés
Dennis Wheatley est un écrivain anglais qui connut un succès phénoménal dans les pays anglo-saxons à partir des années 30 et jusque dans les années 70. Parmi sa production pléthorique figure une série d’histoires sur l’occultisme mettant en scène le duc de Richleau, qui lutte contre les adeptes de la magie noire. Pour scénariser le second roman de la série, The Devil Rides Out sorti en 1934, la Hammer fait appel à Richard Matheson, auteur prestigieux reconnu pour ses talents de nouvelliste et de romancier (Je suis une légende, L’homme qui rétrécit, tous deux adaptés pour le grand écran) autant que pour les scénarios qu’il a écrits pour la télévision (La Quatrième Dimension, Duel) et le cinéma (notamment des adaptations de Poe pour Roger Corman). Christopher Lee, qui interprète le duc, est un grand admirateur de Wheatley et c’est lui qui propose cette adaptation, dont il a par d’ailleurs tout à gagner : un rôle positif (celui du duc), une fois n’est pas coutume, et des répliques, qui ne sont pas légion dans les films où il interprète Dracula ! Les Vierges de Satan est le dernier qu’il tourne avec Terence Fisher. Selon Stanzick, cette nouvelle production essaie de sortir des standards de la Hammer pour se mettre en phase avec les tendances de l’époque. L’occultisme est à la mode dans le « Swinging London » et commence à se faire une place au cinéma (Rosemary’s Baby, 1968, Roman Polanski). Certaines scènes semblent également tout droit sorties d’un épisode de Chapeau Melon et Bottes de Cuir, comme cette course-poursuite très « pop », décortiquée par Mélanie Boissonneau.

© Tous droits réservés
Il ne faut pas se fier au titre français un peu racoleur : il s’agit avant tout ici d’une histoire de rites satanistes perpétrés par un gourou de la magie noire. Nicholas, duc de Richleau et Rex Van Ryn (Leon Greene) rendent visite à leur ami Simon, jeune homme sur lequel ils veillent depuis la mort de ses parents. Ils arrivent au milieu d’une réunion étrange, qui s’avère être celle d’une société secrète satanique, dirigée par le charismatique Mocata (avatar d’Alistair Crolwey, occultiste célèbre à l’époque) comme s’en rend compte le duc en visitant une pièce ornée de symboles diaboliques. Parmi les convives, Rex reconnaît aussi Tanith, une jeune femme de sa connaissance. Pour soustraire Simon à ces mauvaises influences, ils le kidnappent mais celui-ci parvient à s’échapper. En allant fouiller chez lui, ils assistent médusés à la matérialisation d’un esprit maléfique au-dessus d’un pentacle, dont ils réchappent de justesse. Rex réussit à retrouver Tanith et l’emmène dans la campagne chez des amis pour la protéger. Mais elle s’échappe elle aussi, avec la voiture de son protecteur, et alors qu’il la poursuit, les pouvoirs maléfiques de Mocata l’envoient dans le décor. Il réussit toutefois à découvrir les lieux de la cérémonie. Nicholas arrive sur place alors que Baphomet est invoqué par les adeptes en transe. Les deux hommes décident d’agir pour sauver Simon et Tanith…
La mise en scène de Fisher est encore une fois une illustration de son « matérialisme fantastique », terme utilisé par Stanzick : des créatures de chair et de sang qui évoluent comme autant d’entités symboliques dans le monde réel. Les mouvements de caméra jamais gratuits, l’utilisation des miroirs, les gros plans sur les yeux…Tout l’attirail du metteur en scène est déployé. La dualité des personnages chère au réalisateur s’exprime aussi de manière éclatante ici : Christopher Lee en exorciste n’est rien d’autre que l’alter ego ambigu du gourou Mocata (Charles Gray, le méchant Blofeld dans le James Bond Les Diamants sont éternels de Guy Hamilton, 1971). Les Vierges de Satan se situe ainsi quelque part entre Rosemary’s Baby et L’exorciste (William Friedkin, 1973), franchissant encore un pas dans la provocation de la censure anglaise – Satan et rites impies à tous les étages, kidnapping d’un enfant pour le sacrifier – même si on peut penser que la pirouette finale a sans doute été placée là pour apaiser les censeurs.
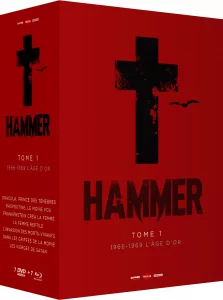 Avant sa liquidation en 1979, Le studio Hammer aura produit 158 films, dont une cinquantaine dans le genre de l’horreur. La société constitue ainsi un cas unique dans cette forme d’expression cinématographique, et en particulier dans l’horreur dite « gothique ». Seul Roger Corman à travers son cycle d’adaptation de nouvelles d’Edgar Poe (neuf films au total entre 1960 et 1969, dont la plupart avec Vincent Price) proposera à la même époque des réalisations dans le même esprit. Ce style à nul autre pareil, agrémenté de quelques beaux succès bâtis essentiellement sur les « Hammer Girls » dans des genres différents comme La Déesse de feu (She, Robert Day, 1965) ou Un million d’années avant J.C. (One Million Years B.C., Don Chaffey, 1966), se déclinera durant les années 70, que certains voient comme le début de la décadence de la maison britannique, dans une certaine surenchère de sang et d’érotisme. Mais bientôt, une horreur plus moderne, plus crue et plus contemporaine dans ses préoccupations – avec des longs-métrages comme Rosemary’s Baby, La nuit des morts-vivants, L’exorciste ou les travaux de Dario Argento – ainsi qu’un peu plus tard l’apparition des blockbusters comme Les dents de la mer (Jaws, Steven Spielberg, 1975), vont sonner le glas de la série B horrifique à l’ancienne. Pourtant, à l’instar de l’une de ses créatures fétiches, la marque renaîtra de ses cendres, bien plus tard.
Avant sa liquidation en 1979, Le studio Hammer aura produit 158 films, dont une cinquantaine dans le genre de l’horreur. La société constitue ainsi un cas unique dans cette forme d’expression cinématographique, et en particulier dans l’horreur dite « gothique ». Seul Roger Corman à travers son cycle d’adaptation de nouvelles d’Edgar Poe (neuf films au total entre 1960 et 1969, dont la plupart avec Vincent Price) proposera à la même époque des réalisations dans le même esprit. Ce style à nul autre pareil, agrémenté de quelques beaux succès bâtis essentiellement sur les « Hammer Girls » dans des genres différents comme La Déesse de feu (She, Robert Day, 1965) ou Un million d’années avant J.C. (One Million Years B.C., Don Chaffey, 1966), se déclinera durant les années 70, que certains voient comme le début de la décadence de la maison britannique, dans une certaine surenchère de sang et d’érotisme. Mais bientôt, une horreur plus moderne, plus crue et plus contemporaine dans ses préoccupations – avec des longs-métrages comme Rosemary’s Baby, La nuit des morts-vivants, L’exorciste ou les travaux de Dario Argento – ainsi qu’un peu plus tard l’apparition des blockbusters comme Les dents de la mer (Jaws, Steven Spielberg, 1975), vont sonner le glas de la série B horrifique à l’ancienne. Pourtant, à l’instar de l’une de ses créatures fétiches, la marque renaîtra de ses cendres, bien plus tard.






